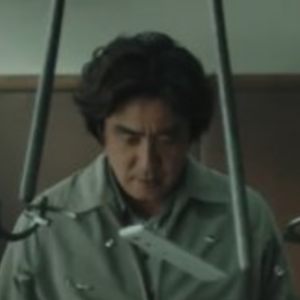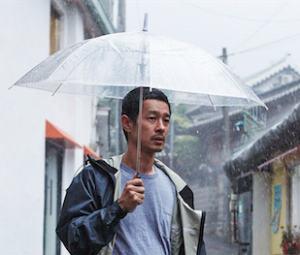The Phoenician Scheme, Wes Anderson
Pile ou face

Dans un essai publié en 2017, le philosophe Peter Szendy s’employait à explorer la structure économique de la circulation des images, qu’il nomme l’ « iconomie » du visible. Szendy s’intéresse plus précisément aux images comme porteuses d’une valeur financière, à leur circulation comme marché, à leurs échanges comme transactions (situées, dans un film, à l’endroit du montage). L’une des figures iconomiques analysées par l’auteur apparaît singulièrement dans L’Argent de Bresson : c’est la multiplication des portes. Celle du distributeur, du bureau du père du protagoniste, du magasin de photo… Szendy en rappelle le rôle essentiellement rythmique chez Bresson, mais propose aussi de penser ces seuils comme autant de points de passage d’une image à l’autre, autrement dit : de points de transaction[11][11] « L’argent, dans L’Argent de Bresson, passe par la porte, le seuil du film, pour entrer dans le film. Et l’on pressent que cette porte par laquelle il passe est plus qu’une simple porte : par ses clôtures à répétition, c’est elle qui semble produire les coupures (entendons ce mot dans sa double portée, comme pouvant désigner à la fois le billet de banque et l’interruption, le point de montage). » Peter Szendy, Le supermarché du visible. Essai d’iconomie, Minuit, 2017, p. 130..
Tout cela n’aurait absolument rien à voir avec le film qui nous occupe, si cette taxinomie des mouvements de passe-passe, ces plans à coulisse et cette minutieuse chorégraphie des « pliures du visible[22][22] Expression utilisée par Szendy à propos de Pickpocket, autre film de Bresson. Je renvoie à son analyse pour plus de détails. » ne semblaient ouvrir un chemin de traverse entre deux cinématographies de modélistes (certes, pas le même modélisme) que sont celles de Robert Bresson et de Wes Anderson. On trouve chez Anderson un nombre incalculable de portes et de (chausse-)trappes, de stores baissés ou relevés, de passages plus ou moins secrets et de travellings glissant d’une pièce à l’autre, qui tracent et rigidifient une « voirie du visible », à la manière des portes-tambours et des ascenseurs de la ville moderne. Il apparaît ainsi que les transitions sont une dimension au moins aussi importante et maniaque que la symétrie dans l’esthétique andersonienne, radicalisée dans l’espace ad hoc des trains criblés de portes et de passages de The Darjeeling Limited ou The Grand Budapest Hotel, comme il l’était dans une séquence de Pickpocket commentée en ce sens par Szendy. L’analogie entre les deux cinéastes, à ma connaissance, s’arrête ici.
Il est néanmoins frappant qu’on retrouve très peu ces mouvements transactionnels dans The Phoenician Scheme, dernier film du cinéaste texan, perçu par plusieurs critiques comme plus linéaire, moins survolté, et plus en rapport avec la chair (par le gore de la première séquence) que les précédents Asteroid City et The French Dispatch. Pourtant, le film est justement structuré par une intrigue spéculative où il s’agit de combler le « gap » d’une ligne de chemin de fer inaboutie. Cet obscur montage financier est imaginé par l’homme d’affaires Zsa Zsa Korda (Benicio del Toro), qui réchappe miraculeusement à chaque tentative d’assassinat organisée contre lui. L’« entre-image » poursuivi par Szendy est bien là, mais en lieu et place de « coupures », ce sont les séquences en noir et blanc où Zsa Zsa, à chaque quasi-décès, assiste à son propre procès céleste en cupidité et abandon de famille, qui lui donnent forme. Le même procès est instruit par la fille de Zsa Zsa, Liesl (Mia Threapleton), future religieuse invitée à laisser tomber les ordres pour une période d’essai en tant que destinataire de l’héritage et de l’intérêt paternels. Liesl prévient Zsa Zsa : lui aussi est en période d’essai, jusqu’à tant que la responsabilité du businessman soit écartée dans la mort suspecte de sa mère, et qu’elle jauge de leur capacité commune à réformer ses manœuvres véreuses.
Après l’emballement formel des films précédents[33][33] Vincent Malausa remarquait déjà une accalmie dans Asteroid City, qui me semble plus perceptible encore dans The Phoenician Scheme. « Wes Anderson tourne vite, de plus en plus vite (trois films depuis 2018 alors que presque cinq ans séparaient The Grand Budapest Hotel et L’Île aux chiens), et la forme toute en arabesques, virevoltes et glissements de ses derniers films a pu laisser croire que son œuvre était promise – sinon condamnée – à une logique d’accélération incontrôlable. » Vincent Malausa, « Le ciel est un songe », Cahiers du cinéma, n° 799, juin 2023, p. 38. On pourrait, en poussant un peu l’image, parler de « bulle » andersonienne., par la voie même d’un retour maîtrisé au thème de la famille qui se situe au cœur du cinéma d’Anderson, The Phoenician Scheme semble mettre au jour un autre point sensible et indissociable au précédent : l’argent comme envers perverti de la famille et du regard fasciné par les choses. La marchandisation du visible menace à chaque instant de prendre le pas sur l’amour filial et sur la féérie d’un matérialisme enfantin. The Phoenician Scheme serait à ce titre une entreprise conjuratoire, incarnant dans Zsa Zsa cet envers monstrueux.

On appelle ici matérialisme, au sens faible, l’attitude qui consiste à tirer un plaisir (esthétique, sensuel) des choses matérielles. Si on suit Louise Masson et Luc Vancheri, c’est plus précisément le plaisir du collectionneur qui est stimulé chez Wes Anderson, celui qui « ôte aux choses leur caractère de marchandise » pour les libérer de leur « corvée d’être utile ». Et les auteur·ices d’évoquer l’inventaire que Suzy fait du contenu de sa petite valise dans Moonrise Kingdom :
« Élus par Suzy, les objets changent de statut, désormais élevés au rang de trésor dont elle ne peut se séparer. C’est le cas notamment des jumelles qu’elle ne quitte jamais : libérées de leur valeur d’usage, les voilà investies d’un “pouvoir magique”. Ce lien indéfectible est aussi celui qui se crée entre Steve Zissou et le fameux requin-jaguar qu’il poursuit dans La Vie aquatique. Les aventures de Steve renouent ainsi avec deux tendances de la collection : la quête de l’objet manquant et l’affection pour l’animal hybride et exotique[44][44] Louise Masson & Luc Vancheri, “Wes Anderson (1969)”, in Emmanuel André, Jean-Michel Durafour, Luc Vancheri (dir.), Dictionnaire d’iconologie filmique, “Le vif du sujet”, Presses universitaires de Lyon, 2022.. »
Si l’inventaire est effectivement une figure incontournable de l’écriture andersonienne, The Phoenician Scheme présente une étonnante occasion manquée : l’inventaire, effectué entre deux portes (encore elles !) des richesses de la maison de Zsa Zsa, dans la perspective d’y mettre le feu volontairement et de toucher l’assurance. À la liste des plus luxueux et abracadabrants objets qu’aurait permis cette évaluation de la valeur marchande des biens de Zsa Zsa, Anderson préfère faire énumérer à Michael Cera, vrai-faux précepteur de Zsa Zsa embarqué dans ses magouilles, les objets contenus dans une anecdotique valise diplomatique, objets qui, dans leur grande majorité, ne présenteront précisément aucune valeur marchande ou scénaristique. Contrairement à l’inventaire des biens de Zsa Zsa, cette énumération apparaît, littéralement, « gratuite ».
Au début de The Phoenician Scheme, le rapport aux choses de Zsa Zsa, purement spéculatif (impérieux, il dira à ses fils de ne pas acheter de tableaux si ce n’est des chefs d’œuvres – donc des investissements), n’a rien en commun avec la considération d’esthète de Suzy ou Zissou. C’est plutôt avec la femme de ce dernier, Éléanore, le « cerveau » des expéditions de La Vie aquatique, que Zsa Zsa partage des choses : la fortune et le goût de la connaissance. Dans les interstices de l’emploi du temps de Zsa Zsa, son précepteur lui dispense d’insolites leçons sur les ailes des libellules et le comportement des mantes religieuses, une autre accumulation enfantine qui pourrait détonner dans le comportement du businessman.
Cette curiosité pour l’insolite et cet amour de l’inventaire scientifique n’est pourtant pas loin de l’autre face de l’attitude matérialiste : l’amour de la possession. Dans la mythologie qu’il consacre à Jules Verne, Barthes avait déjà décrit l’ambiguïté de ce regard sur le monde, un matérialisme qui en menace un autre :
« Verne a été un maniaque de la plénitude : il ne cessait de finir le monde et de le meubler, de le faire plein à la façon d’un œuf ; son mouvement est exactement celui d’un encyclopédiste du XVIIIe siècle ou d’un peintre hollandais : le monde est fini, le monde est plein de matériaux numérables et contigus. L’artiste ne peut avoir d’autre tâche que de faire des catalogues, des inventaires, de pourchasser de petits coins vides, pour y faire apparaître en rangs serrés les créations et les instruments humains. Verne appartient à la lignée progressiste de la bourgeoisie : son œuvre affiche que rien ne peut échapper à l’homme, que le monde, même le plus lointain, est comme un objet dans sa main, et que la propriété n’est, somme toute, qu’un moment dialectique dans l’asservissement général de la Nature[55][55] Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1957, p. 75.. »
Le danger, c’est ce qui guette la fascination enfantine quand elle est cultivée par l’industrie du jouet, c’est la magie des choses qui maturent ou macèrent, la lente conversion, en accumulateurs ou consommateurs ravis, des enfants-esthètes qui peuplent les films de Wes Anderson. Du Belafonte au Nautilus[66][66] « Tous les bateaux de Jules Verne sont bien des “coins du feu” parfaits, et l’énormité de leur périple ajoute encore au bonheur de leur clôture, à la perfection de leur humanité intérieure. Le Nautilus est à cet égard la caverne adorable : la jouissance de l’enfermement atteint son paroxysme lorsque, du sein de cette intériorité sans fissure, il est possible de voir par une grande vitre le vague extérieur des eaux, et de définir ainsi dans un même geste l’intérieur par son contraire. » Ibid., il n’y a donc qu’un pas, que Wes Anderson se garde bien de franchir.
Au contraire, le cinéaste ne cesse de mettre à distance cette potentialité sans la supprimer tout à fait, convoquant le vertige du spectacle d’un requin-jaguar que personne ne songe plus à tuer, d’un train qui se perd et vous laisse sans rails, ou de la rencontre d’un gracile extra-terrestre. Bref : en dépassant toujours les « choses » pour regarder au-delà, quitte à faire naître un léger sentiment de mélancolie face à ce qui se trouve, justement, au-delà : le temps qui passe et la mort qui se rapproche. Une attitude qui n’est pas sans rappeler celle des marmots aux dernières lignes de Morale du Joujou de Charles Baudelaire, cherchant une âme dans leur jouet et ne trouvant que l’angoisse du vide[77][77] « La plupart des marmots veulent surtout voir l’âme, les uns au bout de quelque temps d’exercice, les autres tout de suite. C’est la plus ou moins rapide invasion de ce désir qui fait la plus ou moins grande longévité du joujou. Je ne me sens pas le courage de blâmer cette manie enfantine : c’est une première tendance métaphysique. Quand ce désir s’est fiché dans la moelle cérébrale de l’enfant, il remplit ses doigts et ses ongles d’une agilité et d’une force singulières. L’enfant tourne, retourne son joujou, il le gratte, le secoue, le cogne contre les murs, le jette par terre. De temps en temps, il lui fait recommencer ses mouvements mécaniques, quelquefois en sens inverse. La vie merveilleuse s’arrête. L’enfant, comme le peuple qui assiège les Tuileries, fait un suprême effort ; enfin il l’entr’ouvre, il est le plus fort. Mais où est l’âme ? C’est ici que commencent l’hébétement et la tristesse. » Charles Baudelaire, Morale du joujou, L’Art romantique, Calmann Lévy, 1885, Œuvres complètes de Charles Baudelaire, tome III, p. 139-149.. Le moment suspendu du cinéma permettrait à Anderson de tenir ensemble les deux faces de cette même pièce : fascination et désillusion.

Dans les boîtes[88][88] Voir ici, le chemin tracé par Thierry Méranger des boîtes d’Arpel’s du Grand Budapest Hotel, presque métonymiques du cinéma d’Anderson, à l’amour des maisons de poupée retrouvé dans les compartiments du bateau de La Vie aquatique. Thierry Méranger, « Tous en boîte ! » in « Jeu de piste », Cahiers du cinéma n° 821, juin 2025. qui obsèdent le cinéma d’Anderson, il y aurait ainsi toujours un fond caché, une échappatoire à ce « bonheur commun du fini » (Barthes). C’est sous forme de boîtes représentant les accords passés avec chaque investisseur de sa ligne de chemin de fer que Zsa Zsa présente l’articulation de son plan à Liesl, leurs couvercles servant de cartons à chaque opération de renégociation des termes du contrat. Tandis que la relation entre Liesl et Zsa Zsa se répare, la valeur du contenu de ces boîtes est chaque fois revue à la baisse avec l’insuffisance des investissements obtenus, jusqu’à finir troquée pour les babioles et objets souvenirs de la boîte héritée du père de Zsa Zsa, lors de sa rencontre avec son frère (Benedict Cumberbatch), qui est aussi son pire ennemi. C’est ici que se met en place un duel, autre figure iconomique et symbole d’une impossible image-échange pour Szendy. Mais ne pourrait-on y voir aussi, en l’occurrence, ces deux faces qui s’entredévorent, valeur marchande et grâce des images ? Et donc deux formes, au fond, de fétichisme (marchand et surréaliste) qui se dénoncent l’une l’autre, comme le pressentait Susan Sontag à propos de Benjamin, lui-même collectionneur surréaliste ?
Dans The Phoenician Scheme comme ailleurs, mais peut-être plus explicitement, Anderson prend parti pour le collectionneur, l’enfant ou le photographe, contre le financier. L’intrigue semble suivre un credo simple, un genre de « l’argent ne fait pas le bonheur » et surtout pas la famille, et pourtant… Car elle aussi menace toujours de se transformer en transaction (dans le don de Ned à Zissou, le leg du tableau de The Grand Budapest Hotel, les dettes réciproques… jusqu’au contrat que Liesl passe avec son père). Une hantise qui travaillait déjà The Darjeeling Limited, où les frères finissent par semer aux quatre vents les encombrantes valises du père. Ici, elle est conjurée par une jolie scène, celle de l’anniversaire de Liesl. Le cadeau de Zsa Zsa, qu’on imagine aussi luxueux que sa fortune le permet, surprend : c’est une petite pipe recouverte de tesselles de couleurs, qui paraît presque faite main par un enfant. Un cadeau qui brille moins par sa valeur pécuniaire que sa personnalisation, donc – Liesl ne se séparant jamais de sa pipe comme le personnage de cartoon qu’elle est. L’objet contraste en cela avec le cadeau protocolaire, tout d’or et de pierres précieuses, du roi Farouk à Zsa Zsa qui s’empresse de le refourguer à sa fille : un poignard (dans le même ton, Zsa Zsa offre des grenades au lieu de cigares, car il en a, dit-il, en surplus).
Chaque étape du film contribuera ainsi à faire passer Zsa Zsa de la désinvolture vis-à-vis de la valeur marchande des choses, apanage des immensément riches, et du goût du risque qui le pousse à son extravagant montage financier, au véritable détachement, pas très éloigné, au final, des valises laissées sur le bas-côté du Darjeeling. Contrairement à la circulation constante des flux financiers, c’est ce détachement qui lui permet, in fine, d’ancrer des valeurs sentimentales stables symbolisées par le leg de la bague de fiançailles en toc de Zsa Zsa à son futur gendre : le mariage arrangé converti en relation vécue, voulue pour elle-même.
Si le temps du cinéma permet à Wes Anderson de travailler les paradoxes de cette sensibilité de collectionneur, celui des spots publicitaires ne s’embarrasse pas de ces scrupules. Celui qu’il a récemment réalisé avec Roman Coppola pour accompagner sa collaboration avec les stylos de luxe Montblanc (Montblanc: 100 Years of Meisterstück, 2024) dit assez bien cette familiarité entre surréalisme et dandysme, entre l’objet rare et l’objet cher, finalement vanté par une signature formelle ultra-reconnaissable convertie en image de marque. Au cinéma, Wes Anderson est par ailleurs loin d’être un cinéaste économe. Les maquettes de ses films, en particulier, demandent un soin et surtout un temps de travail immenses pour que la fascination opère [99][99] Bien qu’Anderson ne soit probablement pas en mal de financements, son travail permet d’ajouter un niveau aux structures iconomiques évoquées : derrière une image, il y a l’argent de sa production. Et derrière celui-ci, en l’occurrence : une autre image, plus évidemment transactionnelle, publicitaire.. The Phoenician Scheme n’échappe pas à la règle, et a même été tourné avec de vraies œuvres d’art empruntées à des musées pour entrer dans l’éphémère collection de Zsa Zsa. C’est au générique que le cinéaste finira tout de même par en faire l’inventaire, énumérant et montrant les tableaux aperçus (ou pas) en arrière-plan du film, comme une succession d’images du patrimoine culturel et financier avec lesquels le film se sera permis, malicieusement, de jouer.
1h41
Scénario : Wes Anderson, Roman Coppola
Image : Bruno Delbonnel
Musique : Alexandre Desplat
Sortie française le 28 mai 2025