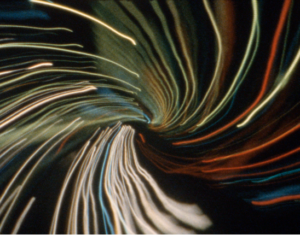FID Marseille, 2016
Notes festivalières
Inaugurée sous les huées de la foule face aux représentants des élus de la région et de la ville et sous le regard paisible de Hong Sang-soo, invité de prestige qui, ignorant sans doute le désamour des cinéphiles marseillais à l’égard de leurs élus, a peut-être vu là une manifestation de l’intransigeance sauvage du public festivalier, la 27ème édition du FID Marseille s’est avérée un bon cru, aussi prolifique et exigeant qu’à l’accoutumée. Le jeu de la programmation du FID invite de toute manière son spectateur à tisser des correspondances insoupçonnées entre les œuvres, en sorte que s’y dessine la carte d’un pays de cinéma qui n’est pas nécessairement celui du palmarès. Ce sont ces coïncidences et ces résonances qui ont structuré les présentes notes. Celles-ci restent par conséquent partielles puisqu’elles ne visent ni à l’exhaustivité, ni à rendre compte des seuls films récompensés, mais seulement à proposer un parcours elliptique parmi les quelques deux cents films qui composaient le riche programme de cette semaine marseillaise.
Les utopies intempestives
Inactuelles ou rétro-futuristes, anarcho-mystiques ou juvéniles, les utopies innervaient les propositions les plus vivifiantes de cette édition 2016. Ainsi le bien-nommé UFE (Un film événement), expérimentation chaotique et électrisante emmenée par une véritable troupe de cinéma dirigée par César Vayssié. Venu du théâtre et de la danse, où il a notamment travaillé avec Philippe Quesne et Boris Charmatz, ce dernier transpose les méthodes empiriques des arts vivants vers une forme rénovée de création cinématographique. D’un plateau à l’autre, de jeunes acteurs réunis périodiquement par Vayssié pendant trois ans éprouvent un faisceau de situations de jeu inspirées par un thème aussi vaste que primordial : les formes de l’engagement, entendu au sens politique et militant, aussi bien que personnel et amoureux ou encore performatif et esthétique. Sur la base de cette proposition, le film devient un laboratoire refondant le projet d’une communauté sur un acte de création qui compose en même temps un geste d’utopie politique, puisque le style anarchique et expérimental qui guide cette recherche ne cesse de produire de la pensée, en même temps qu’il préexiste à la réinvention de l’espace public comme agora par Nuit debout (le film a été tourné entre 2012 et fin 2014). Cette méthode détermine la forme du film, à la fois disparate et débordante, et dont la première partie surtout manifeste toute la vitalité : il est patent qu’à travers ce jeu de situations et d’improvisations entre un cinéaste et sa « troupe », le film raconte aussi quelque chose de la transmission et de la trahison, de l’interprétation et de l’irrévérence, du jeu comme lieu d’apprentissage de soi. Si bien que des chorégraphes et metteurs en scène qui ont croisé la route de ces jeunes acteurs, nul ou presque ne subsiste dans le montage final – sauf l’irrésistible Yves-Noël Genod en maître indolent et sadien dont l’autorité est bientôt contestée. Il faut préciser que la production du film est elle aussi inédite, puisqu’il n’est pas financé par une société de cinéma mais avec le soutien d’institutions de spectacles qui ont accueilli sa lente élaboration. Les décors du théâtre des Amandiers se prêtent ainsi à toutes sortes de travestissements du réel, parfois confondus avec les paysages alpins qui composent l’arrière-plan de la deuxième partie du film. Au gré de ces glissements d’un espace à l’autre, de la scène de théâtre au décor rural, de la fiction au documentaire de cette fiction, le film poursuit le projet de Godard d’un cinéma nourri d’utopie et de théâtre : même hargne juvénile, même logorrhée enragée et poétique, même empirisme de la création à laquelle se trouve associé le spectateur, lui à qui tout est donné quand, à la faveur d’un écran de fumée, ou dans le coulissement d’un fond de scène, il se trouve partie prenante de ce film en travail. Si UFE est tout entier placé sous l’ombre godardienne de La Chinoise et du Gai savoir[11][11] Mais même la musique de Pierre Avia semble parodier celle de Georges Delerue dans Le Mépris., le maître, comme tous les maîtres dans cette petite utopie anarcho-potache, est aussi joyeusement dézingué et poussé dans la tombe. Une faiblesse du film tiendrait finalement plutôt à son scénario relativement anecdotique et au montage de sa seconde moitié où s’essouffle un peu l’énergie des inventions de la première heure. Le film bascule alors dans l’intrigue éculée du rapt politique de quelque suppôt de l’ordre des médias, emmené dans une retraite bucolique sur fond de mignonnes bacchanales et promenades champêtres. La bravoure et l’intensité des situations à travers lesquelles le film éprouvait la vivacité de ses comédiens dans la première partie s’émoussent et laissent entrevoir quelques limites de l’ensemble. Par exemple, le piètre traitement de la question médiatique, qui forme pourtant le nœud de l’intrigue – ces pieds nickelés inspirés d’une version soft d’Action directe envisagent de tourner une vidéo et l’envoyer aux chaînes de télévision afin qu’elle soit diffusée à la place du bulletin météo. Génialement introduite dans la scène inaugurale du film avec une machine à écrire mise à l’épreuve de façon surréaliste, l’interaction sauvage et intuitive avec les technologies de l’information et de l’image – dans la même scène, la « performeuse », qui laisse son inconscient s’exprimer sur les touches de la machine, est photographiée par un appareil dont la pellicule n’est jamais développée – paraît de prime abord conçue dans cet automatisme de la pensée comme un pied-de-nez à l’histoire des médias. Mais elle est progressivement réduite à l’opposition des images et des contre-images, des médias dominants et des vidéos militantes, sans même que soit investi le champ interlope des réseaux sociaux et autres relais de diffusion simultanée – à dire vrai, les personnages d’UFE se comportent un peu comme si le champ médiatique n’avait pas évolué depuis La Chinoise. Cela ne doit pas ternir l’impression d’audace d’un film qui ne cesse de mettre en partage les modalités de sa propre écriture au plateau.
Il y a d’ailleurs une symétrie remarquable entre le film de César Vayssié et celui d’une autre troupe, petite sœur des groupes Medvedkine ou Dziga Vertov, Salaud d’argent (que ma langue s’attache à mon palais), un essai filmique signé du groupe Boris Barnet. Issu lui aussi d’une longue gestation (cinq années, de 2009 à 2014 au gré des réunions d’un collectif qui n’a jamais cédé au partage des tâches mais s’est astreint à tout faire au pluriel), il associe les mots amers de Faulkner aux ruines du Paris populaire dévoré par les mâchoires avides des pelleteuses. Symphonie urbaine décadente et ballet ferroviaire forment le décor de cette utopie furieusement rétro-futuriste qui a pour technique et pour éthique le 16mm, et pour esthétique le grain, l’ombre et la lumière de la pellicule noir et blanc. Mais à cet usage d’une technique désuète comme outil anachronique d’un cinéma militant résolument contemporain, et à la radicalité de ce télescopage des formes temporelles entre l’Amérique de Faulkner et l’histoire sociale ensevelie du Grand Paris, le jeu bressonien des interprètes du texte ne rend pas vraiment justice. A partir d’un scénario non-réalisé de Brecht, Zoe Beloff parvient plus sûrement à articuler une lecture de la crise économique de 2008 dans laquelle le texte de Brecht prend une nouvelle résonance : A Model Family in a Model Home. Dans un ingénieux travail de montage qui s’efforce d’assimiler l’impératif de distanciation dramatique de Brecht, Beloff envisage la prescience amère de ce scénario, rédigé à l’arrivée du dramaturge à Los Angeles en 1941 et inspiré d’un article de Life sur l’exhibition d’une famille moyenne américaine choisie parmi les lecteurs du magazine pour mener une vie exemplaire dans une maison modèle. Ce théâtre publicitaire, symptomatique pour Brecht du spectacle capitaliste, et prémonitoire pour Beloff des mirages de la bulle spéculative de l’immobilier, tisse un fil d’images depuis les home movies des années cinquante jusqu’aux nouvelles ghost towns de la crise immobilière. Beloff fait génialement de Brecht le narrateur de cette chronique acide du rêve américain, en l’invitant dans son film sous la forme d’une marionnette ventriloque, ou encore en substituant aux archives manquantes de son audition devant la Commission des activités anti-américaines en 1947 une série de dessins et l’enregistrement de sa voix. La convergence de ces matières d’images et des voix-off de Brecht et Beloff trace une ligne continue de 1941 à 2008, ouvrant une perspective nouvelle sur la crise économique et les fictions du capitalisme que Brecht avait analysées dans un triste pressentiment. Beloff a par ailleurs conçu ce film comme partie d’un projet plus vaste sur Brecht et Eisenstein à Hollywood, examinant les rapports entre architecture, cinéma et modernité tels que l’un et l’autre les ont investis – Eisenstein dans Glashaus, stupéfiant scénario resté à l’état de notes[22][22] Elles ont été éditées aux Presses du Réel en 2009 : S.M. Eisenstein, Glass House. Du projet de film au film comme projet. Traduction de Valérie Pozner, Michail Maiatsky et François Albera, Les Presses du Réel, 2009., dans lequel le cinéaste russe avait imaginé une fiction dystopique au cœur d’une maison de verre dont le dispositif architectural aurait été pensé en symbiose avec une caméra entièrement mobile et libérée de toute optique anthropomorphique.
La même quête des utopies oubliées par l’histoire s’écrit dans la structure polyphonique et syncopée du film de Martin Le Chevallier, Münster. Comme le suggère néanmoins le titre, l’objet n’en est pas une dystopie capitaliste du XXe mais une utopie communiste avant l’heure en Rhénanie au XVIe siècle. La communauté des anabaptistes, menée par un prédicateur millénariste et assiégée par les armées du Pape, abolit la propriété, le commerce et l’argent, et professe l’égalité de tous et toutes. Mais ce paradis terrestre bascule bientôt dans une apocalypse sanglante à mesure que s’épuisent les ressources de la petite cité et que son prophète libertaire se mue en messie tyrannique. Refusant tout naturalisme, la mise en scène de Münster récuse aussi les artifices d’une vérité historique qui, faute de sources historiographiques contradictoires, se confondrait avec le point de vue des vainqueurs : deux récitants, troubadours caustiques à la fois participants et témoins du siège, rapprochent cette chronique anachronique de la chanson de geste, dans une polyphonie qui éprouve en permanence la difficulté à faire la part de la réalité et de la légende. L’épure des tableaux vivants dans un noir et blanc rappelant Dreyer se mêle à des scènes métafilmiques dans lesquelles les acteurs du drame commentent la représentation de l’histoire. Martin Le Chevallier parvient ainsi à conférer au film une puissance critique face à l’histoire sans pour autant faire des anabaptistes les héros d’une « histoire des vaincus » ni les précurseurs d’un anarchisme politique – il aurait été tentant, un peu à la façon des Chants de Mandrin de Rabah Ameur-Zaïmèche, de faire de cette utopie avant-gardiste une anticipation des luttes contemporaines. C’est peut-être là l’un des points communs de ces quatre films : envisager l’utopie non pas simplement sur un plan synchronique, singularité autonome contestant l’ordre du monde, mais aussi sur un plan diachronique, à contre-temps de l’histoire.
Film-opéra et lyrisme domestique
Le court-métrage de Ben Rivers Things ouvre une brèche vers la deuxième thématique de cette édition, puisque la vie recluse du cinéaste qui lui confère sa matière en fait tout à la fois une utopie domestique et une célébration lyrique des petites choses. Les motifs de l’insularité et de la solitude qui travaillent l’œuvre de Rivers trouvent une forme d’accomplissement dans cette élégie des objets et des rites du quotidien au rythme du passage des saisons. C’est le Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre qui fournit l’impulsion à ce travelogue domestique tandis que le récit de Robert Pinget, Fable, envisage le potentiel de fiction de ce territoire intérieur, strictement délimité par l’orée du jardin et les objets personnels. Le film est aussi l’occasion d’une réflexion sur l’expérience des images, depuis celle, première, de Lascaux qui s’imprime à la surface de l’écran comme un geste qui n’est plus simplement une empreinte ou une trace mais la re-présentation d’une figure anthropomorphe comme un autre soi, jusqu’au fantasme de la confusion de l’image et de soi, ici dans la pantomime burlesque d’un écureuil pris au piège d’un simulacre disposé à son intention par le cinéaste. Mais la caverne aux images de Rivers finit par n’être elle-même qu’une surface de projection, dématérialisant son propre espace en images de synthèses archaïques, dans un geste qui semble en même temps une espèce d’archéologie de sa propre existence.
Le film de de Roee Rosen offre une autre forme de célébration des objets du quotidien, sur un mode plus sarcastique et politique : Dust Channel se présente comme une opérette surréaliste mettant en scène les tribulations domestiques d’un couple d’Israéliens et d’un aspirateur Dyson dans la société hyper-policée d’Israël. Transformé en allégorie de la politique sécuritaire israélienne, l’objet ménager permet de mettre en miroir la vie intime et son obsession hygiéniste avec le sort des réfugiés détenus au centre de rétention de Holot. Le charme buñuélien de cette fable satirique que son auteur décrit comme « une variation sur le cadavre exquis des surréalistes » et qui multiplie d’ailleurs les références à Un chien andalou, emprunte aussi aux biographies d’objets de Trétiakov et au cinéma de Farocki – une scène de Feu inextinguible, dans laquelle les objets domestiques peuvent être démontés et remontés en armes automatiques, intervient ainsi comme un hommage au cinéaste disparu. De même qu’Avi Mograbi cherche dans Between Fences (2016) à exorciser le traumatisme des parcours migratoires des réfugiés de Holot à travers les techniques de jeu du Théâtre de l’Opprimé d’Augusto Boal, Roee Rosen recourt à l’exubérance d’une comédie musicale et d’une mise en scène opératique pour dévoiler la poussière cachée sous le tapis du pacte social israélien.
Cette veine lyrique et domestique se déclinait par ailleurs dans un certain nombre d’autres films, comme celui de Bertrand Bonello pour l’Opéra de Paris, Sarah Winchester, opéra fantôme. Couplage improbable de Gaston Leroux et de Brian De Palma investissant les espaces et les métiers de l’opéra, cette biographie lyrique et gothique de la veuve Winchester, comme une fantasmagorie moderne avec sa violence macabre et ses poupées sanglantes, ne cesse de diviser son propos pour interroger le rapport du créateur à sa création, qu’il s’agisse de Mrs Winchester et de sa maison aux esprits ou de Reda Kateb en curieux alter ego de Bonello. Preuve que le cinéaste excelle dans ces formes concises et précises, dans la veine de son portrait de l’artiste Cindy Sherman métamorphosée par Asia Argento en héroïne transformiste de l’imaginaire hollywoodien du féminin dans Cindy, the doll is mine. Ce lyrisme du quotidien se trouvait encore investi par deux autres films présentés dans la même séance : Sol Negro, de Laura Huertas Millan, portrait mélancolique et délié de la tante de la cinéaste, chanteuse lyrique au destin tragique auquel le film tente de redonner une voix ; et La Barque silencieuse de Julie Chaffort, série de tableaux bucoliques et vivants, peuplés d’arlequins et d’animaux imperturbables comme un grand livre d’enluminures doué de sons et de paroles.
(A.L.)
Un maître sans maîtrise, Hong Sang-soo
Cette édition du FID aura également offert la possibilité de trouver quelques oasis de légèreté à travers la rétrospective des 17 longs-métrages d’Hong Sang-soo (la bonne nouvelle est que les trois prochains sont déjà tournés et montés). Les quelques prises de parole du cinéaste Sud-coréen, dans lesquelles on retrouvait une forme de réticence à interpréter ou rationaliser ses choix, permettaient de saisir l’espace donné au réel dans son travail. Hong Sang-soo a évoqué l’impression physique d’étouffement éprouvée dans deux situations différentes : lorsqu’il se trouvait dans une salle de cinéma face à des films recourant à des recettes ou à des effets calculés, prenant la pensée dans le cours d’un récit stéréotypé, ou lorsqu’au début de sa carrière il restait assis des heures face à son bureau à la recherche d’idées.
C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, le roulis des vagues lui semble préférable à nombre de films, et ce pourquoi il laisse dorénavant venir à lui les idées en partant de lieux réels et en écrivant le matin même du tournage ; mais c’est parce que ses propres films parviennent ainsi à intégrer l’inattendu de la vie que le spectateur peut de temps en temps préférer le flux cinématographique zoomé au flux marin houlé. Les déclarations d’Hong Sang-soo semblaient osciller entre des maximes générales (« l’idée de tout comprendre est absurde », « ce qui est donné est plus précieux que ce qui est pris ») correspondant assez à l’esprit de son travail, et des éléments très concrets relatifs à sa méthode et au processus de réalisation.
Il y a dans In another country un personnage de scénariste qui écrit les histoires vécues dans le film par Anne, le(s) personnage(s) interprété(s) par Isabelle Huppert. Ce personnage apparaît lors de l’ouverture du film et revient au début de chacun des récits qui y sont imbriqués. Je profitai de l’occasion pour interroger Hong Sang-soo sur ce choix de structure narrative, et sur le fait que la scénariste ne revient pas à la fin, comme on aurait pu s’y attendre, pour former une sorte de boucle. Après tout, n’avait-il pas réalisé des films à plusieurs histoires en recourant à d’autres procédés ou sans recourir à un personnage intermédiaire (Les amour d’Oki, Un jour avec, un jour sans) ? En bon critique, je m’attendais à une réponse concernant la circulation et la dé-hierarchisation des niveaux de réalités, idée qui court à travers ses films. Mais en bon cinéaste, Hong Sang-soo a répondu qu’il ne se souvenait pas bien, avant d’ajouter qu’il devait tourner avec l’actrice Jung Yu-mi, et qu’il lui avait promis de lui donner un rôle assez conséquent : c’est pourquoi il a ajouté les scènes de ce personnage de scénariste.
Cet exemple est particulièrement extrême, et il y a de la malice dans ce type de réponse, une volonté de laisser le film exister de manière autonome (le choix qui a été fait conserve son plein effet dans le film, et il y aurait eu d’autres manières d’ajouter des scènes, par exemple en gonflant le second personnage joué par l’actrice). Deux réactions étaient alors possibles : être frustré, ou se dire que l’attitude du cinéaste était la plus belle et agréable marque de cohérence (il y aurait de la déception à voir Hong Sang-soo donner une « masterclass » où la « maîtrise » ne s’entendrait pas conformément à une tradition orientale). En l’écoutant répondre aux questions après In another country un jour, et Sunhi le jour suivant, on se disait qu’Hong Sang-soo avait quelque chose du personnage de Sunhi qui focalise l’attention des trois personnages masculins avant de s’évaporer, et du phare que le personnage d’Isabelle Huppert ne cesse de chercher sans jamais le trouver ailleurs qu’en rêve : une lumière qui réchauffe et oriente, mais qui en elle-même n’existe pas.
(R.L.)