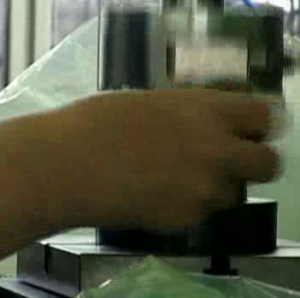Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino
Retour de flamme
Avec Once upon a time… in Hollywood, Quentin Tarantino fait à nouveau de la fiction cinématographique une sorte de vengeur burlesque de victimes qui n’ont rien de fictionnel. Après les Juifs d’Europe et les esclaves d’Amérique, il s’agit cette fois de Sharon Tate et de ses ami.e.s, assassinés par des membres de la secte de Charles Manson un soir de l’été 1969. Comme dans ses films précédents, notamment Inglorious Basterds (2009) et Django Unchained (2012), la violence s’exhibe avec une telle outrance qu’elle ne manque pas d’apparaître comme un substitutif dérisoire au réel. Mais le traitement de cette violence, qui forme dans sa filmographie un véritable discours, laisse ici d’autant plus perplexe que l’histoire bifurque avant que le crime ne soit commis. Les membres de la Manson Family (Charles « Tex » Watson, Susan Atkins et Patricia Krenwinkle) qui s’étaient arrêtés un instant dans Cielo Drive, rue dans laquelle se trouvent la demeure de Roman Polanski et incidemment celle du personnage de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), s’en font en effet rudement dégager par ce dernier, ivre mort. Ayant reconnu l’acteur-fétiche de leur jeunesse, et après un conciliabule au cours duquel Susan Atkins lance « My idea is to kill the people who taught us to kill ! », la Famille dévie ses desseins meurtriers vers la maison de Rick. Là, ils sont accueillis par le meilleur ami de Rick et sa doublure, Cliff Booth (Brad Pitt), qui les massacre un.e à un.e – prouesse que ne sape en rien le fait qu’il vient de fumer une cigarette trempée dans du LSD – jusqu’à ce que Rick prenne le relais en achevant Susan Atkins au lance-flamme. Alignement supplémentaire avec la geste d’Inglorious Basterds : Rick se sert de l’arme qu’il avait eu à manier en studio pour tourner une scène de dézingage d’officiers SS. Ici, la revanche n’est donc pas tant une réparation qu’une annulation pure et simple du crime, celui-ci étant en quelque sorte virtualisé par la narration, qui joue d’un compte-à-rebours pour faire de l’inévitable une fausse piste au sein de l’économie filmique. Un tel écart met alors en question le prétexte générique du « revenge movie », qui autorise normalement à prendre plaisir au déchaînement d’une violence perçue comme légitime.
L’échange de l’horreur hyperbolique et historique pour une horreur hyperbolique mais grotesque, procure sans doute la maigre consolation d’un déni provisoire. Mais il a aussi une autre fonction : démentir les propos prêtés à Susan Atkins. Le cinéma n’est pas école de violence, car la représentation n’est qu’un jeu : ainsi des films où Rick ne fait pas réellement ses cascades, qui sont exécutées par Cliff ; ainsi encore des films de Bruce Lee, dont les chorégraphies martiales ne valent pas un crochet de Mohamed Ali. C’est d’ailleurs à cette réalité que Cliff rappelle très concrètement la star hongkongaise, ressuscitée sous l’espèce de la caricature, en le claquant contre une voiture lors d’un duel improvisé. Once upon a time… in Hollywood, ou Hollywood par lui-même, est l’occasion de claironner que l’on y fait par-dessus tout profession d’artifice : et, de fait, Quentin Tarantino embauche Leonardo DiCaprio, soit un des acteurs les plus estimés de notre époque, pour jouer avec brio le rôle d’un acteur minable qui s’illustre dans un véritable faux nanar. Comme dans tout film de coulisses et de studios, le public est invité à jouir de l’élaboration tantôt émouvante, tantôt ridicule de la prestidigitation. La simulation, comme compétence spécifique du cinéma, oscille ainsi entre pouvoir jubilatoire et impuissance mélancolique. Ce qui paraît clair, c’est que violence réelle et violence fictionnelle sont présentées dans ce film comme deux régimes incommensurables, et que le cinéma n’est pas responsable de la « véritable » violence, qui est ailleurs.
Mais construire une série de « revenge movies historiques » en alignant Hitler, la figure de l’esclavagiste et la Manson Family ne va pas de soi. D’abord parce que le film ne venge plus des entités collectives structurellement dominées, exploitées, massacrées – les Juifs, les esclaves noirs – mais des individus, détenteurs de pouvoir matériel et symbolique, exceptionnellement visés par la violence d’une secte éphémère nourrie pêle-mêle de contre-culture, de psychose et de racisme. En l’absence de collectif identifié, on ne saurait dire ce que le film venge : Sharon Tate et ses ami.e.s ? Roman Polanski, son époux et père en devenir de l’enfant dont elle était enceinte ? Hollywood ? Cette mise en série pose également le problème de l’identité même des criminels : dans tout le film – et c’est justifiable d’un point de vue scénaristique puisqu’il n’y a pas de raison que les personnages connaissent la Manson Family – les membres de la secte sont désignés comme des « hippies ». Et de hippies, nous n’en verrons quasiment pas d’autres, si bien que la Famille les représente presque à elle toute seule. Or c’est bien l’horreur de cet assassinat qui autorisera les conservateurs à réduire le mouvement à la secte et à disqualifier pour de bon tout ce que les hippies représentaient, notamment l’opposition à la guerre au Viêt Nam et la critique de la société de consommation, deux discours que portent les membres de la Manson Family dans ce film. Ces camps opposés, aux contours un peu flottants, ne sont en tout cas guère comparables à ceux que mettaient en scène Inglorious Basterds et Django Unchained, si bien que le plaisir de la revanche n’a décidément pas le même goût.
Si le film offre peu d’éléments de contexte, il semble bien mettre en scène une tension entre Hollywood et les hippies, faite d’adoption et de rejet. Il montre en effet les nombreux passages des éléments de la contre-culture dans la culture dominante, notamment produite par Hollywood en ce temps-là : la « liberté sexuelle » métonymisée par les minis habits de « Pussycat » (autre membre de la Famille Manson), mais aussi de Sharon Tate (les mini-shorts, mini-tee-shirts, mini-robes) ; la consommation décomplexée de marijuana au squat comme à la villa… Mais ces points de passage ne dépassent pas l’univers de l’accessoire, telles la moustache et la veste à franges dont un cinéaste, exalté par Easy Rider, affuble le pauvre Rick. Animés de discours de revanche sociale et de pratiques radicales, les membres de la Manson Family apparaissent alors comme l’authenticité refoulée d’une contre-culture passée au tamis de la société du spectacle – surtout Tex, seul personnage dont le jeu exprime quelque esprit de sérieux, le grotesque échéant principalement à ses deux comparses féminines, secouées de cris hystériques et de gestes désordonnés. Le monde « normal » respire l’air ambiant de la fin de ces années soixante, mais ne franchit pas certaines lignes : qu’il s’agisse de prostitution ou de désir affirmé, la belle Pussycat se voit éconduire par Cliff Booth soupçonnant sa minorité sous ses airs de « femme libérée ». Une interprétation généreuse verrait dans ce refus un geste bienvenu au secours de la protection des mineur.e.s, à l’opposé de Charles Manson, qui n’avait pas eu de scrupule à recruter ses femmes dans la fleur de l’adolescence (14 ans pour Diane Lake). Mais l’écho avec Roman Polanski, accusé de viol, entres autres, sur une mineure de 13 ans en 1977, est trop fort pour être ignoré. Air du temps ? Pussycat est un cas idéal-typique de ce qu’on appelle aux États-Unis un jailbait, soit une mineure qui « appâte » les hommes et leur fait risquer la prison. Énième avatar de la tentatrice pousse-au-crime, cette figure vient rappeler au public qu’en ces temps où la morale admise était brouillée par les essais de la libération sexuelle, les femmes, même jeunes, n’étaient pas nécessairement détournées, mais parfois bien volontaires. Tarantino fait ici un choix politique de représentation qui dédouane les hommes comme Polanski de leur responsabilité. Et, comme souvent, c’est sous couvert de bousculer la bien-pensance, celle qui désexualise les mineures, que l’ordre moral dominant se voit renforcé en imputant aux jeunes femmes la responsabilité de la violence exercée contre elles. Cette fascination pour l’idée que les dominé.e.s travaillent à leur propre domination régale le discours réactionnaire, et Tarantino l’avait déjà manifestée avec Django Unchained où le type du House Negro[11][11] Esclave noir travaillant à la maison et non aux champs, devenu un type social stigmatisé comme figure de la collaboration avec les maîtres. apparaissait finalement comme le véritable et monstrueux cerveau de l’esclavagisme.
Mais ce n’est peut-être pas tant la violence exhibée, la simulation de la violence, qui pose problème dans les films de Tarantino, que sa dissimulation. L’alibi citationnel des films de genre nourrit en effet un humour de connivence qui fait passer la pilule de la brutalité des rapports sociaux. En témoigne le flashback sur la relation de Cliff Booth et de feu son épouse. Retranché dans la cabine d’un modeste bateau de pêche, Cliff Booth écoute sans broncher le flot injurieux d’une épouse déçue par un mari qui a échoué à exaucer son rêve : se voir ouvrir les portes de la noblesse hollywoodienne. Le flashback n’explicite pas l’issue de cette interaction, suspendue au harpon de chasse que Cliff Booth tient dans ses mains tandis qu’il lève les yeux sur sa femme. L’économie narrative fait mouche : le silence et la posture d’un Mr. Booth humilié alors qu’il s’emploie, avec la pêche, à une activité « active », contraste avec l’oisiveté babillarde d’une Mrs. Booth qui ne prend pas même la peine de sortir de son transat pour l’invectiver. Le désir, ainsi formé, que l’ustensile dévie de sa fonction première pour faire taire l’ingrate est comblé effectivement par la coupe sèche du plan – fin du caquet – et fantasmatiquement par l’ellipse du dénouement potentiel – fin de carrière d’une gold-digger[22][22] Littéralement orpailleur.se, mais métaphoriquement, femme qui cherche à s’enrichir via ses relations avec les hommes.. Peu importe, finalement, que Cliff Booth ait ou non tué son épouse : l’arithmétique morale de la scène lui rend de toute façon raison. Comme dirait Pierre Bourdieu : « les effets idéologiques les plus sûrs sont ceux qui, pour s’exercer, n’ont pas besoin de mots, mais du silence complice ». Quoi de plus efficace pour faire accepter l’idée du féminicide que sa drolatique euphémisation ? Cette absence de représentation n’est-elle en outre pas rattrapée, comblée par celle, si friande de prolongations cruelles, de la mise à mort de Susan Atkins et de Patricia Krenwinkle, ces « monstres » criards sur qui peut s’exercer, par substitution, une violence consensuellement autorisée ? La véritable violence, dans Once upon a time in… Hollywood, n’est peut-être pas là où elle prétend s’exhiber.
Scénario : Quentin Tarantino / Direction artistique : Richard L. Johnson / Image : Robert Richardson / Montage : Fred Raskin.
Durée : 161 minutes.
Sortie : 14 août 2019.