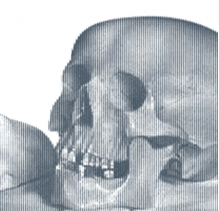Thomas Heise (V.F.)
D'une trêve l'autre
Thomas Heise réalise ses premiers documentaires dans l’ancienne RDA, au tournant des années soixante-dix et quatre-vingt, à l’école de cinéma de Potsdam – Babelsberg. Il quitte cette institution lorsque son film portant sur de jeunes délinquants (Wozu denn über diese Leute einen Film – A quoi bon un film sur ces gens – 1980) se voit censuré. Avant la chute du mur, l’ensemble de ses productions connaissent le même sort : soit détruites, soit interdites de diffusion. Dans Material (2009), il raconte l’histoire de la RDA avec des matériaux documentaires d’archive, parmi lesquels des entretiens avec des détenus et des “gardiens éducateurs”. Avec son avant-dernier opus, Die Lage, il documente dans un noir et blanc aussi clinique qu’onirique l’organisation millimétrée de la visite du Pape Benoît XVI à Munich. Heise pratique en parallèle le théâtre, et fait partie du Berliner Ensemble jusqu’en 1997, où il met en scène, entre autres, Brecht et Heiner Müller.
Découvert cette année à Lussas, Städtebewohner résulte d’une proposition de l’antenne mexicaine du Goethe Institut adressée autant à l’homme de théâtre qu’au cinéaste. Il s’agissait de mener un travail de mise en scène de textes de Brecht avec les détenus de la prison pour mineurs de San Fernando, à Mexico. Thomas Heise a finalement décidé de mettre en résonance la vie quotidienne de cette prison avec un recueil de poèmes de Brecht, Gedichtzyklus aus dem Lesebuch für Städtebewohner (Cycle de poèmes extraits d’un manuel pour habitants des villes). Les dix poèmes sont un guide de survie destiné à l’homme solitaire des grandes villes. Ils servent de pierre de touche au documentaire et sont sertis dans la matière du film. On retrouve dans Städtebewohner la précision du noir et blanc de Die Lage. Elle s’accompagne ici d’une étonnante qualité de douceur. Au moyen d’une narration qui avance de strophe en strophe, comme une forme poétique, le film nous emmène dans les différentes zones de cet espace clos mais aussi poreux. Le tour de force est de maintenir constante cette douceur et d’échafauder une distanciation respectueuse, tout en documentant la violence de la lutte pour la survie dans laquelle sont pris ces prisonniers : de jeunes corps enfermés, et des destins scellés très tôt par la loi du milieu.
Débordements : Votre film progresse doucement, comme par glissements successifs. Quelle était votre intention en choisissant une telle construction narrative ?
Thomas Heise : Sur un plan très pratique, l’équipe pouvait en principe se déplacer dans la prison, mais pour cela il fallait aussi remplir beaucoup de paperasses, passer par des sas de contrôle. Nous n’étions pas accompagnés de gardiens, mais tout cela prenait beaucoup de temps. Et Il arrivait que, d’un jour à l’autre, quelque chose nous soit soudain interdit, ou qu’un officier soit de mauvaise humeur. Construire une relation de confiance avec les détenus et les gardiens a été un long processus, tout comme faire comprendre que nous ne devions pas être instrumentalisés, par quiconque. Même si cela finissait toujours par arriver ! Avec cette perspective restreinte, le point de vue du film est assez anthropologique. La forme de la strophe ou du chapitre établit des séparations claires. Le récit est ainsi parfois suspendu, raconté comme une vieille histoire d’autrefois.
Le film s’ouvre sur un paysage poussiéreux, quelque part à la périphérie de la ville. Vient ensuite un poème de Bertolt Brecht de 1921, dit par une jeune femme. Le poème parle de la disparition d’un homme, de la fin de l’attente de cet homme, et enfin du souvenir de cette expérience. Après le prologue « à M. », vient le premier chapitre, la première strophe, la première observation. On regarde autour de soi, on suit ce que l’œil perçoit. La libération, les nouveaux arrivants, l’individu derrière les barreaux de la cellule, l’étrange moment idyllique et nocturne de la coupe de cheveux dans la cour de la prison, qui se termine par la première phrase du psaume quatre, directement lue devant la caméra par Ever, un des détenus.
La deuxième strophe commence dans le noir par la hissée du drapeau dans l’obscurité du matin, et la discussion au sujet du départ à la retraite du vieil officier ; ensuite il y a le petit-déjeuner, et la colombe blanche et noire sur le muret de la cour, le garde-à-vous des prisonniers pour le contrôle matinal, le changement des équipes et l’arrivée des visiteurs, enfin les trois dans la cellule, qui ne peuvent pas sortir. Finalement, il y a le football et la conversation du jeune couple, Marlene et Samuel, au sujet de l’avenir, qui se termine par un panoramique sur l’arbre de Noël et les enfants qui jouent sur la pelouse avec les familles qui campent là.
Troisième chapitre, un bloc de deux interviews, puis les efforts de deux évangélistes pour persuader Ever. Alors on peut voir la venue de la nuit, jusqu’au panoramique sur la cour nocturne, avec la troisième strophe du psaume quatre à la fin.
Le quatrième chapitre, Noël avec l’appel du matin, l’Armée du Salut et la visite pour Noël du père d’Irving. Irving, qui a peur du monde extérieur et qui apprend à Noël de la bouche de son père la manière dont il faut tirer quand on veut tuer. Finalement, c’est le départ de l’Aera verde, la cour-jardin de la prison où se tiennent les visites des familles, le retour dans la ville, en bus, jusqu’à la périphérie. On ne voit pratiquement pas d’êtres humains sauf quelques personnes au bord de la route, le vendeur sur l’autoroute, et enfin le psaume, à nouveau lu par la jeune femme, pendant que les jardiniers balaient le parc. « Und wer will wissen, was uns Wasser, Abende, und Himmel sind. » « Et qui veut savoir, ce que nous sont l’eau, le soir, et le ciel. » La séparation initiale entre « je » et « tu » est devenu un « nous » dans ce psaume. Les grains de poussière brillent et dansent dans la nuit.
D. : Pourquoi avez-vous décidé de ponctuer le film avec cette musique néo-romantique, qui introduit et clôt le film ?
T.H. : C’est une musique composée pour le film, dont j’ai passé commande à un jeune compositeur, Bowen Lieu. Bowen est élève de master auprès d’Ulrich Reuter, à l’école de cinéma Konrad Wolf à Potsdam Babelsberg. Le but était de relier entre eux les chapitres isolés, ou même les strophes prises séparément du poème du film. Il s’agissait aussi de reprendre le ton du premier des poèmes de Brecht utilisés. Nous avons discuté de musiques de film des années 1950 et 1960, parce que j’avais évidemment Los Olivados de Buñuel en tête au moment où je projetais de tourner Städtebewohner. J’ai d’ailleurs habité à Mexico sur la place Romita, dans une maison en face de l’église que l’on peut également voir dans le film de Buñuel. La musique crée aussi une distance, ou encore une différence, par rapport à ces images plutôt arides. Elle nous mène à l’universel.
D. : Vous n’avez pas sur la prison un regard de sociologue. À certains moments, la différence entre gardes et prisonniers tend même à disparaître. Elle devient poreuse en raison d’un commun état d’attente.
T.H. : La différence est je crois très évidente. Les uns ont des clés, des armes, et portent un uniforme noir ; les autres n’en n’ont pas, ils sont debout en caleçon dans leur cellule collective, doivent montrer leur corps et obéir. Mais les deux groupes sont enfermés derrière des murailles, et les gardes doivent eux aussi obéir aux ordres. Leurs espaces de détente sont de sinistres trous, sans fenêtre, étroits et poussiéreux. Je pense aussi à la scène de l’habillage matinal. Ils se transforment de civils en porteurs d’uniforme, puis inversement. Quand les gardes, après leur service, quittent la prison en passant par la porte d’acier, on ne peut plus les reconnaître, ils n’ont pas l’air très différents des prisonniers, seulement un peu plus vieux.
Il ne se passe pas grand-chose dans cette prison, si ce n’est la longue attente de quelque chose d’autre.
D. : La manière dont vous conduisez le long entretien avec Samuel, un prisonnier qui s’ouvre à vous d’une manière candide contrastant avec l’horreur du quotidien qu’il décrit, est très impressionnante.
T.H. : L’horreur naît d’abord d’une réflexion sur les faits, mais n’est pas contenue dans les faits eux-mêmes. Brecht le formule ainsi : l’homme est friable, mais pas assez friable. Et « L’homme se comporte selon son intérêt / comme ça pourra lui servir / à son idée. » J’avais ces idées en tête. Les conversations nous permettaient de faire connaissance de façon plus intime. Il ne s’agissait pas pour moi de transmettre une impression figée, ou une image définitive, de mon interlocuteur, mais plutôt de le découvrir, et de laisser au spectateur l’occasion de le faire aussi. Les interviews furent menées entre Noël et le Nouvel An. C’était le bon moment.
À cette période, la seule où une interprète professionnelle fût présente, nous étions trois dans l’équipe, plus le graphiste de l’affiche du film, malheureusement décédé entre temps, Mark Thomas. Pendant le tournage, il avait organisé un atelier de sérigraphie avec les détenus. Nous n’avons pas quitté la prison, pendant deux semaines. Nous logions dans des douches collectives désaffectées, nos matelas posés directement sur le carrelage. Il y avait des trous dans les murs provoquant des courants d’air, et une odeur nauséabonde provenant de la canalisation défectueuse.
Dès le premier jour, nous avons mangé avec les détenus, fait la queue ensemble dans la cantine. On mangeait la même bouffe désespérante, à la même table. C’était très important pour moi et cela nous a permis d’être respectés. C’est en mangeant qu’on se met à parler. Pendant les interviews, il n’y avait personne d’autre dans la salle, c’était comme une discussion libre entre amis. On s’aimait bien. La contradiction m’intéressait. Mais je me souviens aussi d’une déception visible, quand nous avons quitté la prison. Le film Städtebewohner est ma réponse à cette déception. Cela ne montre rien de particulier, juste le quotidien. Car c’est tout simplement cela que j’ai vu et compris à San Fernando.
D. : Alors que les interviews dans le documentaire donnent souvent l’impression d’échafauder une « identité narrative », les mineurs détenus interrogés semblent n’avoir pas une entière conscience de leurs actes.
T.H. : Cela vaut peut-être pour Ever, que je voulais interviewer pour cette raison. Il ne vient pas d’un milieu criminel. Je crois qu’il décrit très précisément ses intentions. Samuel est sincère aussi et croit ce qu’il dit. Je n’ai pas non plus vérifié par des questions supplémentaires sa justification d’innocence pour le protéger. Au Mexique, les mineurs, quel que soit le délit, encourent une peine maximale de cinq ans. Alors il est fréquent qu’ils agissent à la place d’un autre, comme cela semble le cas pour Ever, ou qu’ils revendiquent l’acte d’un criminel pour obtenir de l’argent. Je ne sais pas ce qu’il en est vraiment. Mais quand vous lisez le cycle de poèmes intitulé Lesebuch für Städtebewohner du début du 20ème siècle, vous rencontrez aussi des personnages de ce genre.
D. : Ces entretiens pourraient être le climax du film, mais vous évitez tout pathos.
T.H. : Il est important d’avoir de la distance. C’est toujours de ça qu’il s’agit, de se tenir derrière une frontière, pour maintenir ce balancement entre la proximité d’un côté et une pensée froide de l’autre.
D. : Il me semble que votre point de vue sur la prison est plus politique qu’éthique, que vous prenez soin d’inscrire ces personnages dans un système social et urbain plus vaste. En témoignent les plans sur l’autoroute, les ouvriers, au début et à la fin du film.
T.H. : Il y a à ce sujet un très beau commentaire de Marx sur la productivité des crimes[11][11] Le texte de Karl Marx en question est « Bénéfices secondaires du crime ».. Je l’ai lu avec les prisonniers.
D. : Y a-t-il d’autres références littéraires et philosophiques qui ne sont pas mentionnées mais qui vous ont inspiré pour ce film ?
T.H. : C’est naturellement Brecht qui joue le rôle le plus important. Je pourrais aussi évoquer mon travail de mise en scène théâtrale dans les années 1990 au Berliner Ensemble, autour de Heiner Müller ou Fritz Marquardt. Sans oublier Buñuel. Mais à vrai dire, je ne peux pas vraiment désigner très précisément ce qui m’a été utile pour ce film. Ce n’est en tout cas pas le premier, ni l’unique travail que je fais dans lequel des détenus jouent un rôle, même comme image de quelque chose d’autre. Mon tout premier film sonore, réalisé en 1980, s’appelait « A quoi bon un film sur ces gens ? » (Wozu denn über diese Leute einen Film ?). Cela parlait de deux petits délinquants. Dans les années 1980, cela avait suscité beaucoup de colère, à l’école de cinéma. C’est peut-être la raison qui m’a poussée à m’entêter dans cette direction. Les périphéries pulvérisent le centre.
D. : La photographie en noir et blanc a dans votre film une qualité particulière, avec des contrastes précis et une lumière douce. J’avais l’impression que l’horreur de la prison se diluait dans cette douceur de la lumière. Etait-ce bien l’effet recherché ?
T.H. : Une prison est le miroir de la société du dehors, et contient tout ce que la société contient. On peut aussi voir à l’intérieur de la prison des images séduisantes de par leur quotidienneté. Comme le va-et-vient d’Arturo, pareil à une panthère, dans la cellule, ou le repos des parents auprès de leurs enfants, le jour des visites, dans la cour de la prison. Ou encore le campement et les repas en commun dans l’Aera Verde, qui fait aussi partie de la prison. Lors des jours de visite, je voyais toujours cette scène : des fils posant leur tête sur le giron de leur mère, laquelle veillait sur eux ; une beauté paisible et douce. Les enfants jouaient là tout naturellement au milieu des familles, et chassaient les canards qui se baladaient en se dandinant.
À la libération d’un des garçons, Oscar, la caméra reste dans la prison. Un autre détenu, profondément déprimé, est alors accroupi dans la cour, et un autre vient vers lui, lui pose la main sur l’épaule avec compassion, pour le consoler. Ce genre de choses m’a beaucoup impressionné. Le noir et blanc permet alors de produire une impression d’universalité. C’était ce que je souhaitais atteindre.
D. : Etes-vous nostalgique du cinéma en noir et blanc ?
T.H. : « Simplicité, sans bigarrure », dit le peintre d’icônes Andrei Roublev. Cela ne veut pas dire que les couleurs soient exclues sans appel. Il ne s’agit pas d’une nostalgie ou d’un sentiment, mais d’un travail pratique à effectuer, et d’une clarté à donner.