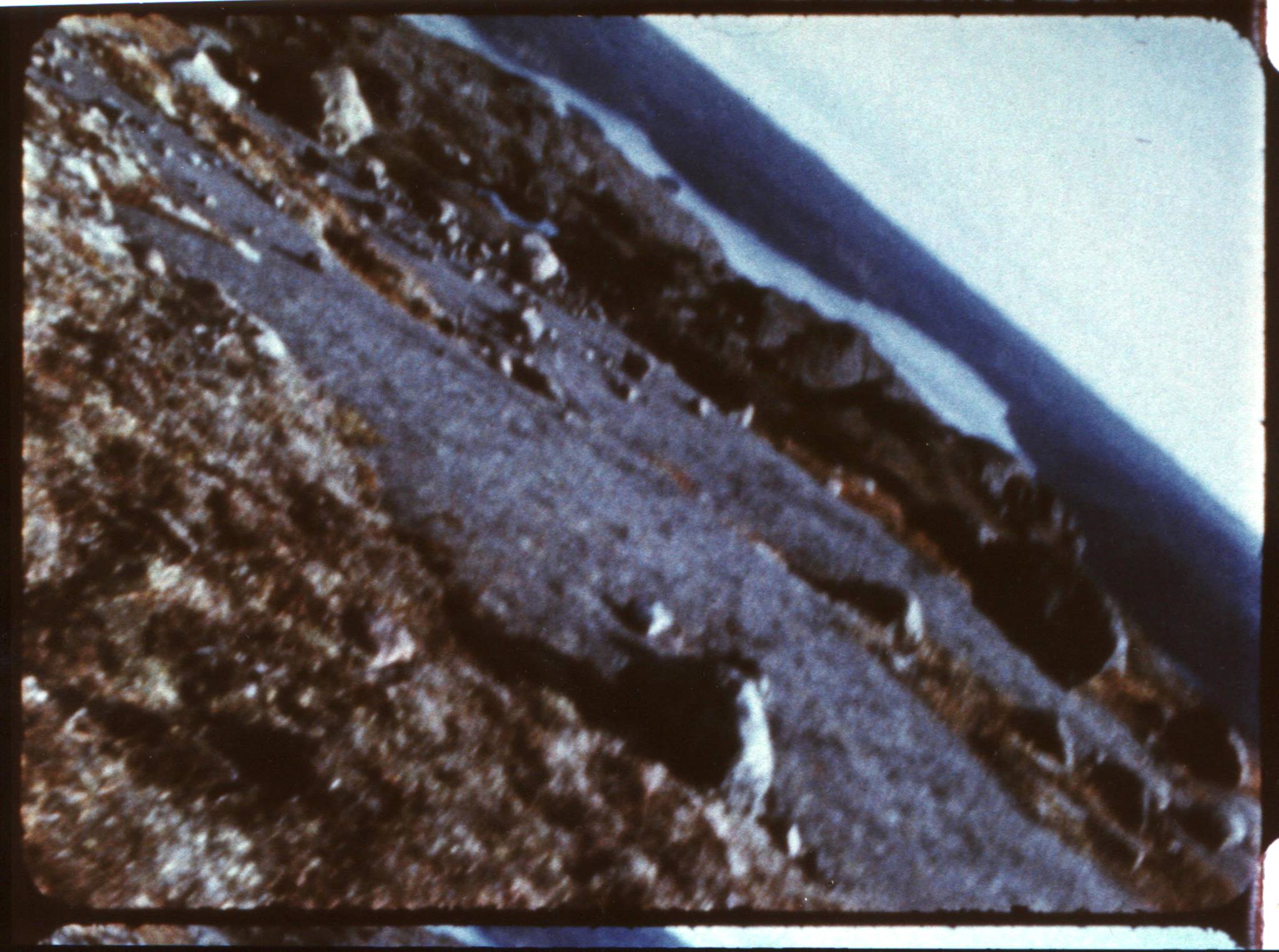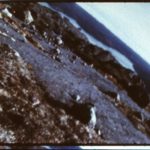Etats généraux du documentaire, 2015
Colonies, utopies
L’ADN de Lussas a tout d’une anomalie au regard du génome habituel des festivals. Logé dans un petit village ardéchois, rétif à toute compétition, abritant des spectateurs au profil moins pincé qu’ailleurs, il est aux antipodes de tout les raouts tapissés. Trois éléments de son décor pourraient lui servir d’armoiries : les tentes, les tables et les salles. Les premières s’alignent dans la plus parfaite égalité, à l’encontre de tout partage spatial. Les secondes bourgeonnent un peu partout dans une belle liberté anarchique. Et la disposition des troisièmes optimisent les conditions d’un dialogue fraternel. La République serait peut-être à réinventer dans de telles enclaves utopiques, où la seule loi qui règne est celle de l’exigence du regard.
C’est pour restituer un peu de l’atmosphère émancipatrice de ces Etats généraux du documentaire où se projettent les doléances du monde que nous avons écrit ce texte à plusieurs. Ont participé à sa rédaction Gabriel Bortzmeyer, Quentin Brayer, Florence Malfatto, Maxime Martinot, Camille Polet, Philipp Stadelmaier. Mais y sourd aussi, bien sûr, l’écho de toutes les conversations que nous avons pu avoir avec ceux qui ont bien voulu lever le coude avec nous lors de cette irénique semaine.
***
Ce qu’il reste de la folie, de Joris Lachaise.
D’abord, il y a la blancheur aveuglante des murs d’un hôpital. On cherche à y enfermer un corps qui résiste, happé par l’ombre d’une cellule dont la porte se referme. Un homme regarde désormais le monde à travers une fenêtre étroite aux barreaux de fer. Il supplie et il crie. Il regarde. Il y a dans son regard quelque chose de très vivant, qui ne se livre pas.
C’est un voyage halluciné que celui de Joris Lachaise dans les méandres d’une institution psychiatrique de la proche banlieue de Dakar, univers médical rendu poreux par l’Histoire aux influences sorcières, maraboutiques, prophétiques. À l’époque où en France s’ouvrait la clinique de La Borde, où les écrits de Frantz Fanon commençaient à lier psychiatrie et question coloniale, le neuropsychiatre Henri Collomb fondait, au Sénégal, l’hôpital de Thiaroye, à quelques kilomètres de la capitale. C’était en 1958.
Joris Lachaise s’est rendu là, pour questionner les rémanences, les héritages éminemment politiques de la question de la folie en territoire post-colonial. Joris Lachaise s’est rendu à Thiaroye en ethnographe, armé d’un appareil conceptuel exigent, scrutant le paysage contemporain des maladies mentales sur une terre irriguée de magie. De Thiaroye, Joris Lachaise a ramené un film. L’intelligence de ce dernier est à ce point dépourvue de vernis théorique que l’on ne peut que s’étonner devant l’étrangeté de ce matériau incarné, brut, porteur d’une singulière violence.
Violence des visages saisis de près, de si près que le filmeur pourrait toucher et être touché, repoussé, refusé. Violence du sang de cette chèvre sacrifiée (dès les premières minutes du film), gorge tranchée, au sol, le sang jaillissant sur la terre, et sur le corps d’une femme malade – dans la transe rituelle des Lébous, peuple de pêcheurs par qui fut en son temps peuplée la ville de Dakar. Violence de la possession des corps par ce prêtre exorciste entré clandestinement dans les murs de l’établissement, profitant de la négligence ou du sommeil d’un gardien. Violence de la parole d’un adolescent, saisie au détour d’un couloir, prenant la caméra pour tribune, exhortant le filmeur blanc (et par-delà lui tout un peuple) à se pencher sur l’histoire des esclavages physiques et mentaux. Violence à son tour du geste du filmeur, caméra tournée face au mur, dos à celui qui parle, résistant au regard magnétique de l’autre jusqu’à ce que la tension cède, et qu’arrive, hors-champ, un troisième homme, brisant le cercle de la parole
À Thiaroye, il n’y a pas de division qui tienne. Pas de pertinence, non plus, à vouloir distinguer (strictement) le legs de l’Occident colonisateur de celui du territoire colonisé, la psychiatrie institutionnelle des pratiques coutumières de soin. Les patients et les autres – soignants, accompagnants de l’hôpital – sont donnés à voir dans la même mesure, avec sagesse. De fait, le geste filmique de Joris Lachaise n’isole ni ne sépare. Il saisit de front, et dans le même mouvement, la médecine et la transe – maraboutique, évangélique, prophétique. La part de la folie et celle de la raison. Ces facettes voisines, paradoxales, de l’hôpital se heurtent, se transforment, se mélangent jusqu’à former un univers complexe, dense, cohérent. Le montage met en rapport les situations de soin psychiatrique et les pratiques traditionnelles (possessions, exorcismes), qui dessinent un récit quotidien de la vie à Thiaroye.
La caméra vit, fragmente, est aimantée par les visages, les objets. Elle est l’interface, le lieu où se rencontrent, se confrontent, se (re)connaissent les corps et les êtres. Jean Rouch soutenait que la présence d’une caméra suffisait parfois à créer les conditions d’une possession qui, dans le seul réel, n’aurait pas existé. Transe du filmeur et transe du filmé. On dirait qu’à Thiaroye aussi, la caméra est porteuse de cette fièvre, qui contamine l’écran, dont le filmeur est moins le témoin que le mage, l’acteur. Comme dans ces tableaux de famille où l’on devine, par un effort de l’esprit, les traits rattachant un visage à chacun de ses ancêtres, le film dessine les contours d’une réalité double qui ne cesse d’être unique.
Sous le signe de la dualité, également, s’inscrit la trame du film. Le personnage central de l’histoire, Khady Sylla, se trouve être à l’écran le double du filmeur – inscrit en négatif derrière l’image. Cinéaste, écrivaine, internée au sein de l’institution, Khady Sylla, porte au cœur du film une parole, une distance critique, une contradiction fondamentale. Elle soulève un questionnement structurel, politique, symbolique, examinant les névroses modernes d’un pays traditionnel en proie au développement urbain.
À Thiaroye, les patients ont coutume de venir accompagnés d’un membre de leur entourage. Khady Sylla fait le choix de venir avec Joris Lachaise. Patiente et analyste – de ceux qui pensent et qui souffrent à la fois -, Khady Sylla énonce, au long du film, les lois qui peuplent les murs de Thiaroye. Assise devant le bureau du psychiatre, elle dit le caractère sacré, prémonitoire de ses rêves. Elle dit sa propre maladie, qui semble sans cesse échapper à l’institution. Assise dans la cour du peintre Joe Ouakam, pleurant, elle acquiesce en silence à cette assertion ultime – que la folie n’existe pas.
Et c’est peut-être cela, à la fin, qui constitue l’objet du film. Ce qui – de quelque côté qu’on le prenne – échappe à l’hôpital, aux traitements, aux interprétations, à l’enfermement des corps et des âmes. Ce quelque chose-là, infime et résistant, brillant dans les yeux de l’homme enfermé derrière une fenêtre étroite, aux barreaux de fer. Cette zone d’opacité, gisant en chacun de nous – ce qu’on ne peut détruire ou éradiquer, longtemps, bien longtemps après que la folie a disparu.
F.M.
***
***
Le Griot du métal d’Ata Messan Koffi, et La Mort du dieu serpent de Damien Froidevaux.
Une soirée du plein air couplait deux films fonctionnant en miroir. Un court, Le Griot du métal d’Ata Messan Koffi, un long, La Mort du dieu serpent de Damien Froidevaux. Les deux prennent place au Sénégal, les deux aussi marquent un pas, ou un point, dans l’interminable décolonisation de la pensée que réclamait Frantz Fanon il y a déjà un demi-siècle. Le premier s’attache à Meissa Fall, mi-ferrailleur, mi-artiste, ou plutôt artiste-ferrant composant des statues de métal qu’il colporte à travers Saint-Louis. Film en deux parties : l’une montrant l’homme à l’œuvre, l’autre en exposant les fruits – les deux terriblement fortes. Beauté du moment où Fall déclare aspirer à l’universel, désireux que ses productions, aussi proches de la statuaire africaine que des effigies modernistes d’un Giacometti ou d’un Brancusi, puissent valoir pour chacun plutôt que de se contenter d’une validité locale, folklorique. La critique de l’universalisme occidental a été faite de longue date, sans, il est vrai, avoir été pour autant réellement actée ; ont été révélés ses abouchements avec l’impérialisme, et on a pu, face à cette norme asphyxiante, valoriser l’ancrage et la puissance des singularités. Mais le geste est ici pourvu d’une autre ampleur, puisqu’il réclame l’universalité de ce qui naît dans une des régions les plus satellisées du monde. Geste de réappropriation, reconduit par une seconde partie se faisant remake critique des Statues meurent aussi de Marker et Resnais : même scénographie de statuettes se détachant sur un fond noir, sinon que la voix-off ne tonne plus contre l’épinglage entomologiste de la culture africaine par la science européenne, mais dit la colère sourdant des figurines, annonce une sortie de la grande nuit et la reconquête du soi via les armes de l’autre. Dire en français la rage sénégalaise, c’est aussi revendiquer une émancipation par les moyens mêmes de ce qui causé l’assujettissement colonial.
Damien Froidevaux faisait quant à lui dire dans la langue locale la gêne du Français débarqué en terre à la fois étrangère et familière. Son film s’achève par le récit d’un conte africain métaphorisant la relation que, cinq ans durant, il a entretenu avec Koumba, Sénégalaise ayant grandi en France mais qu’une négligence administrative a forcé à un pseudo-rapatriement dans le village d’où venait sa famille et qu’elle-même avait si peu connu. Le film narre ces cinq ans d’exil, le calvaire d’une femme particulièrement dégourdie, mère précoce survivant tant bien que mal dans un environnement qui la prend pour une blanche quand l’Etat français l’avait taxée d’Africaine. Les vertus de La Mort du dieu serpent sont nombreuses – brillant sens visuel, position de suivi joliment tenue, intelligence narrative, pour ne citer que les principales. On en retiendra surtout deux : un certain contractualisme à la base même du film, échangeant une présence (celle de Koumba, ô combien énergique) contre une assistance (de Froidevaux, cherchant vainement à inverser la procédure d’ostracisation), et rappelant l’économie de troc à la base de l’éthique documentaire ; une permanente mise en défaut de la position du cinéaste, toujours à la remorque de son personnage qui n’est pas loin de le considérer comme un boulet, toujours encombré, encombrant, conscient de l’hostilité larvaire des alentours et peu enclin à s’arroger une position de toute-puissance visuelle ou intellectuelle. Froidevaux a pris le parti d’intégrer à son film tous les moments témoignant de son embarras, de l’inévidence aussi de son projet, et c’est là que réside la principale beauté du film, dans cette crise de la position du filmeur qui est identiquement, ou analogiquement, crise de la conscience occidentale et coloniale, cessant pour l’occasion de s’arroger le droit à la compréhension et à l’ingérence qui s’en déduit.
G.B.
***
***
Little Ego Girl, d’Eliane de Latour
Des corps lascifs, allongés n’importe où, dans la rue ou dans des chambres minables. Des peaux brûlées, abîmées, marquées, blessées, et des regards tristes. Des femmes maquillées qui attendent, entourées de tissus aux multiples couleurs. Ce sont les Go (prostituées) d’Abidjan filmées par Eliane de Latour. Little Go Girls est constitué de deux parties. La première s’attache à la vie quotidienne, filmée essentiellement sous l’angle de l’attente. La seconde relate le projet venu à la réalisatrice durant le tournage de la première partie : acheter une maison afin que les filles puissent s’en sortir, apprendre un métier, ne plus dormir dehors, dans un bidonville ou dans des hôtels miteux.
Eliane de Latour filme ses filles comme un territoire à explorer. Ce sont des saintes, des madones, des putes et des mères. Des images, pas des personnages. Des tableaux vivants de personnes vivantes mais mortifiées dans leur posture iconique. Baignées de couleurs irréelles, les corps ne bougent presque jamais (sauf peut-être lorsqu’une main au fond du plan se tend pour une cigarette). Des statues qui respirent. Vingt-quatre photos possibles par seconde. Le film s’ouvre justement sur la série de photos qui a donné l’envie à la réalisatrice de faire le film. Les regards défient l’objectif, les couleurs crachent et les corps disent ce qu’ils ont à raconter : la misère et la colère. Puis, viennent les images animées, excroissances des photos, rappelant qu’il y a une autre femme derrière la caméra, très bavarde. La réalisatrice parle sans arrêt, expliquant son projet, son regard sur les filles, mettant en avant son « je ». Les filles, elles, fument sans parler, murmurent des choses inaudibles, ou encore leurs paroles ne sont pas sous-titrées. Si bien que les Go deviennent un prétexte : le film censé relater leur émancipation raconte finalement l’inverse, leur capture par une créatrice.
Ironiquement, le film finit sur une pirouette : les Go, enfin plus ou moins sorties d’affaire, engagent des petites bonnes de treize ans, perpétuant un système d’oppression et d’exploitation. La réalisatrice s’en amuse alors que le film lui-même est en prise avec un mécanisme similaire, l’émancipation se faisant sous la coupe d’une blanche friquée. Il est troublant de voir comment le film, parti d’une volonté de sauver des êtres objets d’un véritable amour (quand bien même maladroit), débouche sur un projet presque néo-colonial – non par idéologie mais, tout simplement, par omission de l’Autre. Sûre de se situer du bon côté, la réalisatrice file droit, sans jamais, par exemple, s’interroger sur ce que peut signifier pour ces filles « se ranger ». Et plutôt que de les regarder, elle les rêve. Si elle les avait vraiment regardé, il y aurait peut-être eu altercation, discussion tout du moins. Mais il n’y en pas parce qu’Eliane de Latour ne parle pas d’elle en tant que sujet confronté à un réel, mais en tant que sujet prenant en main le réel selon sa bonne volonté.
Q.B. et C.P.
***
***
Une jeunesse allemande, de Jean-Gabriel Périot.
Dans Une jeunesse allemande, Jean-Gabriel Périot retrace l’histoire de la RAF (la Fraction Armée Rouge ou « Groupe Baader-Meinhof »). Cette généalogie du célèbre groupe militant (voire « terroriste ») d’extrême gauche allemand des années 1970 comprend et la période du temps d’avant la constitution du groupe (les mouvement d’étudiant des années 1960) et celle d’après. Périot aborde son sujet via un montage constitué exclusivement d’images d’archive, en se servant, d’une part, d’extraits de films militants réalisés, entre autres, par des membres du groupe (Holger Meins surtout, d’abord étudiant à l’école de cinéma à Berlin, et s’étant de plus en plus radicalisé vers la fin des années 1960) et d’autre part, majoritaires, des images de la télé allemande de l’époque.
Une jeunesse allemande est donc un film de montage. Mais celui-ci ne fait jamais s’affronter les images entre elles pour provoquer des chocs ou des dissociations temporelles ou sémantiques, et se contente de trouver des agencements fluides et un rythme convenant qui les relient de façon homogène et linéaire. Mises à plat de cette façon, elles servent uniquement de porteuses aux discours, aux commentaires oraux qu’elles contiennent : soit une voix off déjà intégrée s’emploie à diriger le spectateur (les reportages télé, les films militants), soit les images hébergent les discours (talk-shows, interviews, films militants). Le film ne tient que par ces paroles qu’il présente une par une, mais qui ne sont pas les siennes, aucune voix off n’ayant été ajoutée. Une jeunesse allemande ne prend jamais parti, ne crée pas de rapports à et n’a rien à dire sur la RAF – il ne fait que répéter ce qui a déjà été dit à son sujet. Ce qui amène deux conséquences.
Premièrement, il semble que Périot ne s’intéresse pas tellement aux propos sur la RAF qu’il a trouvés dans ces archives. Et cela a un drôle d’effet : son film ressemble plutôt (du moins pour une oreille allemande) à un examen du son, du timbre de la langue allemande des années 1970, avec son caractère dur, littéraire, précis, sévère – cette façon de prononcer et d’articuler avec une exactitude écrasante. Il suffit de regarder les débats télévisées avec Ulrike Meinhof alors qu’elle était encore éditorialiste au magazine de gauche Konkret. La bataille n’est pas seulement entre une marxiste et des réactionnaires (mâles, vieux, méchants), mais surtout entre des mitrailleuses rhétoriques tirants leurs balles langagières avec une précision absolue ; bataille dont l’intérêt réside moins dans les partis pris idéologiques que dans la façon dont ils sont articulés, prononcés.
Deuxième conséquence : si le film est bien l’examen de l’allemand des années 1970, c’est aussi l’examen de la langue du téléspectateur allemand d’antan, de son commentaire, de son jugement sur ce qu’il voit. Si Périot présente les images dans un chronologie linéaire identique à celle dans laquelle elles étaient vues à l’époque à la télé, c’est aussi pour évoquer ce spectateur à qui ces images et ces commentaires in ou off étaient adressés. En prêtant l’oreille aux voix off qui commentent les images, aux modérateurs des infos ou au chancelier Helmut Schmitt condamnant le détournement d’un avion Lufthansa en 1977, on peut presque entendre les paroles indignées du petit bourgeois allemand devant son poste de télé. Par contre, le spectateur d’aujourd’hui revoit ce qui a déjà été vu, juge ce qui a été déjà jugé et, par conséquent, aura déjà jugé lui-même sur le jugement des spectateurs d’antan (ses commentaires, ses paroles devant ces images). Le fait nu que « ça » a déjà été vu permet donc une « révision ». Mais celle-ci propose la pure possibilité de commenter autrement, de changer de discours sur les images, sans que Périot suggère à quoi ce changement – cette révision – pourrait ressembler. Que faire aujourd’hui devant le discours officiel des allemands post-nazis qui se défendent contre les terroristes dont la lutte anticapitaliste leur fait penser aux Nazis (discours de la télé) ? Ou devant les films militants de Meins et compagnie dont le pathos révolutionnaire et la verve dénonciatrice les poussent jusqu’aux chiottes où l’on se torche avec un poster de Che Guevara ? On sent qu’il s’agit peut-être moins d’une révision politique, mais tout simplement drôlatique : à Lussas, la salle a beaucoup ri devant les mitrailleuses rhétoriques que Périot a sauvé de leur silence. C’est peut-être aussi un peu la limite de son entreprise.
P.S.
***
***
Romy, anatomie d’un visage, de Hans-Jürgen Syberberg et Suspendu à la nuit d’Éva Tourrent.
Deux films joueurs, d’une grande ambition mais au matériau simple et lisible, auront créé un rapport privilégié entre personnages et spectateurs. Le premier, Romy, anatomie d’un visage de Hans-Jürgen Syberberg (1967), filme Romy Schneider à la demande de l’actrice. Le drame bien connu de Romy fut de se sentir soumise au star system, enserrée dans la boucle qu’elle avait elle-même nouée. C’est lors de vacances dans les montagnes bavaroises que la caméra de Syberberg va sonder le quotidien hors-travail de la star, pour manifester avec profondeur une violence psychologique pour le moins inattendue. Les confessions de Romy alternent avec les moments légers de ski. La blancheur du site et de sa combinaison réduisent le visage de l’actrice à son dessin le plus simple, dénué des apparats de la fiction. Et c’est avec ce visage qu’elle exprime, lors de longs épanchements et avec le recul du sage comme la vivacité nostalgique de l’enfant, toute la douleur qu’il y a à porter un masque. Mais la perversité dissimulée de Syberberg amène le film à révéler que la réalité de la vie des stars n’est jamais que la copie des fictions qu’elles ont nourries. Chose signalée dès le premier plan, d’abord énigmatique puis drôle par son étirement, qui montre le valet dressant l’infini attirail du petit déjeuner de Romy, devant le paysage idyllique des montagnes blanchies. Romy, dès lors qu’elle est soumise à l’œil d’une caméra, reste dramatiquement Sissi.
Un deuxième film, lui aussi très enneigé, accueille dans son mouvement têtu un personnage comme essoufflé, fatigué par la grise neige qui l’entoure et qui constitue la matière de son travail. Dans Suspendu à la nuit, Guillaume sillonne la montagne et les pistes de ski nocturnes, le corps tassé dans son chasse-neige ; sa soeur Éva Tourrent, la réalisatrice, le suit dans un périple quotidien envahi par le froid. Malgré sa brièveté, le film maintient le spectateur dans une attente, une position propice à scruter son protagoniste et la matière qui l’environne : la neige ne fait pas ici office de révélateur comme dans Romy, au contraire elle cache, embrume, soustrait l’espace à ses repères. Le doute emplit le tissu du film tant la tension du lieu comprime son personnage. Par des lumières et couleurs toujours proche de l’extinction, et une ambiance sonore emmitouflant la perception dans le très proche, le fantastique s’invite dans l’espace documentaire. Le film sillonne un lieu aveugle, empire où règne en toute intensité le doute sur les choses du dehors. À l’intérieur d’un territoire vaste mais limité, Guillaume et sa machine poursuivent leur gravitation nocturne, reliés par un câble tendu à un piquet, lui-même caché par la neige et profondément enfoncé dans le sol. Le film semble s’agréger autour de ce piquet, notre seul repère, pieu planté dans une carte sans lignes, et qui demeure effrontément invisible.
M.M.
***
***
Homeland : Irak année zéro) d’Abbas Fahdel.
Un événement dont l’onde se propage encore de festival en festival fit halte à Lussas : Homeland : Irak année zéro) d’Abbas Fahdel, film en deux parties pour une durée totale de près de cinq heures trente. Film à la finition retardée et dont l’écho est d’autant plus troublant : Fahdel était parti retrouver sa famille irakienne, qu’il n’avait pas vue depuis ses dix-huit ans, quelques mois avant l’invasion américaine de 2003 ; par malchance, il est rentré en France juste avant le déclenchement des hostilités, et est revenu filmer deux semaines après la conquête. Les rushes sont restés dix ans dans un tiroir, parce qu’un de ceux qui y étaient le plus présent, Haidar, neveu d’une douzaine d’années, a trouvé la mort au hasard d’une fusillade alors qu’il trônait sur le siège arrière d’une voiture à côté de son oncle cinéaste. Dix ans, c’est le temps de deuil qu’il a fallu pour oser affronter les images de ce garçon sémillant, bavard avec bonheur, qui, mort, est devenu la colonne vertébrale d’un film qui est aussi son tombeau (les dernières images sont celles de sa sépulture) ; c’est aussi le temps qui nous sépare d’un événement qui ouvrit l’âge au cours duquel « l’antiterrorisme » devait devenir la méthode de gouvernement par excellence, et où la France résistait encore à cette fausse raison sécuritaire avant de prendre le pas comme toute bonne nation impérialiste. De là l’étrangeté de ces images nous rappelant à une cause doublement perdue (marquée par l’échec, puis oubliée).
La première partie narre une attente oscillant entre angoisse et espoir, entre la peur d’un enlisement guerrier et l’excitation à l’idée d’être enfin débarrassé de la clique baasiste. Scènes privées pour l’essentiel, interdiction de tourner oblige ; le film adopte la forme d’un diarisme familial à l’occasion agrémenté de sorties en voiture, notamment aux côtés de la superstar irakienne Samir Kaftan. Ou comment figurer la politique par son négatif, c’est-à-dire allégoriser sa privation : l’impossibilité visuelle d’une scène commune dit assez la dissolution de l’espace public en régime dictatorial (à la place, les émissions saddamolâtres que la télé passe en boucle, avec tout le kitsch esthétique d’une telenovelas). La seconde partie montre un peuple qui déchante après sa supposée libération par une armée qui, quels que soient ses airs de sauveuse, ne peut pas ne pas avoir l’arrogance de la conquête ni les bavures du pouvoir. Pour principal changement, le déliement des langues et l’émancipation de la caméra. Le cinéaste peut enfin sortir de son confinement domestique et parcourir les rues pour observer les ratés de la libération : telle personne subissant la vindicte indue des pouvoirs en place, telles destructions « accidentelles » par des bombardements compulsifs et qui laissent les populations sans abris, telle insécurité générale en raison de l’anarchie entretenue par des gangs nouvellement essaimés. Centralité des dommages collatéraux. Le film laisse une belle place, glorieuse même, à ceux qui pour n’être d’aucun côté subissent les feux croisés des factions en désordre. Une des plus belles scènes montre une manifestation d’Irakiens soulevés contre l’occupation illégitime d’une armée qui, au nom de sa propre sécurité, met en suspens la sûreté de chacun. Et une autre, centrale, consiste en une visite des studios de cinéma ravagés par les bombes, studios qu’autrefois jalousaient tous les pays voisins et qui ne sont plus que cendres dans lesquelles disparaît tout un pan de la mémoire nationale. Toute cette seconde partie est construite sur une telle dialectique de la mémoire, montrant d’un côté l’arasement historique qu’entraîne une invasion méconnaissant les us de ceux qui, « libérés », n’en sont pas moins maintenus dans un statut de vaincus, de l’autre les remontées d’une mémoire interdite pendant les heures d’Hussein : celle de ceux qu’il a persécutés, effacés, et dont les noms et les visages reviennent sous forme d’affichettes collées un peu partout – comme si la seule vraie libération était celle des morts sortant enfin d’un silence qui aggravait leur disparition.
La référence du titre à Allemagne, année zéro de Rossellini n’a rien de gratuite. Les deux cinéastes ont partagés un même problème – comment raconter un pays enseveli sous les décombres – et une solution similaire – prendre le prisme de la famille, voir les événements se réverbérer sur les vies de quelques êtres. Ce qui fait que le meilleur observatoire de l’irrémédiable altération est une voiture depuis laquelle sont filmés une très grande partie des longs plans du film, comme s’il était besoin d’une vitre pour refléter le changement. L’autre point commun avec le maestro italien, c’est l’enfant comme crucifié de la guerre. Seulement, le petit Edmund optait pour un grand saut dans le vide signifiant la fin de tout suite à la déraison du monde, quand Haidar, lui, est tué par une balle qu’on imagine perdue – toute la différence de deux destins nationaux, entre l’autodestruction et l’assassinat géopolitique. Restent les autres enfants, nombreux dans le film, vraies machines à regard-caméra. On se souviendra d’une scène dans laquelle une flopée de bambins s’empare de différentes munitions traînant sur le bas-côté, et les dénomme une à une devant le cinéaste. Est sensible, dans le regard de celui-ci, toute l’inquiétude amoureuse qu’il porte à ces enfants, et qui fait que, chose rare, ces multiples plans sur l’innocence du jeune âge ne tombe pas dans la mièvrerie qu’ils encouragent généralement. Grande vertu de Homeland que sa retenue sans prétention, dans laquelle la tristesse fait taire l’indignation vertueuse et opte pour le mutisme du regard désolé.
G.B.
***
***
A propos de Michael Snow.
L’équation matière-récit aura trouvé son moule idéal dans les films de Michael Snow, dont la dernière journée du festival offrait une rétrospective de six films. Rarement mouvements ou cheminements scopiques auront été si lents et pourtant si tendus, si habités, si pleins d’un sens inouï de la surprise. Wavelength (1967) est un zoom optique d’une quarantaine de minutes, avançant par intermittences vers une photographie perdue au milieu d’une vaste pièce. Le plan, découpé en plusieurs phases et intercalé de surimpressions colorées, accroche l’attention à cette photographie, ciblée en plein centre du cadre mais restant longtemps indiscernable. Il faudra bien une trentaine de minutes pour parvenir à voir sur la photographie l’image de la mer, à force de scruter l’espace à la recherche d’indices. Breakfast (Table Top Dolly) (1972-76) montre une table dressée pour un petit déjeuner tournée en nature morte. La caméra entame un travelling progressant imperceptiblement, jusqu’à ce qu’elle se mette à toucher et malmener la matière de cette peinture devenue mouvante, puis écrasée, mâchée. See You Later (Au Revoir) (1990) voit Michael Snow sortir d’un bureau reconstitué en studio. Le geste, filmé dans un suivi pano-travelling, est en soi très simple ; son mouvement réel n’a pas duré plus de 30 secondes. Au montage, le ralentissement extrême du plan afin qu’il dure dix-huit minutes a permis de décomposer le mouvement à la manière des chronophotographies du pré-cinéma. Mais l’attention au décor, à la lumière, aux apparitions et disparitions de nouveaux éléments rend chaque fragment gestuel surprenant, parfois même burlesque. Chez Snow, la surprise ne naît pas de l’action, de la narration : elle est d’abord rendue sensible par la variation lumineuse, par des changements subtils, comme si tout mouvement lent offrait au monde les vertus exponentielles de sa pauvreté. Chacune de ses œuvres est une expérience sensuelle unique. Le film joliment intitulé <____> (Back and Forth) (1968-69) relève même de l’érotisme. Érotisme dont on aurait retiré le nu et les organes pour y suppléer par les frottements des variations de lumière. La caméra forme ici un panoramique gauche-droite / droite-gauche, répété dans un rythme changeant d’une bobine 16mm à l’autre. Des butées, calées de chaque côté de la caméra, limitent ses mouvements dans un « cadre » défini ; l’étonnement naît d’entendre la caméra s’échouer à chaque fin de mouvement sur ces butées, transformant le trajet lumineux en rythme sonore. À la fin du film, le rythme devient extatique, ne se contrôlant presque plus, tant sa célérité a atteint une dimension inhumaine : le mouvement manuel a épousé le trajet des forces scopiques.
La Région centrale (1970-1971) exalte à un degré autrement sinueux cette mystérieuse sensualité. Le travail de la matière sensible se donne pleinement à voir dès le premier plan, que l’on peut tenter de déplier dans son déroulement :
le regard tient son axe dans une verticalité effrontément tendue vers le sol. Jonché de pierres grises, or et brunes issues de ce désert du nord Québec, ce sol rugueux ne se tient pas à plus d’un mètre cinquante de nous. L’axe du regard bouge depuis le début, lentement. Les pierres se multiplient, et celles qui ont été radiographiées avant par notre regard s’oublient dans un hors-champ que le bas du cadre n’aura de cesse d’investir et de perpétuer. Glissant vers une direction gauche-haut, le vertical ploie déjà, balance sa quête vers l’horizon. Nous apercevons brièvement l’ombre de la tête de la caméra dessinée par le soleil. Cette caméra est fixée sur un double bras articulé avec des bascules, lui-même fixé sur un pilier rotatif enfoncé dans le sol. Ce sera sans doute la seule partie de l’espace que nous ne verrons jamais durant tout le film. La caméra-corps, la caméra-lieu comme angle mort.
Alors, le bout du paysage laisse enfin entrevoir le ciel : l’horizon est localisé. Sauf que, en pleine montagne rocheuse, la ligne horizontale devient anarchique. D’un côté, le lac au loin projette cet horizon très bas ; mais de l’autre, il s’élève et s’aplatit sur des blocs de roches striés, situés tout près de notre caméra-corps. Puis le ciel devient le vide dans lequel le regard se perd : la caméra balaie l’éther comme elle balayait le sol, mais cette fois sans autre repère que les nuages à plusieurs centaines de mètres au-dessus. Le mouvement se perçoit désormais dans une incertitude croissante. Mais d’une chose nous devenons certains : d’avoir parcouru un trajet optique composé d’une seule ligne, dessinant dans l’espace tri-dimensionnel ce qui ne peut être qu’un globe : un œil. Un œil est né, tissé de lignes de mémoire. L’œil unique et physique de la caméra s’est multiplié dans le temps, dans toutes ses phases et forces cinétiques.
Dans un montage durant encore deux heures et cinquante minutes, composé de plans allant de une à dix minutes, la caméra reste toujours sur le même axe rivé dans le sol québécois. Le film continue à défier la gravité, à sillonner l’ensemble déquadrillé de ce paysage. Aucun animal ne se manifeste. Le jour tombe et la nuit règne pour un court moment. Le soleil renaît, les mouvements de caméra et segments de plans oscillent. Le panoramique n’est plus une glissée organique comme dans le premier plan : les nombreuses variations de direction et de vitesse font tourner la caméra sur elle-même, malmènent l’horizon jusqu’à ce qu’il s’échancre complètement. Dans la lignée de <____> (Back and Forth), la lumière devient trace de couleurs se métamorphosant sans repos, quand la caméra entame la danse d’un rythme insoutenable. Mais seule, la lumière persiste, et sauve le lieu de sa radiation cruelle. Et nous spectateurs de cette orgie coruscante, lessivés et étirés jusqu’au plus profond de notre tissu organique, ne sommes plus sûrs de la consistance de l’air autour, du fait physique de notre existence. La terre tremble et non de beauté : car ce qui tient de la beauté n’est pas du fait de la terre, seules la violence de la lumière et la variation du vent font trembler ce qui tient autour.
Nous, alors, ne pouvons rien ; si ce n’est reprendre le droit de marcher et nous rapprocher des sources de la lumière, du vent. Le terme de “région centrale” n’est pas directement géographique : c’est une référence à notre système nerveux central, lié à celui du système nerveux périphérique. La région centrale du cerveau reçoit l’ensemble des informations sensibles du corps. C’est un lieu de passage essentiel, à la double fonction, à la fois motrice et réceptrice : rien de plus évident pour définir le rôle d’une caméra, sa nature première et même ici étonnement première, archaïque.
M.M.
***
***
Voglio dormire con te, Matia Colombo.
Voglio dormire con te débute chez le cinéaste, Matia Colombo, dont il raconte les insomnies dues à la fin d’une histoire amoureuse. Le ton est intimiste, mêlant voix off et images nocturnes de la ville. L’un des colocataires rassemble des affaires et part en silence : nouvelle rupture. Plus tard, son ex lit un texto dans la cuisine. Il est 4h du matin, le plan fixe est serré sur son visage, elle pleure. La voix off nous apprend que durant l’Antiquité, les malades n’allaient pas chez le médecin mais sortaient dans la rue demander des remèdes aux passants. Le réalisateur suivra la même démarche, étudiant la manière dont les autres s’aiment, restant à l’affût de leur intimité pour y cueillir des conseils de guérison. Rien d’insolite. Le film est juste fait du quotidien des couples qu’il côtoie. Les séquences sont douces, dénuées de spectacle. Un couple d’hommes fait ses valises avant de partir en voyage, deux autres passent leur soirée à chercher un troisième partenaire sur internet. Une vie simple : travailler, rentrer, tenter de se parler, de vivre à deux.
Tout se déroule en intérieurs, et lorsque la caméra sort, c’est principalement pour filmer des façades. La distance à laquelle se tient la caméra contraste avec le serré des plans dû aux longues focales : manière d’être à la fois proche et pudique. Le réalisateur filme l’espace domestique comme s’il filmait un intérieur psychologique, fétichisant l’habitat, les objets (sériés dans un montage d’inserts) comme autant de marqueurs du communs, comme, aussi, points de frottements entre soi et l’autre, au centre d’un territoire partagé où il est difficile d’exister pour soi.
Le second mouvement du film consistera en une rencontre du cinéaste avec lui-même. Voulant guérir de ses maux d’amour, il réalise qu’il doit d’abord soigner sa fragilité identitaire. Un partenaire d’un soir lui demande s’il n’a pas de deuxième prénom, s’il ne s’appelle que « Matia », puis retourne la caméra vers le réalisateur. Le conflit des objectifs (Iphone versus caméra) bouleverse l’optique du film, tourné non plus seulement vers les couples, mais vers la manière dont les personnes s’y révèlent.
Le film se termine sur une petite maison sculptée dans une boîte, métaphore de l’espace dont on est sûr, de l’intimité construite. La sculptrice explique que ces petites maisons sont des endroits d’où l’on a déménagé. À la suite de cela, la rupture du réalisateur passe pour déménagement psychologique. Il doit désormais trouver un nouvel espace à habiter, une nouvelle manière d’être. Voglio dormire con te propose tellement de manières d’aimer qu’il en vient à mettre en scène la difficulté du choix et, par extension, la difficulté à être. Sa beauté réside dans la fragilité révélée par la rupture, qui lance le double mouvement sur lequel il repose : regarder l’autre pour mieux se regarder.
Q.B. et C.P.
***
***
La Sociologue et l’Ourson d’Étienne Chaillou et Mathias Théry.
Concluons avec la clôture du festival, l’ultime plein air que fut La Sociologue et l’Ourson d’Étienne Chaillou et Mathias Théry. Ce dernier est le fils d’Irène Théry, qui sabra de son discours acéré plus d’un détracteur du « Mariage pour tous » lors de la foire d’empoigne qui, trop de mois durant, obstrua la rue et les médias à grands coups d’anathèmes de cureton. La sociologue du titre, c’est elle. Le film commence avec les premières réunions à l’Elysée et s’achève une fois la loi enfin passée, parcourant entre-temps l’ensemble des séances de boxe discursive. Le but est moins d’affiner un argumentaire et d’inspecter les ramifications d’une pensée – dès le début, Mathias Théry dit à sa mère avoir besoin d’une version « simple » de son discours, de celle qui s’expose avec clarté dans le temps bref d’un film – que d’observer le battage médiatique et l’arène des positions critiques. C’est ce qu’avait fait Pierre Carles avec Bourdieu dans La sociologie est un sport de combat : moins s’intéresser à la fabrique intellectuelle qu’à ses résonances sociales et à son incrustation dans la circulation médiatique des discours. Les réflexions de Bourdieu s’y trouvait certes réduites à un vade-mecum, l’intérêt du film étant ailleurs. De même pour La Sociologue et l’Ourson : les idées importent moins que leur dramatisation conflictuelle. On est d’ailleurs en droit de se montrer réticent par rapport à l’argumentaire d’Irène Théry (récuser la norme classique du mariage hétérosexuel en en appelant à d’autres formes de normativité sociale au lieu de simplement tenter d’abolir le rapport de la loi aux mœurs pour promouvoir le simple droit comme vecteur d’une liberté trop longtemps attendue), tout en se rappelant qu’il s’intégrait dans un discours de combat, et que cette insertion stratégique exigeait quelques remaniements conceptuels et simplifications dans les rouages logiques ; reste qu’elle a bravement lutté, plus que quiconque, et avec une adresse qui force le respect.
Mais le film est plus que cela, pour être constitué de deux faces s’alternant avec un rythme captivant. La première est faite de longs plans séquences, certains virtuoses (celui, génial, qui accompagne Irène Théry lors de sa première réunion avec Hollande, depuis l’entrée du palais présidentiel jusqu’au moment où l’huissier invite fermement les cinéastes à sortir), d’autres délicieux dans leurs moqueries (les plans sur la Manif pour tous, montrant une Frigide Barjot s’époumoner pour sortir d’anthologiques âneries). La seconde repose sur les enregistrements des conversations téléphoniques entre la mère et le fils, entretiens en formes de leçon de sociologie pour le commun. Ils s’accompagnent d’un spectacle de marionnettes, souvent des peluches animées, toutes trognonnes, et qui relayent la simplicité du propos par la légèreté des mises en scène l’illustrant (ainsi d’un bref cours sur les évolutions des rapports conjugaux, reproduisant avec des petits oursons la famille victorienne puis la libéralisation des mœurs post-68). Dispositif dont le but n’est sûrement pas un gain d’intelligibilité, plutôt un renouvellement du genre satirique. Le film, bien sûr, se campe explicitement aux côtés des futur.e.s marié.e.s, et pilonne à l’envi les zouaves azimutés d’en face (souvent représentés en Schtroumpfs) ; cela, heureusement, ne génère pas pour autant de sentiment de connivence confortable, ou si peu. Seule ombre, et minime, au tableau, les attendus moments où le dialogue familial, avec la mère ou le père, permet d’intégrer dans le film le spectacle de sa fabrication et la réflexion présidant à sa mise en forme – il n’est pas sûr qu’on ne puisse faire l’économie d’une telle spécularité éculée. Autrement, La Sociologue et l’Ourson demeure un bel exemple de cet infléchissement du cinéma de combat qui semble de plus en plus enclin à faire passer la lutte dans le rire, ou le rire dans la lutte, aux antipodes de la pesanteur affligée des anciennes formes militantes.
G.B.