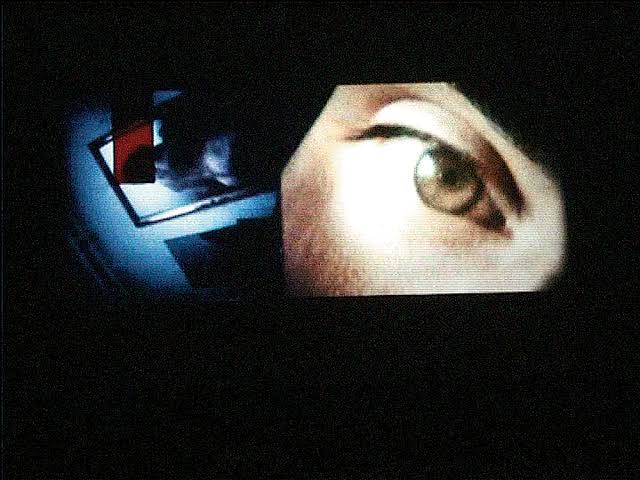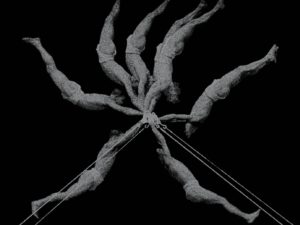« C’est donc un amoureux qui parle et qui dit : »
Sur Un film perdu de Lionel Soukaz de Xavier Baert, 2025
« Mon Dieu ! Une pleine minute de béatitude !
Fiodor Dostoïevski, Les nuits blanches, trad. André Markowicz, Babel, Paris, 1992, p. 86.
N’est-ce pas assez pour toute une vie d’homme ?… »
Pour sa clôture, le Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris 2025 a choisi de rendre hommage à Lionel Soukaz – réalisateur militant, auteur censuré, poète archiviste, pionnier du cinéma queer d’avant-garde et organisateur des premiers festivals de cinéma gay en France, décédé le 4 février dernier. Trois films ont été proposés à la projection : celui de Xavier Baert, Un film perdu de Lionel Soukaz (2025), suivi de deux films de Soukaz lui-même, La Vérité nue (2002) et IXE (1980).
L’opposition marquée entre le premier et le dernier film de la soirée suscite le commentaire. Le premier est une œuvre sans image redonnant à l’écran toute sa matérialité ; le second est une expérience d’aveuglante ubiquité, inondant notre regard d’images de manière ininterrompue pendant 48 minutes sur deux écrans distincts projetés côte à côte, non pas divisés, comme en split screen, mais entremêlés, dans une forme qu’on pourrait rapprocher du medley[11][11] Contrairement à la plupart des vidéos du film trouvables en ligne, qui ne sont en réalité qu’une superposition des deux écrans ou un seul écran, le film a été pensé pour ménager un espace au centre où les deux écrans s’entremêlent, comme ici.. Xavier Baert le concède avant la projection : « Lionel aurait détesté. Un film sur l’absence alors qu’il était un cinéaste de la sursaturation… » Aller ainsi d’une absence à un trop plein d’images adjoint plus que jamais l’expérimentation formelle à l’expérience du cinéma en tant qu’espace habité collectivement et en tant que temporalité éprouvée.
Cette opposition propose une conception dialectique de l’écran, qui remet notre rapport au dispositif cinématographique au centre de la réflexion, sans composer pour autant un lourd traité théorique. Baert, l’amant de Soukaz au début des années 2000, a réalisé Un film perdu dans l’urgence, celle de la peine et du deuil. Par sa radicalité et sa spontanéité, son film n’a pas cependant pas peur d’aborder avec son film des questions ontologiques (« qu’est-ce que l’écran ? » ou même « qu’est-ce que le cinéma ? »), ou métaphysiques (« que peut le cinéma face au deuil et contre la mort ? »).
Dans ce monologue de 35 minutes, il se remémore un film de Soukaz dont il était le modèle, La Vérité nue. Au gré de ses souvenirs, il tente de reconstruire par la parole des images qui n’existent plus, et par là même de donner une dernière consistance à ce qui fut pendant un temps leur amour. La Vérité nue n’est en réalité plus un film perdu (ce qu’il était encore lorsque Baert a réalisé son film) depuis que le cinéaste Yves-Marie Mahé l’a reconstitué après la mort de Soukaz. Mais le geste de Baert réside moins en ce que le film existe ou non qu’en la manière avec laquelle il s’essaye à le rappeler. C’est d’un geste manchot que Baert nous amène à la mémoire du cinéaste et de son œuvre, puisqu’il ampute l’écran de son contenu. L’entièreté du monologue se fait sur un écran noir, rien de plus – à l’exception d’une seule image : un autoportrait de Soukaz tiré d’IXE, son film-manifeste. Shooté à l’héroïne, en plein état de béatitude, il regarde la caméra, ou peut-être nous. Dès lors, s’installe un jeu de regard à plusieurs niveaux entre Baert, Soukaz et le spectateur. Lorsque ce visage apparaît, il est d’ores et déjà une image matricielle : il est à la fois un autoportrait de Soukaz, un souvenir de Baert, une rupture avec le dispositif formel (puisque jusque-là l’écran était toujours noir), mais aussi une réponse à notre regard qui n’avait nulle part où se poser.
Comment parler d’un film sans image ? D’absence, il est triplement question : celle de Soukaz, celle du film La Vérité nue et celle des images sur l’écran qui nous fait face. L’absence d’images plonge la salle dans une obscurité totale au sein de laquelle ne résonne que la voix de Baert, créant un espace mental à grande échelle. En même temps, le monologue opère en deux mouvements parallèles.
Ses souvenirs convoquent d’abord à l’écran l’imagination du film perdu. La précision de ses descriptions fait de ses souvenirs autant de déjà-vu qui viennent emplir fantasmatiquement l’écran devenu « abîme », comme le dirait Roland Barthes :
« L’abîme est un moment d’hypnose. Une suggestion agit, qui me commande de m’évanouir sans me tuer. De là, peut-être, la douceur de l’abîme : je n’y ai aucune responsabilité, l’acte (de mourir) ne m’incombe pas : je me confie, je me transfère (à qui ? à Dieu, à la Nature, à tout sauf à l’autre). Lorsqu’ainsi il m’arrive de m’abîmer, c’est qu’il n’y a plus de place pour moi nulle part, même pas dans la mort. L’image de l’autre – à quoi je collais, de quoi je vivais – n’est plus ; tantôt c’est une catastrophe (futile) qui semble l’éloigner à jamais, tantôt c’est un bonheur excessif qui me la fait rejoindre ; de toute manière, séparé ou dissous je ne suis recueilli nulle part ; en face, ni moi, ni toi, ni mort, plus rien à qui parler[22][22] Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Éditions du seuil, 1977, p. 16. »
Les souvenirs deviennent tableaux et les détails qu’il évoque, une fois mis bout à bout, esquissent les contours de leur amour. Après avoir planté le décor en décrivant les lieux, il décrit des sensations. La texture du sperme sur son bas-ventre après un ébat, mais aussi la chaleur du soleil sur sa peau – détails à priori anodins, donnant une corporéité aux souvenirs, notamment celui du soleil, un des exemples fondamentaux de l’affect spinoziste évoqué par Deleuze lors d’un cours à Vincennes, qu’il décrit comme la forme primaire d’« un corps extérieur [qui] agit sur le mien[33][33] Gilles Deleuze, Cours sur Spinoza à Vincennes – Saint Denis du 24 mars 1981. ». L’énonciation de souvenirs qui relèvent à ce point du sensible devient alors quasi performative.
Le second mouvement est celui de la projection de nos propres souvenirs sur l’écran. Si les descriptions évoquent des images, elles ont aussi pour conséquence, par l’usage d’affects qui relèvent de l’intime (toutes ces descriptions sensorielles qu’énonce Baert et qui relèvent d’un moment passé entre amants) d’accéder à une forme d’universel. Ayant eu la chance de voir La Vérité nue juste après Un Film perdu de Lionel Soukaz, j’ai été troublé de la faiblesse de l’écart – tout de même existant – entre le film actuel et celui que le récit de Baert m’avait permis d’imaginer.
Il existe donc dans ce film deux échelles bien distinctes entre lesquelles agissent des tensions et subsistent des porosités qu’il est nécessaire de scruter afin de poursuivre l’analyse de cette œuvre économe en représentation. Les thèmes primordiaux de l’amour et de la mort, bien sûr, qui encapsulent ce film né d’un deuil et confèrent à son sujet une portée universelle proche de celle de la poésie lyrique. Mais l’autre échelle qui intéresse Baert est celle du détail. La narration de ces moments qu’ils ont passés ensemble, de ce tournage, de ces détails intimes constitue un témoignage poignant qui si l’on s’en tient à un lexique d’analyse filmique, permet par son côté pathos une identification facile (qui donc serait incapable de s’émouvoir de l’histoire d’une personne endeuillé ?). C’est la jonction de ces deux échelles qui fait poindre cet espace au sein duquel nos propres souvenirs peuvent investir cet écran noir qui ne demande qu’à être habité.
Les mots de Baert ont cette force : ils invoquent, convoquent, provoquent la nostalgie. L’écran est vide tout autant que fantasmatiquement rempli. Toutefois à ce stade du film nous sommes habitués à ce vide, sans doute nous attendons nous à ne jamais y voir quelque chose. Le récit s’étant déjà bien développé, nous nous faisons aussi notre propre portrait de Soukaz, pourtant, le voilà qui apparaît. Sa figuration est alors une forme proche de ce que Deleuze aurait pu nommer « image-cristal », dans laquelle le temps se scinde : elle est à la fois autoportrait réel, image d’un moment produite par la personne qu’il représente, souvenir de Baert se remémorant le passé, mais aussi rupture avec le présent de la séance et le rythme ankylosant de la voix du narrateur.
Ces différentes temporalités sont soulignées par Soukaz lui-même : qui regarde-t-il à travers la caméra ? Baert, ou bien nous ? À peine ces questions se posent-elles que le portrait disparait et nous voilà replongés dans le noir à entendre les toussotements épars. Alors, nos expériences passées reviennent se superposer sur l’écran. Cette idée, Baert l’avait déjà travaillée dans Révélations en 2001. Dans ce court-métrage,il faisait apparaître le film In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000), tantôtdans sa matérialité technique, en laissant voir la piste son de la pellicule, tantôt en superposant des photogrammes en transparence de leur séquence d’origine. Ainsi, en dévoilant les dessous du film, il repliait ce dernier sur lui-même en lui accordant la possibilité de contenir en un seul écran ses propres multitudes, le contrechamp investissant désormais le champ. Le choix d’In the Mood for Love témoigne déjà d’un lien entre les possibles contenus dans un seul écran et le sentiment amoureux. Si le film de Wong permettait aux amants éperdus et perdus de se retrouver le temps d’1/24ème de seconde, c’est seulement entre nos souvenirs et l’écran que résonne la multitude des mots de Baert.
En explorant l’envers des puissances du cinéma, Baert parvient à dépasser la réalité projetée de l’illusion de mouvement. Il construit un dispositif qui inverse le trajet établi par les approches de la sémiologie du cinéma, qui considérait le film comme assemblage de signes définis en discours et produisant son effet sur un spectateur passif. Or cette approche comportait plusieurs angles morts, résumés ici par Guy Gauthier selon une formulation que l’expérience du film de Baert permet de mieux comprendre :
« Le spectateur, grâce à un ensemble de vues ou de montage (procédés qui ne peuvent être assimilés à des signes), construit un espace et un temps subjectifs. Ces projections mentales introduisent à leur manière l’énonciation dans l’énoncé. Tout se passe comme s’il y avait, dans le contenu manifeste du film, des “blancs” ou des “trous”, des éléments en tout cas qu’on ne peut décrire, dont la présence est indéniable au niveau du signifié, alors que le signifiant se réduit à quelques fragments. Pour éclairer cette situation ni toujours maîtrisée ni toujours maîtrisable, pensons au jeu des regards qui se perdent en hors-champ et que l’on pense dirigés vers des personnages qui, parfois, n’existent pas[44][44] Guy Gauthier, « Signe et signification (Recherche sémiologie du cinéma, désespérément) » dans CinémAction, 25 ans de sémiologie, n°58, janvier 1991, p. 75.. »
Le dispositif de Baert propose de mettre au premier plan ces manquements au discours constitué de la signification pure. Il permet surtout d’exacerber le déplacement, la projection du spectateur au sein même du cadre. Si l’écran noir laisse au spectateur la possibilité de l’investir à sa manière, le visionnage est-il le même lorsqu’on ferme les yeux ? L’expérience devient dès lors immédiatement métafilmique puisque passer autant de temps dans le noir, avec pour seule bande-son un monologue – et les temps de pause qu’il implique – nous pousse à parfois regarder autour de nous. D’endurer le temps de la projection bien sûr, mais surtout de remarquer plus que jamais les bruits qui habitent la salle. Un renvoi à l’aspect collectif de la séance de cinéma certes, mais surtout la création d’un espace aussi élogieux qu’élégiaque, car ce silence porte un nom : Soukaz.
Quel meilleur discours d’adieu à l’être aimé que celui qui ne l’enferme pas dans une forme ? En laissant aux images (et aux non-images) la capacité d’être multiples dans leur devenir, Baert évite ainsi l’un des pièges du discours amoureux, celui que Barthes dénonçait comme le ressassement « de perpétuels monologues à propos d’un être aimé, qui ne sont ni rectifiés, ni nourris par l’être aimé, [et qui] aboutissent à des idées erronées touchant les relations mutuelles, et nous rendent étrangers l’un à l’autre quand on se rencontre à nouveau et que l’on trouve les choses différentes de ce que, sans s’en assurer, l’on imaginait[55][55] Roland Barthes, ibid., p. 189.. »