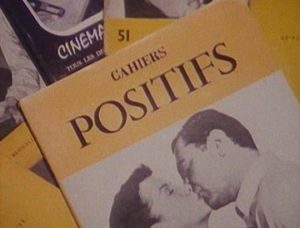Débordements_3.pdf
Juin 2021
Dans la foulée de la réouverture des cinémas, la part de la critique s’est accrue dans nos pages de juin 2021. Les sorties en salles, cependant, y côtoient des films diffusés à la télévision, en ligne, et même entre les murs d’une fondation d’art contemporain (sans parler des consoles de jeu vidéo) : témoignage concret que la réouverture des salles ne s’accompagne pas d’une rétraction du champ de la critique.
Pour les hommes-femmes spectateur·trices que nous sommes, ce retour n’aura pas été sans tensions, sans rêveries. Avec d’abord cette sensation d’une reprise par palier. Des films humbles ouvraient la voie aux mastodontes, le monde engourdi du cinéma s’étirait doucement, comme s’il retenait son souffle avant le festival de Cannes.
En attendant, on peut se demander si le plaisir retrouvé n’a pas émoussé notre vigilance critique : alors qu’on se souciait, le mois dernier, d’articuler retour au cinéma et retour à la société, notre rubrique critique s’ouvre ce mois-ci autour d’À l’abordage, qui maintient explicitement à distance les tumultes du monde. Si À l’abordage, comme 143 rue du désert, est généreux avec ses personnages, éminemment aimable, ne lui manque-t-il pas un certain poids ? Aussi, le véritable retour du cinéma ne se ferait-il pas le 7 juillet, avec les sorties attendues d’Annette et Benedetta ?
C’est bien ce que la bande-annonce du film de Leos Carax voudrait me faire croire. Renchérissant sur la promesse d’une « expérience absolue de cinéma » par la précision que le film serait diffusé « exclusivement au cinéma », elle me sort de l’illusion où j’étais tombé : en regardant À l’abordage sur mon écran d’ordinateur, en voyant 143 rue du désert en salle, je n’ai fait en vérité qu’une expérience de cinéma relatif. Heureusement, je vais bientôt pouvoir enfin me laisser emporter par des torrents d’émotion, absorber dans la vision unique d’un créateur de cinéma avec un grand C.
Pourtant l’impatience et l’avidité sont mêlées de gêne, je pressens que la redondance des formules cherche à nous enfermer, les films et moi, dans l’enceinte resacralisée du cinéma, dans une confortable assurance, teintée de nostalgie.
La rêverie commence. Et si la grandeur, au lieu d’être dans l’absolu, était dans le relatif ? Si le rapetissement du grand C s’accompagnait d’un accroissement de ses alentours ? Si la plus grande qualité d’un film était d’être à la fois au cinéma et ailleurs, dedans et dehors, du cinéma et quelque chose d’autre ?
Dans 143, rue du désert, la porte qui sépare le désert de l’intérieur du café de Malika vaut comme une mise en abyme de l’écran de cinéma. Mais ce surcadrage est marqué pour mieux être dépassé, la fascination pour le dispositif et les moyens du cinéma cédant la place à un art de la rencontre (avec des personnages, et un lieu). Hassen Ferhani exprime le désir que son film puisse être vu par sa tante et, de fait, son film réalise une forme de synthèse entre un cinéma d’auteur et un cinéma populaire, dont on trouve un autre exemple avec À l’abordage.
Aux lueurs éblouissantes et aux apparats cannois, on peut préférer les modestes feux qui portent la possibilité du commun. Annette, sans préjuger de ses qualités et de ses défauts, s’avance déjà auréolé d’une mythologie du cinéma dont il faut à la fois reconnaître la force de séduction et les limites. Il suffit de penser à la manière dont un·e jeune cinéaste pourrait aujourd’hui commencer à faire des films pour se demander s’il n’y a pas, plus que jamais, un désir à aller chercher et à susciter du côté de l’allègement, si une libération de la pratique ne passe pas par une décroissance de la mythologie. Carax lui-même a mis neuf ans à faire son film.
Pour le meilleur et pour le pire, des modèles et des économies diverses coexisteront toujours, sans aucun doute. Néanmoins la fermeture temporaire des salles a été une coupure symbolique, une suspension où repenser les évidences, s’adonner à cette rêverie sur ce qui mériterait d’être appelé un cinéma d’après. Le retour tonitruant du festival de Cannes (l’un des festivals fermés, où le public peine à trouver une place dans les salles aux côtés des professionnels) marque une reprise des habitudes plus qu’un renouveau.
L’illusion se situe peut-être plus du côté du cinéma avec un grand C que du côté du cinéma relatif, mineur et commun. Il faut cela dit s’entendre et ne pas se laisser prendre dans un jeu d’oppositions binaires, dans un piège du langage qui amènerait à valoriser la modestie plus que l’ambition, la retenue plus que l’excès, la pauvreté plus que la débauche (avec l’idée qu’on pourrait faire des films avec rien, donc dans la précarité). Derrière le mot “commun” se cache un souci, une question d’imaginaire ou d’économie au sens général du terme, plus qu’une norme concernant la forme et le format (aux côtés de Guillaume Brac et Hassen Ferhani, ces pages font aussi une place à James Benning et Wang Bing).
Ce n’est sans doute pas un hasard si les films dont nous avons eu envie de parler offrent aussi une galerie de figures populaires : d’une femme âgée indépendante dans 143, rue du désert, à un jeune garçon joueur dans Pedra e Poeira, en passant par les banlieusards et campeurs improvisés d’À l’abordage — à quoi on pourrait ajouter Brian Ritchie, le personnage de The Last Hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe (un entretien publié en février est disponible en ligne). À travers eux, dans ces individualités qui se font volontiers les intermédiaires d’une communauté, se révèle la vraie puissance d’un cinéma qui, contre la démesure de l’exception, parvient à donner la pleine mesure du moyen.
Imaginaire et économique, la lutte se joue autant dans les images que dans le réel : du cinéma d’après, qu’on se le dise, Cannes n’est pas La Clef.
Romain Lefebvre