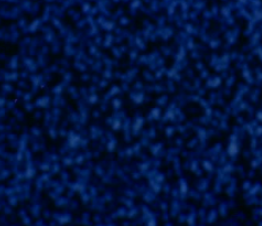Guillaume Cailleau & Ben Russell
« Le temps de se défendre » – À propos de Direct Action
Prix Encounters du Festival de Berlin et Grand Prix du Cinéma du Réel, Direct Action, fruit de la collaboration entre Ben Russell et Guillaume Cailleau, suit les habitant·e·s de la zone à défendre de Notre-Dame des Landes en Loire-Atlantique. Après des années de lutte, les habitant·e·s construisent un espace commun par le travail. C’est ce que s’attachent à filmer les cinéastes qui, par le biais d’une caméra 16 mm, entendent rendre compte de gestes dans toute leur durée. La ZAD, territoire utopique, recompose le rapport des militant·e·s à la temporalité. Rencontrés lors du festival Cinéma du Réel, Guillaume Cailleau et Ben Russell nous ont expliqué comment leur méthode de tournage leur a permis de s’intégrer et de participer à cette expérience collective.

Débordements : Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Guillaume Cailleau : On s’est rencontrés en 2009 au New York Film Festival où nous montrions chacun un film dans le même programme de courts-métrages. Puis nous nous sommes retrouvés dans le même atelier à Athènes pendant la crise grecque en 2011. Nous avons décidé de faire un film ensemble, un portrait du quartier d’Exarcheia, un court-métrage très différent de Direct Action. Ensuite, l’un de mes court-métrages, Laborat (2014), ayant connu un beau succès, j’ai reçu un ours d’argent à Berlin, j’ai obtenu un accès plus facile à des financements et j’ai crée ma boite de production – CASKFILMS – avec laquelle j’ai co-produit, entre autres, Good Luck et Color Blind de Ben. La genèse de ce projet vient du fait que Ben est venu me proposer de faire un film sur la ZAD.
Ben Russell : Good Luck a été fait avec une équipe de trois personnes et Guillaume nous a rejoints au Surinam pendant un mois pour filmer. Je souhaitais qu’on travaille à nouveau ensemble sur un projet, je lui ai donc proposé d’en être le producteur et puis au cours du tournage notre collaboration s’est rapidement transformé en co-réalisation. Nous sommes allés à la ZAD tous les deux mois pendant dix jours, à trois, avec Guillaume et Bruno Auzet, notre ingénieur du son. Mon français n’était pas aussi bon que celui de Guillaume… Nous devions repenser le modèle de production et de collaboration du film vis-à-vis de ce lieu traversé de discours militants.
D. : Cette difficulté avec la langue française a-t-elle concentré l’attention du film sur les gestes des personnes filmées ?
B. R. : Dans mon cinéma, je n’ai jamais été très intéressé par les gens qui parlent, et en tant que spectateur, je n’aime pas vraiment le commentaire ou les entretiens. Ma relation au cinéma consiste plutôt dans le fait de demander aux images de parler d’elle-même en produisant une relation entre son et image plus discursive que déclarative. Le fait de tourner sur pellicule s’opposait à une pratique du documentaire dans laquelle on tourne autant qu’on peut et on sélectionne au montage ce qui nous intéresse. Dans tous mes projets, j’essaie de reconsidérer comment et pourquoi je filme. C’était évident pour nous, bien avant qu’on arrive sur place, que les gens de la ZAD maîtrisaient leur manière de se présenter en tant qu’individus politiques. Il nous semblait important de trouver une autre façon de réfléchir aux questions d’idéologie et de relation entre l’individu et l’espace. C’est pourquoi, avant même de filmer, nous avons décidé de ne pas nous attarder sur la parole.
D. : C’est frappant lorsque nous entendons les gens parler, notamment lorsqu’ils élaborent leur stratégie avant la manifestation de Sainte-Soline, une séquence qui arrive après 2h30 de silence. Comment avez-vous travaillé la durée dans le film ? À quel moment une telle longueur s’est-elle imposée ?
G. C. : Nous n’avons pas commencé le projet en nous disant que le film serait long. Mais assez vite, l’idée de la durée s’est imposée nous nous sommes rendu compte que ça allait devenir un très long-métrage. Ce devait être même plus long que le film ne l’est maintenant.
B. R. : Le temps a longtemps été essentiel dans ma pratique. Tout film que je fais, je l’espère très long. Mais la fabrication des films s’inscrit dans une longue période temporelle avec des problèmes de narration, de structure et d’engagement qui posent des défis conceptuels propres à chaque projet. Avant Direct Action, mon film le plus long durait 2h30. Le film détermine lui-même la longueur qui lui correspond, il s’agit de l’accepter comme il doit être. La question du public ou de la distribution est alors secondaire.
G. C. : Nous ne nous lançons pas dans un projet avec une idée préconçue du résultat final, nous nous laissons guider par le processus. Dans ce cas, le rythme de la ZAD a influencé la façon dont nous avons conçu le film.
D. : Chaque plan est cadré pour capter l’entièreté d’une tâche en plan séquence. Comment cette idée vous est-elle venue ?
G. C. : L’une des choses que nous nous sommes dites avant de tourner dans la ZAD est que « Vivre ensemble c’est aussi faire ensemble » [en français dans le texte, ndlr.] et le « faire » est vite devenu une part importante du projet. Nous sommes venus sur la ZAD en étant un peu naïfs, puis nous nous sommes rendu compte de la quantité de travail qui y était déployée.
B. R. : Je dirais que le film ne montre jamais des actions dans leur entièreté, mais que le film dans son ensemble montre une seule action dans son intégrité. Chaque événement que nous filmons est une pièce de cette totalité. C’est une question d’accumulation, comment certaines choses en génèrent d’autres et comment tout se construit petit à petit. Une des premières séquences est celle de la scierie. Dans la scierie, on coupe le bois qui sera fendu dans la séquence suivante, bois qui sera utilisé ensuite pour réparer les murs détruits. Toutes ces relations n’arrivent pas de manière linéaire : nous sommes arrivés dans ce lieu à un certain moment puis nous sommes revenus périodiquement au cours de l’année, nous observions les choses par saisons. C’est comme ça que fonctionne une communauté agraire : tu plantes et tu récoltes à la saison prochaine. Nous n’étions pas des invités passifs, nous sommes venus comme participants aux travaux collectifs, pour que le collectif bénéficie également de notre présence. C’est parce que nous participions que nous avons pu observer le déroulement de ces actions, leur durée propre, ce qu’elles requéraient en termes de cadrage, ce que le temps de l’action imposait puisque nous tournions en 16mm et que chaque bobine dure dix minutes. Tout ce que nous voulions filmer devait donc durer moins de dix minutes.

D. : On voit des zadistes mêler des techniques archaïques et des techniques modernes…
B. R. : Ce mode de production est un véritable engagement. Les terres destinées à l’aéroport étaient des terres agricoles et les fermiers ont invité des gens à squatter les fermes. Des personnes sont arrivées avec des chevaux, des moutons ou des outils qui participaient de l’occupation utile des terres. C’est une sorte de « bricolage » : ce qu’ils ont, c’est ce qu’ils ont, et ce n’est pas beaucoup. Il n’y a pas beaucoup de capital à la ZAD, mais un mélange de techniques. C’est un lieu où chacun a une expertise et transmet son savoir.
G. C. : Il y a une diversité importante des individus, ce n’est pas un espace homogène.
B. R. : Chacun est engagé dans l’anarchisme, mais dans son acception la plus générale qui comporte différentes approches. Ne pas travailler a autant de légitimité que travailler. Certains argumentent en défense de leur droit à ne pas travailler et personne ne s’y oppose. La communauté incorpore ces différentes approches. On n’attend pas des habitants qu’ils se ressemblent.
D. : L’organisation de la ZAD ressemble à la façon dont vous montez, chaque plan s’articule vis-à-vis des autres.
B. R. : Toutes les activités que vous voyez débordent du cadre (« meta-framing »). Chaque action ne vaut pas que pour soi, mais aussi pour les autres. Ce n’est pas un film à propos d’un collectif autonome, d’une commune, de fermiers – ça pourrait l’être ! – mais plutôt un film sur un contexte politique qui permet de voir comment ces actions s’opèrent, comment elles se construisent, sur ce que ces gens ont fait, et ce qu’ils vont faire. Nous voulions parler du présent sans trop parler du passé, car ce qui est arrivé en 2012 et en 2018 [deux expulsions et l’abandon du projet d’aéroport, ndlr.] pourrait nous faire oublier que, à présent, ils vivent sur une terre qui aurait pu être un aéroport, que le phare aurait été une tour de contrôle, que le champ aurait été une piste d’atterrissage. Il y a un autre futur possible, ce que ce lieu aurait pu devenir et ce qu’il n’est pas devenu. Là-bas, on est vraiment hanté par cela. Lorsqu’on voit les archives des expulsions de 2012 et 2018, on voit que la forêt était submergée de gaz lacrymogène, on voit les tanks de la police qui détruisent des maisons. C’est ce que portent avec eux les gens qui vivent dans la ZAD : leur traumatisme et la violence qu’ils ont subie dans leur chair. C’est pourquoi nous avons commencé en montrant l’archiviste qui collecte toutes les images de cette lutte. Notre présence coïncidait avec la deuxième manifestation de Sainte-Soline et soulignait que Sainte-Soline était une lutte certes exceptionnelle, mais que la violence ne l’était pas, car ça n’est pas si différent de ce qui est arrivé à la ZAD.
D. : Un plan d’entracte montre la route sur laquelle se sont déroulés les combats en 2018. Un autre raccord du film juxtapose un plan où les manifestants de Sainte-Soline creusent dans un champ pour trouver des cailloux à jeter sur la police et un plan où deux zadistes désherbent une parcelle de terrain. Ce raccord réussit à montrer le lien entre la lutte politique à l’extérieur et la façon dont ils vivent leur utopie au sein de la ZAD. On comprend d’ailleurs, lors de la conférence de presse à la fin du film, que cette utopie est éphémère.
B. R. : Oui, ce « cut », je l’adore. La férocité de Sainte-Soline est facile à transmettre dans le film, mais il fallait aussi transmettre l’idée que cela arrivait en même temps que d’autres événements. Le fait que ça se déroule sur des terres agricoles comme à Notre-Dame des Landes créait du lien, il y a des gestes similaires : couvrir les grenades lacrymogènes, sortir des cailloux du sol. Nous pensions beaucoup à ces détails, car nous n’avons que 36 plans dans le film, donc 35 raccords. Chaque raccord doit offrir de nouvelles perceptions.
G. C. : Il était très important pour nous de revenir sur la ZAD après la manifestation, c’est notre sujet principal, plus que Sainte-Soline ou les Soulèvements de la terre, même si ce sont des aspects importants du film. Le territoire de la ZAD dépasse alors son contours géographique pour devenir un territoire idéologique. Nous avions une perspective macroscopique et une perspective microscopique. Ce qui se passe là se passe à différents niveaux, simultanément.
D. : Vous changez de perspective.
G. C. : Oui.
B. R. : Toutes les actions sont importantes. Toutes ne le sont pas au même niveau, mais chacune est nécessaire. La diversité des gestes et tout ce qui arrive à la ZAD nous donne un échantillon d’approches différentes. Le militantisme et le désarmement, stratégies que portent des écologistes non violents, coexistent ensemble. La non-violence seule ne marche pas, mais couplée à d’autres approches, historiquement, elle a été plus efficace. Et c’est le moment dans lequel nous sommes.
D. : Vous avez tourné avec une caméra lourde, en 16mm. Pourquoi avez-vous choisi ce dispositif ?
B. R. : Depuis deux décennies, je tourne sur pellicule et j’essaie toujours de trouver un moyen d’associer mon sujet et cette pratique. J’essaie de le rationaliser et de l’analyser. Pour moi, il s’agit d’une économie de l’attention. Pour nous, travailler sur pellicule permet d’apporter plus d’attention aux choses, de décider quoi et comment filmer. Nous n’avons pas beaucoup tourné, seulement 12 heures de rushes. Le film dure à peu près le quart de ce que nous avons tourné. La matérialité de l’image argentique permet de faire exister ces images au présent et en dehors du présent. On ne peut pas localiser ces images. Elles auraient pu être tournées vingt ans plus tôt, ce que l’on ne peut pas dire pour une caméra numérique. Les personnes sur place étaient d’ailleurs très excitées par le tournage sur pellicule.
D : Une ancienne technologie qui débarque à la ZAD, un peu à la manière des chevaux de trait…
G. C. : Il y a souvent l’idée d’une hiérarchie des technologies, les plus récentes étant les meilleures, rendant les autres obsolètes. Mais les caméras analogiques fonctionnent très bien, la pellicule a sa spécificité, nous aimons l’utiliser, nous savons l’utiliser, pourquoi devrions-nous changer de technologie ?

D. : Le collectif Les Scotcheuses a tourné un film Super 8 sur la ZAD. Cette pratique s’accompagne d’une réflexion sur l’impact écologique du cinéma. Cette question vous intéresse-t-elle également ?
B. R. : Pour moi c’est simplement un autre médium. La chimie photographique est un procédé industriel toxique. Je ne suis pas certain que l’on puisse dire que c’est plus écologique que le numérique. Un artiste est toujours pris dans une quête du médium avec lequel il travaille, il doit pousser sa croyance en son médium. On peut trouver tout un tas d’arguments pour une chose que l’on trouve simplement agréable ou nécessaire. Nous avons choisi la pellicule parce qu’elle est alignée sur notre sujet, sur notre manière de filmer, sur notre présence, sur notre façon d’approcher le ou les sujets, sur notre manière de communiquer. Ça ne fait qu’un avec la forme que nous avons choisi pour véhiculer notre propos.
G.C : L’écologie de la pellicule comme matière et l’écologie du cinéma en général sont de vastes sujets. Notre impact est réduit parce que nous sommes une équipe de trois personnes. Et puis il y a aussi dans les principes d’écologie, le rapport au monde et les relations que vous tissez avec celui-ci et ce qui l’entoure et ce sont des questions qui nous préoccupent. Pour la recherche des financements, il exist de nombreux labels verts, et c’est souvent absurde. Vous pouvez être labellisé parce que vous proposez uniquement de la nourriture végétarienne mais vous utilisez cinq camions et une flopée d’éclairages.
J’ai fait beaucoup de développement de pellicules à partir de plantes, c’est formidable, mais ça ne permet pas d’avoir le type d’images que nous recherchions. C’est une bonne chose que certains s’y essaient, développer avec des plantes c’est aussi revenir aux origines du cinéma. Le pharmaceutique comme la chimie de développement et le chimique viennent aussi des plantes, c’est intéressant de faire une telle boucle.
B. R. : Le désir d’avoir une relation haptique au matériel n’est pas possible pour moi avec la vidéo. On peut tenir une carte SD, mais pas une image. Pour ce film, ce n’était pas nécessairement une problématique, mais pour de nombreuses personnes travaillant en 16mm ça l’est : la physicalité du médium.
G. C. : Quand je propose des ateliers argentiques à la ZAD, il y a toujours ce moment où, après l’avoir développée, puis accrochée, l’image apparaît. C’est le moment merveilleux où l’on peut voir ce que l’on a filmé.
D. : En voyant la scène de la fabrication du pain, il semble évident que la question de la matérialité est cruciale…
B. R. : Nous nous concentrons sur la matérialité de l’action, sur ce qui est en train d’arriver et sur la texture que ça prend. Nous pensons déjà à l’image en tant que matière, pas seulement en tant que représentation. À la façon dont elle est fabriquée. Ça nous vient des cinémas expérimentaux et d’avant-garde, de l’art conceptuel : la façon dont vous faites les choses est ce que vous faites. La façon dont vous représentez un sujet a tout à voir avec les outils que vous utilisez. Notre préoccupation première était de nous demander quelle est la forme qui correspondait le mieux à ce que l’on montre. Comment alignons-nous notre façon de faire avec notre façon de tourner, mais aussi par notre façon d’être ? Comment occupons-nous le temps ? Comment communiquons-nous ? Comment collaborons-nous ? Toutes ces questions sont posées aux personnes avec lesquelles nous travaillons. Dans un lieu comme la ZAD où l’idéologie est si clairement articulée, il était important d’être aussi bien articulé nous-mêmes à propos de ce que nous allions faire, de l’allure que ça allait prendre.
D. : Le travail du son dans le fim est particulièrement ludique. Tout a été enregistré sur place ? Tout ce que l’on entend est-il issu de la prise de son au moment du tournage ou l’avez-vous largement monté et retravaillé en postproduction ?
B. R. : Ce que l’on entend est pour une très grande part enregistré sur place. Puis il y a une partie du son qui a été retravaillé, nettoyé, ajouté ou amplifié. Je travaille comme ça depuis A spell to ward of the Darkness (2013). Dans mes courts-métrages qui étaient tournés en 16 mm je ne pouvais pas enregistrer de son avec la caméra, je devais donc enregistrer en parallèle, faire des choix, les rapports sons-images étaient largement construits après coup. J’ai fait plus tard un film avec Nicolas Baker, un ingénieur son qui vient des films de fiction. Il reconstruisait totalement le son. Ce n’était pas si différent de ma pratique antérieure, mais avec un niveau d’expertise bien supérieur. Ajouter du son, attirer l’attention par des sons pour amplifier ou bouleverser la perspective d’une scène. Avoir un mouvement sonore est crucial dans le cas de plans séquences. Nous avons travaillé avec Rob Walker à partir des enregistrements spécifiques de Bruno Auzet qui impliquent des micros-cravates, des micro-booms et des micros d’ambiance. Nous avons passé beaucoup de temps à définir le caractère du son. Paradoxalement, une fois le travail terminé, ça m’a semblé être le son le plus direct que j’ai fait.
G. C. : Nous avons aussi enlevé des sons. Nous avons reconstruit le son pour qu’il sonne juste par rapport à notre souvenir. Cela impliquait d’ajouter, mais aussi de retirer des choses.
D. : Vous avez utilisé un son numérique ou analogique ?
G.C : Numérique. Pour mes précédents films, j’utilisais un Nagra parce que je voulais pouvoir attaquer le son, je désirais pouvoir travailler sur un objet physique – la bande magnétique, par exemple, avec des aimants – mais ce n’était pas nécessaire ici.
B. R. : Nous ne sommes pas des fétichistes de l’analogique. Le film a aussi une correction colorimétrique et un tas d’autres effets de postproduction. Après tout c’est un film pensé pour le cinéma avec une projection en DCP.
D. : Il y a ce plan de Sainte-Soline où les manifestants traversent une tranchée. Un long plan séquence. Qu’est-ce que ça implique de prendre le temps d’installer sa caméra, de filmer ce qui devient une révolte ? Souvent les révoltes sont capturées avec une caméra tremblante…
B. R. : Nous nous sommes rendus sur place dans une grande agitation. Je n’étais pas excité à l’idée de filmer dans un contexte dont je savais qu’il serait violent, de demander à notre ingénieur son de se mettre dans une situation de risque. Mais, du fait du format décidé auparavant, cela semblait nécessaire. Ce qui diffère avec ces plans de Sainte-Soline en comparaison au reste du film c’est qu’il y a davantage de distance entre nous et le sujet. Nous ne voulions pas prendre le risque d’être blessés en nous approchant. Il était hors de question de se poster devant les policiers avec notre caméra pendant 10 minutes. Nous essayions réellement d’être aussi proches, mais aussi distants que possible dans ces moments, ce qui peut paraître un peu absurde après coup. Dans le troisième plan, on voit de nombreux journalistes en train de prendre des photos. Il y a un type avec un zoom et un réflex qui se tient à deux mètres de la police, une voiture est en feu et lui se tient juste là. Nous n’avons pas de désir d’être si proches de la violence, aucun plaisir à l’idée de s’y noyer.
G. C. : Je crois que le plan de la tranchée est le produit de ce que l’on disait auparavant sur le fait d’observer et de pressentir ce qui est en train de se produire, à cet instant nous avons juste eu le temps nécessaire pour installer la caméra à cet endroit.
B. R. : Ces quatre plans c’est tout ce que nous avons filmé à Sainte Soline. Ça peut paraître ridicule de ne pas avoir filmé d’avantage au vu de la pellicule dont nous disposions. Mais une fois sur place on a compris qu’il était futile de craindre de passer à côté de certaines choses, on était certains que ce que l’on enregistrerait serait signifiant. Tourner en pellicule relève effectivement d’une forme d’intuition. Étant réalisateurs depuis un certain temps, nous avons une certaine confiance dans notre faculté à anticiper des événements. Nous essayions de rester en avant des manifestants, d’anticiper les mouvements de foule, car on se doutait de la tournure que prendraient les événements. Nous sommes arrivés là et nous nous sommes installés pour tourner juste avant que tout le monde se mette à sauter à travers la tranchée. Le plan séquence est une pratique extatique. Au moment du tournage on place sa confiance dans le fait que le moment capturé va être signifiant, que ce qui va être capturé va être bien plus intéressant que ce que vous pensiez qu’il arriverait. Nous savions que des personnes allaient traverser, mais nous ne pensions pas qu’ils seraient si nombreux ni qu’ils se mettraient à sauter dans la tranchée. De même pour le plan suivant avec la structure en forme d’oiseau ou les tirs de gaz lacrymogènes, toutes ces choses qui apparaissent simultanément dans le même plan. C’est ce qu’il y a de plus exaltant : espérer que des choses arrivent et les voir se produire alors que l’on filme.
G. C. : …et obtenir plus que ce que l’on supposait…
D. : Il y a cette séquence du drone, qui est assez drôle par ce que nous y raconte le pilote. C’est la seule fois où nous voyons la ZAD comme un espace continu et complet, mais aussi le seul plan sans humain.
G. C. : Il y a des humains, au début nous voyons le pilote et à la fin nous le voyons depuis la perspective du drone. Avant tout c’est son rôle sur la ZAD d’être pilote de drone, c’est son travail, son engagement, voilà pourquoi on souhaitait l’avoir dans le film. C’était également intéressant d’avoir une vue aérienne au-dessus d’une zone qui était censée être un aéroport. Obtenir cette perspective depuis le ciel, de ce que cela aurait pu représenter d’atterrir ici, cela nous intéressait.
B. R. : De même que pour les autres plans du film, cette personne est sur la ZAD depuis longtemps, nous le voyons exercer son métier. Il a sans doute eu une fonction stratégique de contre-surveillance et de recueil d’informations lors des conflits avec l’État… Après la victoire en 2018, les préoccupations ont changé, mais on suppose qu’il a poursuivi sa pratique tout du long. Nous avons découvert qu’il avait une chaine YouTube avec des supers vidéos. L’une des difficultés du film était d’essayer de représenter non seulement le travail physique, mais aussi le travail créatif, le travail conceptuel, le travail intellectuel. Sa pratique participe de ces catégories bien qu’elle ne soit pas immatérielle puisqu’elle crée des objets. Nous réfléchissions à une relation différente au travail, à ses fonctions, et à ce qu’il met en jeu.
B. R. : Une condition à la fabrication de ce film était aussi l’anonymat, s’assurer de la sécurité du fait de la position agressive de l’État. 3000 activistes écologistes sont fichés S en France. Un certain nombre d’entre eux vivent dans la ZAD. Ils sont impliqués de longue date dans des conflits politiques. Le degré de surveillance et d’agressivité de la police ne cesse de croitre. Après Sainte-Soline le ministre de l’Intérieur a annoncé dissoudre les Soulèvements de la terre. À 5 heures du matin, l’unité antiterroriste a arrêté plusieurs personnes, les a mis en garde à vue pendant 3 jours : ils ont essayé d’arrêter ceux qu’ils supposaient être les leaders du mouvement et de les empêcher de se défendre contre la dissolution. Ces stratégies sont en expansion, ils sont engagés dans un combat justifié contre l’état. Je comprends donc que certains soient craintifs quant à la révélation de leur position ou de leur identité.

D. : Avez-vous gardé contact avec les zadistes ? Intègrent-ils votre travail à leur stratégie, comme un outil de communication parmi d’autres ?
B. R. : Il semblerait. Certains sont venus à Berlin pour le festival, certains sont présents ici [à Paris, ndlr.]. Au début du question-réponse au Forum des images, ceux que nous avons invités ont pris la parole. Le film étant peu explicatif, c’est aussi une plateforme à partir de laquelle les zadistes peuvent parler de ce qu’ils souhaitent.
Nous travaillons aussi à un livre avec les éditions Iris (Déc. 2024). Un projet très différent puisqu’il sera composé presque uniquement de textes. Il parlera d’histoires et des relations personnelles depuis la perspective des zadistes, des combats sociaux dans lesquels ils sont engagés. Le film est un point de départ. Nous voulons poursuivre notre relation avec les gens sur place, nous y retournons ce vendredi pour quelques jours. Pendant la fabrication du film, nous montrions à tous les rushes dès que nous retournions à la ZAD. Je crois que les gens ayant participé au tournage se sont sentis actifs. Nous leur avons montré ce que nous estimions être un montage final pour voir s’ils avaient des réserves ou des questions, nous désirions leur autorisation avant de conclure. La durée étendue était une inquiétude partagée, mais chacun a été convaincu par la façon dont le temps s’inscrit dans le film.
G. C. : Nous avons aussi organisé des projections dans les réseaux alternatifs de là où on nous invite. En Allemagne, une ZAD a vu le jour dans une forêt qui devait être rasé pour favoriser l’extension d’une usine TELSA à côté. J’y étais il y a deux semaines pour projeter le film en plein air. S’il peut servir d’outil de lutte, nous en sommes ravis.
B. R. : Nous nous attendons à ce que le film ait une existence dans des communautés alignées avec des causes activistes et militantes. Le film montre tout le travail et toute la tendresse déployée pour construire et faire grandir un tel mouvement.
D : Quelles étaient vos références de cinéma militant pour ce projet ?
B. R. : Aucune [rires]. Shinsuke Ogawa un peu. Robert Kramer, certes, mais pas pour son travail militant. La question revient souvent de savoir si nous sommes des cinéastes militants, la réponse est non !
D. : Le cinéma militant constitue pour une part importante du cinéma d’avant-garde. Votre contact avec les zadistes peut faire penser au groupe Medvedkine ou à des travaux de Jean-Pierre Thorn.
G. C. : Mais nous ne leur avons pas donné les moyens de production. Nous partagions l’avancée du film et certaines décisions, mais nous ne leur avons donné ni la caméra ni les micros.
B. R. : Lorsqu’on parle de travail collaboratif, il s’agit de consentement et d’engagement. Des influences en termes de représentation du travail au cinéma, de la façon de l’approcher pourrait être du côté de Newsreel. Ou du cinéma direct de Barbara Kopple. Frederick Wiseman par sa volonté de faire le portrait d’institutions plutôt que d’individus. La question du film comme médium est cruciale, c’est ce qu’il manque souvent au cinéma militant selon moi. Une pensée formelle et esthétique qui ne prend pas pour autant le dessus sur le contenu. Nous essayons de mettre sur un pied d’égalité ces deux aspects.
G. C. : Je ne tiens pas trop à définir le cinéma, mais je pense qu’il doit avoir une fonction. Une rencontre très importante au début de ma carrière a été René Vautier. Mon premier film montré en festival était dans une même sélection que certains des siens. Il a fait des films pour des raisons essentielles, des films qui ont été montrés au tribunal comme preuve. Des films sur des marées noires, sur Jean-Marie Le Pen. Il a fait le premier film contre le colonialisme [Afrique 51, ndlr.] censuré pendant trente ans avant qu’il se voie reconnu pour ce travail. Une personnalité si active et militante est vivifiante. Ce que nous faisons ne vise pas seulement à nous satisfaire.
D. : Nous parlons d’individus, de travail. Les animaux dans le film sont également stupéfiants. Est-ce une chose que vous avez découverte à la ZAD : une façon d’observer les animaux autant que les humains, de considérer aussi les animaux comme des travailleurs ?
G. C. : Comme des partenaires, pas comme des travailleurs. Travailleurs implique une forme d’exploitation. Comme co-habitants c’est certain. Je vis à Berlin où il y a très peu d’animaux, nous cohabitons, mais nous n’échangeons pas. À la ZAD il y a plus de place pour l’échange, l’animal donne aussi à la communauté. La présence de salamandres par exemple a empêché la construction de l’aéroport, c’est une espèce protégée qui a permis de sauver ce territoire. Il y a une duplicité, une réciprocité dans l’échange qui est plus forte qu’ailleurs.
B. R. : Pour ma part j’ai été végan et je suis végétarien depuis mes 18 ans, le système de production alimentaire aux États-Unis étant très différent de celui en France. Je suis bien plus intéressé par les gens qui ont une relation généreuse aux animaux que ceux pour qui ils ne sont que des objets ou des êtres conçus pour rendre service. C’est un film à propos de militants écologistes, mais qui interroge la continuité entre sujets humains et sujets non humains. Pas seulement les animaux, mais aussi les plantes, les arbres. La ZAD sert de continuum pour comprendre comment chacun trouve sa place dans un cercle plus large. Si on peut concevoir ce film comme un portrait de tous ceux présents sur la ZAD, il paraît nécessaire d’inclure tout le monde c’est-à-dire les chevaux, les moutons, les arbres, etc. Il faut réfléchir à la co-occupation de ce territoire.