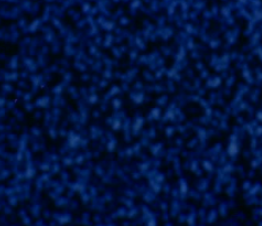Joy, David O. Russell
La ménagère apprivoisée
Joy est un biopic inspiré de la vie de Joy Mangano, modeste mère célibataire de Long Island devenue chef d’entreprise au début des années 90 grâce à l’invention et la commercialisation d’un balai-serpillière : le Magic Mop. Ce conte de ménagère, où la baguette magique prend la forme d’un balai reprend un vieux refrain américain, venu du cinéma de Capra : « In America, the ordinary meets the extraordinary everyday ». La réplique est prononcée par l’un des responsables de la chaîne de téléachat QVC (Bradley Cooper), qui comprend vite le potentiel du Magic Mop après avoir été convaincu par la démonstration de Joy (Jennifer Lawrence). Si la réussite du pari commercial conduit le film vers un happy end attendu, celui-ci est toutefois médiocre, ne bouleversant aucune valeur, ne portant aucun changement. Joy n’est pas un conte naïf sur le rêve américain à la portée des ménagères, mais plutôt le récit sceptique et souvent ironique de la fabuleuse ascension sociale d’une petite fille nourrie au lait du soap opera (sa mère ne jure que par Falcon Crest et Dynasty), qui finit par réaliser le rêve qu’on a formé pour elle : passer de l’autre côté de l’écran pour vendre des ustensiles ménagers.
Ainsi, la réussite de Joy, que l’on voit trôner dans son bureau en femme d’affaires dans l’épilogue du film, n’a rien à voir avec une quelconque apologie du girl power. Le schéma général du film et le portrait qu’il dresse de son héroïne sont trop conservateurs pour qu’on puisse y déceler le moindre signe d’émancipation. Joy – et c’est là que réside sa profonde originalité au regard de la position actuelle de Jennifer Lawrence à Hollywood et du rôle de Liberté guidant le peuple qu’elle a tenu dans la série des Hunger Games – raconte l’histoire d’une femme entreprenante qui ne veut changer ni le monde, ni même vraiment le sort des ménagères. Car si le Magic Mop permet de gagner du temps (il s’essore tout seul), les femmes n’en continuent pas moins de passer le balai.
Ce conservatisme marque une légère régression au regard des blockbusters récents, où l’on a vu les femmes contractualiser leurs relations sexuelles (Dakota Johnson dans Cinquante nuances de Grey) ou s’inventer des destins politiques (Charlize Theron et les épouses affranchies de Mad Max). Le film en est tellement conscient qu’il essaie de se rattraper in extremis en métamorphosant Joy en justicière. Lorsqu’elle vient rappeler à un escroc les clauses d’un contrat commercial, Jennifer Lawrence revêt des habits de guerrière : elle se coupe les cheveux, s’habille de cuir, adopte une dégaine de Calamity Jane. Mais sa transformation, trop lourdement soulignée pour être prise au sérieux, relève presque de la parodie. De même, la compassion exprimée par Joy à l’égard d’un modeste couple de Noirs venu lui proposer un objet susceptible de faire fructifier son entreprise ne suffit pas à faire d’elle une grande démocrate soucieuse du sort des minorités : elle ne peut leur proposer qu’une chambre d’hôtel plus confortable dans un Holiday Inn. Le portrait que dresse Russell voudrait tendre vers un idéal progressiste, mais la métamorphose qu’il décrit ne dépasse jamais le cadre étroit des intérêts économiques, elle n’embrasse aucune cause, elle se niche, au contraire, dans un vieux moule libéral construit autour de valeurs immuables : l’initiative, la persévérance, la créativité commerciale. On peut y voir une limite alors que c’est sans doute l’une des qualités du film : il ne vise pas la parabole, il s’en tient au tracé d’une vie et à la médiocrité relative d’un conte où les citrouilles se transforment seulement en Magic Mops.
Cette qualité, que l’on pourrait tout aussi bien assimiler à un manque d’ambition, se retrouve dans la forme du film. Alors qu’on continue de comparer Russell à Scorsese, il ne s’est jamais aussi nettement référé à l’esthétique télévisuelle. C’était déjà le cas dans Happiness therapy où la scène du concours de danse, sommet romantique du film, prenait la forme d’une séquence de Danse avec les stars, incluant la notation du jury. Dans Joy, le rêve de la ménagère prend forme lors d’une émission de téléachat où on lui demande de se conformer physiquement à l’esthétique du soap : elle doit s’habiller et se farder comme une actrice de feuilleton. Esthétique dont le film se moque un peu par ailleurs en parodiant, dès le prologue, les feuilletons que regarde la mère de Joy. Comme s’il fallait, dès le début, accuser le caractère factice du conte et à travers lui, la fadeur un peu écoeurante d’un rêve qui aura toujours le goût du savon (traduction littérale de soap en français).
Mais comme Russell est un cinéaste joueur et malicieux, il est difficile de dire jusqu’où va son ironie. Il est clair qu’il existe chez lui une fascination pour la forme feuilletonesque, que l’on retrouve dans l’écriture du film (chaque moment de réussite s’accompagne d’un revers de fortune), les costumes et le maquillage des actrices, et surtout le jeu de Jennifer Lawrence, qui est capable de décliner en une scène toutes les émotions sans en exprimer vraiment aucune. Il n’est pas étonnant que Russell en ait fait, depuis maintenant trois films, son égérie : il cherche à travers elle des ressorts émotionnels dignes du soap. Jennifer Lawrence est l’actrice rêvée d’un cinéaste fasciné par l’artifice et la superficialité rassurante des apparences.
Ce goût pour le maquillage et les postiches, qui s’est exprimé dans toute sa plénitude à travers American Bluff, a néanmoins une contrepartie un peu embarrassante : Russell crée des silhouettes séduisantes mais creuses. Ses familles dysfonctionnelles, lieu commun du cinéma d’auteur américain depuis The Royal Tenenbaums, sont des cellules vides qui fonctionnent avant tout, chez lui, sur le schéma de la petite entreprise. Dans Happiness Therapy, le concours de danse faisait l’objet d’un pari chez les bookmakers : peu importait la beauté du geste, l’important était de rafler la mise. Joy pousse ce schéma un peu plus loin : les membres de la famille, à l’exception de la mère de Joy, abrutie devant sa télévision, sont tous plus ou moins traités comme des partenaires commerciaux. Joy et son ex-mari (Edgar Ramirez) s’entendent bien, ils sont même désignés comme les plus beaux divorcés de l’Amérique, mais cette relation qui perdure n’intéresse pas du tout Russell, qui filme moins un couple qu’une co-entreprise.
Ainsi, lorsque le standard de QVC explose après la présentation du Magic Mop – présentation faite par Joy elle-même, qui parle aux ménagères en tant que ménagère – c’est toute la mécanique du film qui est mise à nu. D’un point de vue idéologique : un éloge de l’auto-entrepreneuriat typiquement libéral. D’un point de vue esthétique : une forme télévisuelle ingrate transfigurée par des talents de director. C’est pourtant au contact de cette forme que Russell est à son meilleur : les injonctions adressées par Bradley Cooper au cadreur de l’émission sont les siennes, et on peut se demander à quel degré il faut les prendre. Car si Joy est en train de devenir, par la magie de la rhétorique télévisuelle, la petite fée de l’Amérique, si elle est en train de passer de l’autre côté du miroir, là où le Magic Mop réactive une part de rêve américain, ce rêve nous est lui-même vendu comme un objet de basse qualité. La minute de gloire de Joy est filmée comme une publicité pour une lessive : plan du carrelage sali, gros plan sur les mains de la ménagère, propreté rétablie, sourire satisfait de la ménagère. Peut-être faut-il percevoir dans cette rhétorique une note dissonante et discrètement ironique, qui ramène le conte libéral à sa moralité sans grandeur, à ces quelques minutes de plénitude durant lesquelles le rêve d’une ménagère a rencontré celui de l’Amérique.
Scénario : David O. Russell et Annie Mumolo / Photo : Linus Sandgren / Production : Megan Ellison.
Durée : 124 min
Sortie le 30 décembre 2015