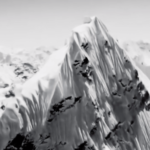La Nature, Artavazd Pelechian
Désastre
Le 19 mai, la Fondation Cartier pour l’art contemporain a rouvert ses portes, laissant dix jours pour découvrir le dernier film du cinéaste arménien Artavazd Pelechian, dont on pouvait penser que l’œuvre était achevée depuis Vie (1993). La Nature, film commandé en 2005 et produit par la Fondation Cartier et le ZKM – Zentrum für Kunst und Medien de Karlsruhe, y était présenté jusqu’au 30 mai, ainsi que deux de ses films emblématiques : La Terre des Hommes (1966) et Les Saisons (1975). L’exposition consiste en la présentation de ces trois films dans deux salles, entre lesquelles les spectateur.ice.s sont invité.e.s à patienter face à quelques artefacts et photographies, retraçant la chronologie du cinéaste et de son œuvre. Un retour approfondi sur l’œuvre du cinéaste s’impose pourtant, vu le changement de paradigme opéré par son cinéma, et pour expliquer ma surprise à la découverte de La Nature.
Artavazd Pelechian débute sa carrière à l’orée des années soixante, après avoir rejoint le VGIK, l’école moscovite qui forma également et entre autres Andreï Tarkovski, Sergueï Paradjanov, Kira Mouratova ou Larisa Shepitko. Son œuvre, dont la durée totale n’excédait pas quatre heures jusqu’à ce nouveau film, est composée de courts-métrages documentaires, à la lisière du cinéma expérimental, construits à partir d’images d’archives et de prises de vues réalisées à sa demande, contretypées afin d’être toutes fondues en une même matière. Les titres de ses films tracent les contours des thématiques qui lui sont chères : Patrouille des montagnes, La Terre des hommes, Au début, Nous, Les Habitants, Les Saisons, Notre Siècle, Fin et Vie. Cet ensemble traduit une grande cohérence formelle et thématique, et développe des principes théoriques et poétiques faisant d’Artavazd Pelechian un cinéaste singulier dans l’histoire du cinéma soviétique et arménien — Serge Daney allant jusqu’à le qualifier de « chaînon manquant de l’histoire du cinéma » [11][11] Serge Daney, “À la recherche d’Arthur Péléchian”, Libération, 11 août 1983, repris dans Claire Déniel et Marguerite Vappereau (dir.), Artavazd Péléchian, une symphonie du monde, Yellow Now, Crisnée, 2016. Vie, très court film sur la naissance, venait clore en couleurs une filmographie en noir et blanc, et m’était toujours apparu comme la conclusion idéale d’une œuvre traversée de manière toujours plus intense et abstraite par un profond désir de vie.
Au fil de ses réalisations, Pelechian développe une théorie du montage « à distance »[22][22] Dans un article publié à Moscou, en 1974, repris ensuite dans son ouvrage Moe Kino, Yerevan-Moscou, Sovetkan Grogh, 1988, traduit en français par Barbara Balmer-Stutz : « Le montage à contrepoint, ou la théorie de la distance », Les Documentaires de la république soviétique d’Arménie, Rétrospective du 21e Festival international de cinéma documentaire, Nyon, 1989, p.75-102 ; repris dans Trafic, n°2, printemps 1992, p.90-105 selon laquelle le sens émerge, non pas du rapprochement de deux plans, mais de leur éloignement et du cheminement qui existe entre eux. Ce travail de montage, précis et minutieux, permet au cinéaste d’offrir aux images, re-montées en une vision qu’il désire et maîtrise, une autre réalité :
« L’art n’est pas un reflet du réel. (…) Quand un artiste crée cela, il advient « la Réalité » de même que celle qui existe vraiment. Dans ce sens, je dis d’un artiste qu’il crée la réalité qui « n’existe » pas. Vous savez, le monde qui nous entoure, pour moi c’est une variante. C’est une variante, une combinaison de ce qui existe. On peut avoir là une combinaison différente et c’est bien un peintre qui est capable de créer cette autre variante de la réalité. » [33][33] Artavazd Pelechian, Barbara Tannery, « La mémoire tourne autour du film dans son ensemble… », La Revue documentaires, n°10 – poésie en documentaire, spectacles de guerre, 1er semestre 1995, p.19
De cette réflexion sur l’art du montage et du soin avec lequel le cinéaste s’y adonne résultent des films d’une rare poésie. Les jeux de boucle, de répétition, d’effets-miroirs, d’inversions (pour certains imperceptibles à la première vision), construits autour d’une variété d’accompagnements musicaux allant de la musique classique à la musique traditionnelle arménienne en passant par des sons rappelant la musique concrète de Pierre Schaeffer, donnent lieu à un dérèglement des sens. Sur ces procédés s’appuie sa théorie de l’image absente, par laquelle « il apparaît que le ‘’j’entends’’ correspond à un état instable de vision, et le ‘’je vois’’ à un état instable de l’action auditive. » [44][44] Artavazd Pelechian, « Le montage à contrepoint ou la théorie de la distance » Trafic, n°2, printemps 1992, p.104. Ses films, à l’instar de la poésie, offrent une sensation d’univers [55][55] Paul Valéry, « Propos sur la poésie » Œuvres T.1, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1957, p.1362. Artavazd Pelechian nous invite à « voir en poésie », c’est-à-dire à « revoir ce qu’on a déjà vu, et le revoir autrement. C’est donner une seconde vie aux choses, infiniment plus riche et concentrée que la première » [66][66] Gérard Leblanc, « Les images virtuelles de la poésie », in La Revue Documentaires, n°10 – poésie en documentaire, spectacles de guerre, 1er semestre 1995, p.7. À travers l’ensemble de son œuvre, le cinéaste développe une cosmologie, une vision du monde et du cinéma quasi mystiques, cherchant à révéler le « mouvement secret de la matière », que l’artiste célèbre le cinquantième anniversaire de la révolution de 1917 (Au début), rende hommage au peuple arménien (Nous), s’intéresse à l’histoire de la conquête spatiale (Notre siècle), ou à la vie quotidienne d’un village (Les Saisons). Le montage à distance apparaît alors comme « une méthode cinématographique permettant la mesure du système de conception du monde de l’auteur ». [77][77] Artavazd Pelechian, « Le montage à contrepoint ou la théorie de la distance » Trafic, n°2, printemps 1992, p.102
L’univers de Pelechian est traversé par les tensions, voire les conflits, entre les forces en présence, ainsi que par une quête de communauté, qui se traduisent autant par les mouvements de matière et de foule dans l’image, que par une conception énergétique du montage donnant la sensation que « le cadrage est une découpe dans le fluide qui le déborde » [88][88] Teresa Faucon, Théorie du montage. Énergie des images, Paris, Armand Colin, 2e édition, 2017, p.164. Les rapprochements entre des scènes éloignées sur le plan géographique et temporel, apparemment déconnectées les unes des autres font émerger cet espoir de communauté : « Mon but consistait à montrer à travers des individus distincts non seulement le particulier, mais aussi le général (…) et qu’ainsi ne se forme pas dans la conscience du spectateur l’image d’un individu isolé, mais celle de tout un peuple. » [99][99] Artavazd Pelechian, « Le montage à contrepoint ou la théorie de la distance » Trafic, n°2, printemps 1992, p.93. Alors que sa filmographie est en grande partie traversée par une représentation de la lutte principalement à l’échelle des nations et des peuples (Au début, Nous) et que la nature, pour peu qu’on la respecte et accepte de vivre selon sa mesure, est un élément avec lequel une vie harmonieuse est possible (Les Saisons), certains films reflètent déjà une inquiétude sur l’hybris humaine (Notre Siècle) et la peur de la destruction de l’harmonie naturelle du monde par l’homme (Les Habitants). Mais toujours, les films de Pelechian sont traversés par une énergie vitale et un espoir, dessinant une communauté qui ne fait que s’élargir jusqu’à inclure les animaux, permettant ainsi d’y voir une « pulsion de vie, qui se lève et se soulève toujours, malgré les forces de coercition, d’oppression, une force vitale générée individuellement pour être reprise et amplifiée collectivement. » [1010][1010] Vincent Deville, « Animal locomotion », in Claire Déniel et Marguerite Vappereau, Artavazd Pelechian : une symphonie du monde, Crisnée, Yellow Now, 2016, p.87. Le cinéaste propose « de relire le 20e siècle comme la mise en mouvement d’une irrésistible ligne de fuite qui tend à mettre l’humanité hors d’elle-même, comme si c’était la seule manière qui lui soit donnée de se reformer malgré tout, malgré le déchaînement de violence qu’elle n’a jamais pu empêcher ». [1111][1111] Luc Vancheri, « Violence figurale du montage cinématographique : prolongements métapsychologiques. Interpositions » (1 – 3 Février 2011) Montage des images et production du sens / Bildgrenzen. Montage und visuelle Sinnproduktion, Colloque international organisé par le FNS Bildkritik eikones (Bâle) et le Centre Allemand d’Histoire de l’Art (Paris), Feb. 2011, Paris, France [en ligne] . Dans chacun de ses films, l’absence d’identification de l’oppresseur ou de la menace confère une valeur universelle à la lutte. Ce qui lui importe finalement est l’affection de l’oppression sur les corps, au sens spinoziste du terme, où l’affection est ce qui accroit ou diminue la puissance d’agir d’un corps [1212][1212] « J’entends par Affections les affections par lesquelles la puissance d’agir de ce Corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, et en même temps les idées de ces affections. » Baruch Spinoza, Ethique, III. Def. 3, 1677, GF Flammarion, p.135. À travers son œuvre, les fuites des hommes comme des animaux, de cette communauté du vivant, pourraient alors apparaître comme mise en action pure d’un corps politique qui tend vers l’émancipation.
J’en viens à la déception qui fût la mienne devant La Nature. Sa présentation à la Fondation Cartier en regard de deux films antérieurs laissait présager un film dans la continuité de son œuvre. La Terre des hommes, qui peut être vu comme une actualisation des symphonies urbaines du début du vingtième siècle, met en scène l’activité humaine dans une ville moderne, les hommes et les femmes formant une communauté dont le travail est l’une des expressions de la cohésion. Pelechian y propose une certaine héroïsation de l’humanité, qui donne au monde sa forme et son mouvement grâce au travail et à la production. Si l’on tend une ligne entre La Terre des hommes et La Nature, la conclusion est désespérante. Quelles sont les conséquences, plus de quarante ans plus tard, de l’action des hommes sur leur environnement ? Les Saisons montrait un village arménien où les hommes et les femmes vivent selon le rythme des saisons et le mouvement des éléments. Qu’en est-il, aujourd’hui ?
Ce film marque le passage de Pelechian au travail de l’image numérique. Comme à son habitude, il s’agit d’un montage d’images, cette fois prélevées sur Internet, et peut-être est-ce là une raison de son caractère, non pas pessimiste, mais complètement apocalyptique. La Nature est un montage brutal d’images-catastrophes, disponibles à portée de clics, qui s’enchaînent selon leurs thématiques : éruptions, inondations, explosions, ouragans… Devant ce déchaînement catastrophique se bousculent les références littéraires et cinématographiques. On pense au Déluge, en voyant l’eau raser de la surface de la Terre les habitations et les personnes qui courent, dans une tentative désespérée d’échapper à des vagues bien plus fortes qu’elles ; au pire des films catastrophes et des films de guerre, lorsque les gravats des explosions de puits d’extraction de gaz retombent dans les rivières en contrebas comme des pluies de missiles. À l’espoir et à la vitalité qui émergeaient jusqu’à présent de ses films se substituent le chaos et la destruction, jusque dans la forme même. La qualité des images alterne sans cesse entre basse et haute définition, la première jouant sur une indiscernabilité des figures assez caractéristique du travail de Pelechian, la seconde tellement élevée qu’elle apporte un aspect déréalisant.
La Nature adopte une construction simple, et bien plus linéaire que ses films précédents, comme en atteste le scénario-synopsis exposé à la sortie de la salle, qui découpe le film en soixante-six séquences dont le contenu est donné en quelques mots empruntés au champ lexical de la catastrophe naturelle (« glissements de terrain », « inondations », « avalanches » etc.) et se conclut sur la note d’intention suivante : « D’une part, c’est un avertissement aux gens de la fragilité du globe terrestre où habite l’humanité. D’autre part, c’est un appel imagé pour que les gens ne soient pas seulement occupés à lutter les uns contre les autres ou, disons, à s’armer les uns contre les autres, mais à l’inverse, un appel à la nécessité de s’unir afin de résister d’un commun effort aux différentes menaces de la nature, au nom de la défense et de la sauvegarde de toute la civilisation. » Le cinéaste semble ici faire abstraction de la responsabilité de l’homme, dont il s’inquiétait pourtant dans ses films précédents, et nous encourage à nous rassembler contre une nature présentée comme menaçante, alors même que le déchaînement d’images de catastrophes naturelles et technologiques de La Nature m’apparaît comme autant de conséquences du dérèglement climatique, et de l’action humaine. La ligne de partage ainsi créée par le cinéaste entre l’homme et la nature est aussi grossière que surprenante.
Avec La Nature, on est très loin de la finesse du travail de montage, de la musicalité et du rythme du film, qui nous donnaient à revoir des images pour y découvrir une conception poétique du monde, une vision sensible de l’Histoire. Des images de Nous, film-hommage au peuple arménien réalisé en 1969, surgissent dans La Nature, et avec elles, le génocide arménien rejoint les catastrophes naturelles. En prélevant ces images d’Internet pour les donner à voir sur l’écran de cinéma, au contact d’autres, le cinéaste n’invite pas tant à une nouvelle manière de les voir qu’il ne les redouble, nous laissant sidéré.e.s face à la catastrophe infinie à laquelle nous sommes invité.e.s à assister. Il n’y a même plus d’espoir de beauté dans un monde où les seules images de la nature paisible ressemblent à d’insipides images de synthèse, peut-être bientôt le dernier moyen d’accéder à ce qui n’existera plus. La nature (en prise de vues réelles) apparaît comme un déchaînement qui dégueule les humains et leurs déchets, démolit leurs constructions et leurs habitats. Il ne reste pas grand-chose des films précédents d’Artavazd Pelechian, de la nature sublime mise en mouvement avec grâce, de l’espoir dans la communauté, des images agencées avec une précision infinie au moyen de la truca, du lien organique qui unissait l’image et le son. Il ne reste dans La Nature que les éléments les plus apparents du style de Pelechian : le noir et le blanc, le déchaînement du mouvement, les images de seconde main… mais tout cela appliqué paresseusement dans un film sans espoir. C’est d’une façon radicalement différente que Pelechian conclut aujourd’hui son œuvre, nous plongeant dans le chaos après le lumineux Vie. Vingt-sept ans plus tard, il semble ne rien rester à sauver du monde post-soviétique, alors que nous persévérons à nous enfoncer dans un désastre écologique.
Fondation Cartier pour l'Art Contemporain
Commissaires : Hervé Chandès et Thomas Delamarre, assistés de Sidney Gérard
Crédits photo :
- Vue de l'exposition
- Les Habitants, 1970
- Artavazd Pelechian, La Nature, images du film, 2020 © Artavazd Pelechian. DR.