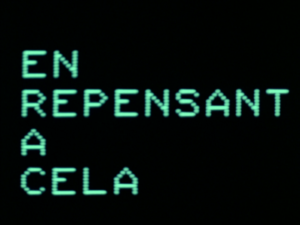Notes sur la Palestine (1)
Postmoderne propagande
Ce texte est la première page de nos Notes sur la Palestine.
Il n’est simple pour personne de « prendre position ». Commençons donc, d’abord, par répondre aux exigences : aucune bombe, aucun missile, aucune mort ne nous réjouit. Nous pourrions partager les mots de Sayed Kashua, écrivain arabe israélien réfugié aux États-Unis depuis 2014, dans Libération : « J’appartiens au camp des lâches, à ceux qui se rendront dès qu’il y a des vies humaines en jeu. » Cependant une revue comme la nôtre a le devoir, face aux discours rigides, rigidifiés par un pouvoir qui ne tolère pas la moindre position divergente (et qui soutient « inconditionnellement » le gouvernement d’Israël – inconditionnellement, vraiment ?), de prendre un peu de recul sur la situation. De rappeler que ce conflit n’est pas né le 7 octobre, mais que le 7-Octobre est un nouvel événement abominable dans une histoire qui en compte des dizaines. Que le gouvernement israélien nous rappelle que l’extrême droite, malgré (ou plutôt par) ses politiques sécuritaires, militaristes et coloniales, crée les conditions de la violence au lieu de l’éteindre. Qu’une démocratie – ce qu’Israël prétend être – ne saurait répondre à la violence indiscriminée par une autre violence indiscriminée. Que le peuple Palestinien a, lui aussi, droit à la paix et à la terre.
Il semble cependant que prendre un certain recul analytique soit désormais condamnable, voire condamné. On pense à cette séquence devenue virale où Stéphanie Latte Abdallah, invitée sur Public Sénat, tiendrait des propos « troublants » parce qu’elle fait, en tant qu’historienne, une distinction entre le Hamas et Daesh ; on pense à la remise d’un prix à l’écrivaine palestinienne Adania Shibli, qui devait avoir lieu au salon du livre de Francfort, finalement annulée, afin, dit-on, de rendre plus « audibles » les voix israéliennes ; on pense à des accusations « d’apologie du terrorisme » lancées à tort et à travers. Nous avons l’audace de penser que c’est précisément dans des moments de crise que toutes les voix doivent se faire entendre, et que des paroles de chercheur·euses peuvent le plus dissiper tous les « troubles ». Ci-dessous, et dans les semaines qui viennent, quelques notes au sujet de quelques images du conflit.
Postmoderne propagande
Depuis les crimes terroristes du 7 octobre perpétrés par le Hamas et le début de la réponse génocidaire de l’État israélien qui s’en est suivie, les internautes français·es ont vu fleurir d’étranges publicités ciblées, tantôt au détour de leur feed « X », tantôt placées avant le démarrage d’une vidéo visionnée sur YouTube ou Twitch. Ces courtes séquences de propagande reprennent parfois les codes classiques de l’hommage aux victimes d’une catastrophe : sur fond noir, un décompte en capitales d’imprimerie blanches et des photographies de visages qui défilent en surimpression. D’autres font appel à des références visuelles autrement plus surprenantes, voire choquantes dans leur usage. Ainsi ce court métrage d’animation volontiers enfantin, mettant en scène une « Maman Ourse [Mama Bear dans la vidéo, car tous ces clips sont en anglais pour s’adresser, comprend-on, à l’Occident pris comme un tout] » en sa paisible forêt, prenant soin de son ourson tandis qu’une voix off narre son existence idyllique. Soudain, des loups noirs aux yeux rouges luisants brisent la sérénité de la clairière. S’en suit un combat sanglant entre la mère et les assaillants à l’issue duquel, blessée, celle-ci contemple, impuissante, son enfant se faire enlever. La lutte ne se déroule pas que dans un espace naturel : une scène en particulier montre l’ourse se réfugier dans une cabane et peser de tout son poids contre la frêle porte de bois, par les interstices de laquelle les loups agitent leurs pattes acérées. Une scène qui n’est pas sans en évoquer une autre, moment primitif du cinéma suprémaciste[11][11] Une séquence de Naissance d’une Nation de Griffith (1915) montre des Noirs s’en prendre à une famille blanche, retranchée dans une cabane. La lutte se concentre autour de la porte de bois que les assaillants tentent d’enfoncer, avant que le Ku Klux Klan ne vienne à la rescousse. Cette séquence a largement été analysée comme scène fondatrice de l’unité nationale étatsunienne sur fond de suprémacisme blanc..
La propagation de ces images, ainsi que l’ont montré plusieurs journalistes spécialistes de l’analyse des réseaux sociaux, a mobilisé un budget supérieur à 10 millions de dollars et ont fait l’objet d’une série de stratégie de contournement pour figurer devant des vidéos grand public, malgré les restrictions prévues par les créateur·ices de contenus. Comme l’explique le journaliste Vincent Manilève, les publicités, sur YouTube, sont supposées être étiquetées en fonction du type de contenu auquel elles renvoient (divertissement, jeux vidéo, bien-être, politique…) : un étiquetage que n’a pas cru bon de respecter la communication étatique israélienne, se référant davantage au genre de la vidéo et au groupe visé (« enfance », par exemple) qu’à son message politique.
Le brouillage des genres auquel se livre cette stratégie de communication est visible partout. En témoigne la séance presse organisée pour la presse internationale au sein d’un véritable cinéma à Jérusalem. Le film montré aux journalistes invité·es consistait en un montage de 45 minutes établi à partir des vidéos du massacre du 7 octobre, extraites des caméras piétons des soldats israéliens, de la vidéosurveillance ou des GoPro utilisées par les assaillants. Les journalistes ayant participé à la séance ne s’y trompent pas – y compris les soutiens de l’État israélien : il s’agissait d’une séance de cinéma, ou du moins, d’un effort conscient de remédiation des images du massacre au sein d’un dispositif cinématographique.
Ces pratiques ne sont pas sans évoquer les textes de Paul Virilio sur la guerre et le cinéma, et le livre de William Mitchell sur les images du 11-Septembre et de la guerre en Irak. La lecture du premier, en particulier des pages sur le rôle de la salle de cinéma lors de la Première Guerre mondiale, a coïncidé avec la découverte de ces photos de visages sidérés, le regard happé par un grand écran. Pour Virilio :
« Les salles de cinéma sont également des camps d’entraînement qui créent une unanimité agonistique insoupçonnable, en apprenant aux masses à maîtriser la peur de ce qu’ils ne connaissent pas ou plutôt, comme disait Hitchcock, de ce qui n’existe pas, car affirmait-il, ‘nous créons essentiellement la violence à partir de nos souvenirs…’ [22][22] Paul Virilio, Guerre et cinéma, logistique de la perception, Paris, Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinéma, coll. « Essais », 1984, p. 53 »
Et pour toutes celles et ceux qui ne pourraient logistiquement (pour reprendre le terme de Virilio) être amené·es dans une salle afin d’être exposé·es à une bande d’actualités cinématographiques, il faut trouver un autre moyen de s’adresser au « système nerveux » international et de l’entraîner à adhérer à la guerre menée à Gaza. C’est la première forme qu’ont pris ces stratégies globales qu’étudie Mitchell, lorsqu’il observe le trajet des images produites par la machine de guerre étatsunienne lors de la « War on Terror » menée après le 11-Septembre :
« [U]ne guerre contre le terrorisme, tout comme une ‘guerre contre le système nerveux’ [ou ‘guerre des nerfs’], est littéralement impossible à mener. Et pourtant, ces métaphores ont toutes deux fait l’objet d’une actualité historique et matérielle dans la première décennie du XXIe siècle, littéralisées et réalisées par la machine militaire la plus puissante de la planète. Et ce procédé de littéralisation, loin d’être mené inconsciemment, a été affirmé et théorisé par des conseillers politiques clefs de la période. Le journaliste Ron Suskind rapportait ce mot d’une éminence grise de Bush, peu avant l’élection de 2004 : […] et vous [les journalistes], tous autant que vous êtes, n’aurez plus qu’à étudier ce que nous avons fait.’ [33][33] « [A] war on terror makes about as much sense as ‘war on nervousness’; it is a literal impossibility. And yet undeniably became material, historical actuality in the first decade of the twenty-first century, literalized and realized by the most powerful military machine on the planet. And this process of literalization was not done unconciously, but was explicitely affirmed by key political advisers in this period. Journalist Ron Suskind reported on the following conversation with a key Bush aide just before the 2004 presidential election: ‘[…] and you [the journalists], all of you, will be left to just study what we do’. » W. J. T. Mitchell, Cloning Terror. The War of Images, 9/11 to the present, Chicago, University of Chicago Press, 2011, p. 13, traduction non officielle. »