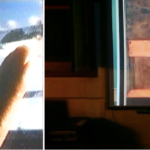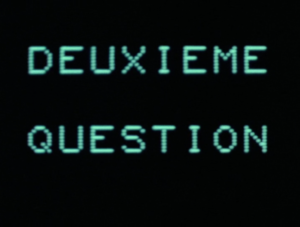Portraits de l’autre côté du miroir
Sur cinq Exercices d’admiration de Vincent Dieutre (2004-2017)
Lui :
« Mais réfléchir, c’est simplement attendre comment l’œuvre va se mettre à occuper l’esprit du critique. Et d’abord, si cela va ou ne va pas appeler un commentaire. Le critique saura qu’il est intéressé, et ce qui l’intéresse, en se mettant à écrire sur l’œuvre. L’intérêt se reconnaît à ce que l’intéressé consent une dépense en mots et en phrases à propos de la peinture. Laudatifs ou péjoratifs, peu importe. Si l’œuvre obtient d’être commentée, elle aura été intéressante pour le critique puisqu’il aura consenti le travail d’un texte et son risque.
Elle :
Une femme trouve un homme intéressant. Elle le lui laisse entendre. C’est aussi un risque qu’elle court, elle ‘prend sur soi’, comme on dit, elle s’expose, sans garantie d’être ‘rétribuée’.
[…]
Elle :
La seule chose intéressante, c’est d’essayer de parler la langue d’un autre, que l’on ne comprend pas.
Lui :
Énigme de la traduction. »
Jean-François Lyotard,
Moralités postmodernes, « Intéressant ? », p. 50-51 ; p. 58.
Exercice de postmodernité
À en croire Vincent Dieutre lui-même, l’appellation d’ « exercice d’admiration » (Ea) sous lequel il range une partie de sa filmographie ne proviendrait pas du titre que Cioran avait donné à son recueil de portraits sur les grands poètes qui lui ont « appris à raisonner », mais d’une formule de Jean-François Lyotard issue des Moralités postmodernes.
« Le postmodernisme [de Lyotard], nous dit Dieutre, est profondément un acte réflexif : il faut admettre, comme disait Guy Debord que ‘le monde est déjà filmé’, et que l’on arrive après quelque chose qui est déjà épuisé. Étendue à tout l’art, une telle conception postule que tout geste artistique sera forcément un emprunt, une citation. […] Puisque la situation actuelle pourrait être caractérisée comme un état de rupture avec la rupture engendrée par la modernité elle-même, [l’idée de Lyotard] est que l’œuvre postmoderne, fondée sur l’idée de rupture avec le modernisme, serait nécessairement un exercice d’admiration du passé. »[11][11] Voir notre entretien, “L’être aimé est la médiation entre les sphères“, publié fin août 2018.
De Cioran, néanmoins, Dieutre retient la liberté tragique de la modernité, ce « bricolage dans l’Incurable » qui est moins un constat de la vanité des formes que de leur impuissance à l’heure où l’intertextualité devient le nouveau marché commun de la culture de masse. Cette modernité, Dieutre lui donne régulièrement une forme tangible dans ses films : comme le montre le théâtre de marionnettes qu’il met en place à Palerme (Orlando ferito, 2015) et avec lequel il s’efforce de rejouer, le livre de Georges Didi-Huberman Survivance des lucioles en main, les drames de l’Italie contemporaine, il s’agit principalement de celle du sentiment que certaines choses ne sont plus, et que malgré tout d’autres n’en finissent pas d’exister. Du « choc du moderne et de l’archaïque[22][22] Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?, Rivages, 2008. » dont Giorgio Agamben fait le propre de notre épistémè contemporaine, de la destruction en règle des formes dont le rêve d’accord avec leur époque pourrait être appelé « classique », l’admiration de Dieutre retient ainsi la possibilité d’une transmigration ou d’un itinéraire à travers les œuvres.
En effet, les Ea reprennent des thématiques centrales du cinéma de Vincent Dieutre (l’histoire de l’art, la notion d’identité culturelle et nationale, le rapport au passé et l’ouverture au contemporain) tout en les examinant sous une réflexion nouvelle et originale par rapport aux autres cycles de sa filmographie (par exemple le cycle des « films d’Europe » que composent Rome désolée, Leçon de ténèbres, Mon voyage d’hiver, Bologna Centrale ou plus récemment Orlando Ferito). Cette réflexion n’emprunte que de biais la forme du pastiche pour interroger pleinement le problème du style. Cependant, cette pensée du style n’a rien à voir avec la reproduction béate, qui lui fait horreur. Dans l’article de 1997 « Les règles du je », qui apparaît par bien des points programmatiques du cinéma postérieur de Dieutre et particulièrement de ses Ea, il récusait déjà un fétichisme de la « manière d’auteur », ces éléments distinctifs du style, leur part reconnaissable de signature :
« Derrière cette blancheur stylistique, cette hantise de la référence, de la manière (la main, le regard d’un cinéaste) se cache sans doute l’impuissance de la fiction traditionnelle à rendre compte de la complexité des phénomènes et de la ‘condition post-moderne’ [33][33] Vincent Dieutre, « Les règles du je », La lettre du cinéma, no 3, 1997, p.88.. »
À ce diagnostic succèdera la tentative d’élaboration d’un style dépersonnalisé, pour lequel la référence ou la citation, moins qu’une protection derrière un argument d’autorité, invite au contraire à s’emparer profondément des œuvres pour les commenter, les annoter. Si de l’amour qu’un artiste porte à un autre à travers les formes que celui-ci a conçues il semble presque impossible – et inutile – d’expliciter les raisons intimes, c’est donc dans le sens d’une communauté stylistique, de ses fidélités et de ses irrévérences, que nous voudrons alors parler chez Dieutre d’ « admiration ». Dans ses « Exercices », Dieutre regrette aussi bien l’absence de connexion avec l’histoire qu’il se lance à la poursuite de l’hypothèse foucaldienne qu’un « esprit », qu’une vérité de l’époque et de la culture, surnage quelque part dans les formes historiques, esthétiques et culturelles d’une tradition artistique. Dieutre est sans doute l’un des cinéastes les plus à l’écoute de cette translatio studii qui a marqué l’histoire du continent européen et dont on ne retiendra pas tant la définition usuelle, unidirectionnelle – l’occidentalisation historique des centres culturels, le déplacement du centre spirituel de l’humanité d’est en ouest – qu’on ne lui prêtera une portée tous azimuts et faite d’allers-retours incessants.
D’éloge privé, l’exercice en vient progressivement à revendiquer l’établissement d’une communauté des auteurs qui soit un droit à l’universalité des rapports de chacun avec les œuvres. Se mettent alors en place les fondations de ce qui pourrait être une éthique de la traduction (pour reprendre les mots de l’écrivain Camille de Toledo, collaborateur de Dieutre pour le film Orlando ferito), voire de la translation (c’est-à-dire de la libre réinterprétation), qui vont jusqu’à susciter, dans certains Ea, une réflexion sur le droit en présence d’un notaire. La pensée du style, engagée comme fidélité à l’ « objet intérieur » d’un cinéaste, se mue peu à peu en une méditation sur les moyens donnés au cinéma : sa production, sa reconnaissance, ses interdits. L’admiration répétée, densifiée, complexifiée, s’avère alors un formidable outil critique de l’histoire et de la politique des formes, venant poursuivre les tentatives élaborées à la recherche d’un Tiers-Cinéma dans la Lettre du cinéma en 2003[44][44] Vincent Dieutre, « Abécédaire pour un Tiers-Cinéma », La Lettre du cinéma, n° 21, 2003, p. 75-85.. D’innutrition à la source du passé, l’admiration dieutrienne glisse en effet depuis longtemps déjà vers la recherche d’une défamiliarisation et d’une distorsion d’un « patrimoine culturel » de toute façon problématique. Elle viserait en fin de compte à mettre en œuvre les moyens matériels et artistiques d’un « communisme des formes » dont Nicolas Bourriaud remarquait l’établissement contemporain dans la sphère de l’art : à une « idéologie de la propriété des signes » il s’agit d’opposer une « culture de l’usage des formes et de leur mise en commun, pour laquelle l’histoire de l’art constitue un répertoire de formes, de postures et d’images, une boîte à outils où chaque artiste est en mesure de puiser. Pour le dire autrement, un équipement collectif que chacun serait libre d’utiliser selon ses besoins personnels[55][55] Nicolas Bourriaud, Playlist, le collectivisme artistique et la production de parcours, Palais de Tokyo, 2004.. »
Sans prétendre nous risquer à la délimitation exhaustive d’un concept d’ « admiration », dont Dieutre rappelle justement, en lui adjoignant le mot d’ « exercice », qu’il est avant tout une pratique – expérimentale, affective et en proie aux circonstances de sa mise en œuvre –, tentons d’en discerner les linéaments avant de proposer une analyse individuelle des cinq Ea réalisés à ce jour.
a) La perte postmoderne
L’ère contemporaine serait marquée, selon le cinéaste, par la conscience d’une perte : celle de ses références formelles et d’un méta-récit dans lequel les inscrire d’une part ; celle du monde lui-même et de la croyance en une action pouvant l’ébranler d’autre part. Dans un tel paradigme historique, la question de la médiation – envisagée sous le double rapport de la transmission depuis le passé et de l’action future – est au cœur de l’entreprise artistique. Comme l’écrit Yves Citton dans un texte accompagnant la parution DVD des Ea, « c’est cette exploration inventrice de nos médias à venir que mettent en scène ces Exercices d’admiration, tout en faisant mine de revenir sur le passé d’émotions indélébiles. » Les émotions venues du passé sont en effet moins indestructibles et inamovibles que réactualisables et en constant déplacement. Pour la subjectivité artistique postmoderne, il s’agirait par conséquent moins de proposer de nouvelles formes que de prendre acte d’une précipitation des formes anciennes et de procéder à leur réarticulation.
b) Translation des formes
Pour Dieutre, il est certain que les choses n’existent pas dans leur signification passée, mais dans leur présentification : c’est là le principe qui préside à la nécessité du voyage, forme spatiale du montage devenant cette modalité particulière de l’attention au monde qui permet de décontextualiser les formes pour mieux faire affleurer leur force défamiliarisante. Si voyager, c’est apporter ses propres formes (ses préjugés, avoue-t-il) pour s’attendre à les voir se distordre à l’épreuve de la réalité, il s’agit bien là de la première étape d’une transformation dont l’aboutissement sera l’œuvre elle-même. Réciproquement, la marque des choses du passé sur les corps contemporains sera, selon la belle formule du cinéaste, la preuve de leur « remise en liberté dans l’aujourd’hui ». Son projet se présenterait alors comme une histoire des influences formelles sur le présent à partir de laquelle retrouver la communauté culturelle que ces formes suggèrent : « Essayer de trouver un inconscient collectif européen, voilà ce qui m’intéresse. »
c) Repartir de la subjectivité
La nécessité de repartir de sa propre expérience devient ainsi un impératif de la démarche du cinéaste, qui postule que dans la subjectivité de chacun se rejoue à l’échelle intime la sédimentation historique propre à l’état postmoderne du monde. « L’artiste d’aujourd’hui, dit encore Dieutre, est une sorte de filtre qui concentre des œuvres dans l’anachronisme le plus total : certes, la subjectivité artistique demeure, mais n’est plus qu’un agencement de références. C’est un fait qu’il ne faut pas dissimuler mais au contraire célébrer, revendiquer. » Son œuvre cherche alors à proposer une histoire corporelle du passé agissant sur le présent, et dont le lieu privilégié est sans doute l’œuvre d’art et l’effet que celle-ci produit – comme mémoire et comme affect – sur la subjectivité. Comme il l’explique dans le documentaire que lui consacre la cinéaste Fleur Albert La chambre et le monde : « Les seules choses que je peux prendre à témoin, ce sont les œuvres du passé et du présent : c’est grâce à elles que je parviendrai à une connexion juste, et non plus médiatisée par des flux, des images, des pouvoirs. » L’œuvre d’art devient la preuve d’une expérience sensible partageable, l’assurance qu’il existe des « émotions honnêtes ». C’est sur cette assise réaliste proprement « physique », fondée sur les qualités tactiles de l’émotion et du rapport à l’œuvre, que débutait ainsi la voix-off de la Leçon de ténèbres : « Émotion, sensation, tout a sombré dans l’équivalence. Il est temps de rétablir quelques certitudes » concernant « ce que tu aimes, et qui tu aimes vraiment. » Caresser Caravage, au début du même film, était peut-être le premier acte de l’œuvre admirative du cinéaste.
d) Une critique fictionnelle et économique des moyens de production du cinéma
Enfin, la poétique que défend Dieutre, qui met en avant l’investissement corporel (le film, dit-il, doit toujours faire « payer de sa personne »), affectif et amoureux (les multiples amours homosexuelles du cinéaste n’ont certes plus le même parfum sulfureux que jadis, mais demeurent encore un dévoilement intime de pratiques encore relativement invisibles et stigmatisées), mais également financier (l’économie du film est souvent très visible dans le film ou dans sa forme même, jusqu’à devenir un enjeu du dialogue des personnages de la fiction) ne peut être qu’une poétique du risque, qui étend à toute réalisation cinématographique les modalités spécifiques de l’autobiographique.
Un mot pour finir, au sujet de la complexité de cette série hétérogène, dont le principe relève si peu du « plan de route » et semble jaillir directement de la contingence la plus pure, quoique favorisée par le désir de cinéma illimité de son réalisateur. On bute aussi devant l’étendue temporelle (2004-2017, la réunion en coffret des cinq premiers Ea signalerait une forme – au moins provisoire – d’achèvement) de cette série qui voit se succéder les supports (le premier est en pellicule, le dernier au téléphone portable), mais surtout les dispositifs, chaque fois réinventés et réadaptés selon les circonstances. Seulement, précisément, cette invention ne se fait jamais à notre insu mais toujours devant nous – comme si nous étions arrivés trop tôt pour voir l’exercice dans sa forme finale, parfaite, qui n’intéresse de toute façon pas le cinéaste. Plutôt, elle engage notre participation et notre suivi de la réflexion de l’artiste, dont l’œuvre se rapproche davantage de celle d’un essayiste au long cours que d’un écrivain ponctuel. En parcourant les cinq exercices achevés à cette heure par Dieutre, nous ne chercherons donc pas une synthèse de la réflexion historique et esthétique du cinéaste : elle ne s’affirme jamais comme telle, mais précisément, à la manière d’un essai, ne se développe qu’en mouvement, chaque film étant l’introduction d’une nouvelle facette – esthétique, éthique, juridique, politique – du problème posé par un style. Comme nous y invite Dieutre, nous espérons dès lors y trouver moins qu’un film achevé, qu’un manifeste ou qu’une étude exhaustive, une pratique du monde des formes propre aux cinéastes lyriques : « À défaut d’une œuvre […], le cinéaste du ‘je’ s’autorise une démarche, une cohérence secrète, qui, de film en film, tresse avec le spectateur une complicité précieuse[66][66] Vincent Dieutre, « La règle du ‘je’ », ibid., p. 88.. »
Ea1 : Naomi Kawase (Les Accords d’Alba)
On ne peut nier l’étrangeté d’inclure dans une série qui traite du cinéma, de l’art et d’une histoire avant tout européens une cinéaste japonaise. On ne peut s’empêcher de remarquer non plus la jeunesse détonante de cette cinéaste, de dix ans la cadette de son admirateur, dans un panthéon qui consacre des réalisateurs ayant déjà marqué de leur empreinte l’histoire du cinéma, ni ignorer sa féminité dans une galerie de portraits d’hommes – ou réinterprétés comme tels – qui témoignera respectivement à Jean Eustache, à Jean Cocteau, à Roberto Rossellini et à Alain Cavalier, une reconnaissance filiale. On ne peut que s’étonner enfin de la singularité rétrospective qui amènera Dieutre à qualifier a posteriori son film sur et avec Naomi Kawase comme « premier essai » de ce que pourrait être la forme cinématographique d’un témoignage d’admiration. Multiplier ainsi toutes ces distances, ce n’est que mieux placer cette série sous le signe de la conviction d’un passage. Ceux entr’ouverts par la cinéaste japonaise – dont le cinéma, dit-elle, est à l’image des habitants de son île natale, aussi bien orgueilleusement reclus qu’avides de traverser l’océan – sont déjà ceux de la traduction.
Les Accords d’Alba[77][77] Renommé a posteriori Ea1 après que la série fut étendue par la rencontre avec d’autres cinéastes. : derrière ce titre en forme d’accord diplomatique bilatéral – du nom de la ville italienne ou Dieutre et Naomi Kawase se rencontrent pour la première fois – se cache, ainsi que l’annonce la voix off du cinéaste, une recherche du « mystère de l’art », de la transmission sans langage, de la proximité sans géographie. Ce film augure ainsi deux dimensions fondamentales de l’admiration, que l’on retrouvera par la suite à mesure que la série s’étoffe : celle du retournement réflexif sur le dispositif médiatique rendant possible ce sentiment esthético-historique qu’est l’admiration ; celle de la distance incommensurable qui tout à la fois unit et sépare les artistes et les formes, et rend nécessaire – comme acte d’amour même – un art du travestissement.
Tout dictionnaire étymologique donne au premier sens du verbe latin admiror non pas celui désormais courant d’appréciation esthétique ou morale d’un acte, d’un objet ou d’une personne, mais d’abord celui d’une stupeur, d’une force d’émerveillement et d’étonnement dont il s’agit pour ces deux cinéastes temporairement jumelés par l’image de sauvegarder l’intensité. Ces Ea sont ainsi initialement placés sous le signe d’un « exercice de surprise » ou d’ « étonnement » : devant la réalité certes, mais aussi devant le cinéma lui-même et ses techniques d’enregistrement et de médiation dont nous oublions le caractère « extraordinaire », permettant de « conserver les sentiments d’une personne du passé », selon les mots de la jeune cinéaste. Mais cet émerveillement technique est bientôt redoublé par la conscience de la fausseté, ou plutôt de l’insuffisance, de ce qu’il nous faisait croire. C’est qu’un rapprochement formel seul ne peut suffire à prévenir le fait qu’il puisse s’agir d’une rencontre manquée, et la solution technique trouvée par Dieutre pour donner à voir le cinéma de la Japonaise ne pouvait accomplir le miracle tout romanesque d’une scène de rencontre. Bien au contraire insiste-t-il sur les difficultés même d’un tel dialogue. C’est d’abord une façon particulière de redoubler en pellicule l’écran de télévision sur lequel il regarde les documentaires de la cinéaste avant de la rencontrer. Surtout, durant leur rencontre rendue complexe par l’absence d’une langue commune, c’est le dispositif d’entretien mis en place par Dieutre, qui se trouve singulièrement distendu, désorganisé par une temporalité flottante ; dans l’interstice de ce qui aurait pu être un simple échange entre deux artistes commentant des images se glisse alors le temps de cet exercice de concentration et d’attention.
« Dans ce film, la question de la langue est capitale : tout le temps du film est celui de la traduction, la caméra s’attache à filmer quelqu’un qui traduit. Naomi Kawase ne parle pas l’anglais, et cela devenait fascinant de se sentir si proche de quelqu’un avec qui j’avais un mal fou à communiquer. Les premières minutes du film sont très fastidieuses. Dès lors, deux solutions s’offraient à moi. Soit j’essayais de le masquer, et faire parler Naomi Kawase avec des sous-titres ; soit au contraire je filmais ce trouble. C’est ce que j’ai fait, et la traductrice devient actrice du film, et donne au film son sujet : comment communiquer avec ma petite sœur ? »
La transmission est un thème abordé très tôt dans le film, à partir de la réalité géographique de l’insularité japonaise d’abord, mais surtout par la suite à travers le rôle de l’image dont Kawase nous dit qu’elle est – essentiellement – une « traversée ». Bien sûr, une traversée du monde, un arpentage – que l’on éprouve par ailleurs de façon très sensible dans les « films de voyage » que Dieutre a consacré à de nombreuses capitales culturelles européennes – mais surtout plus fondamentalement, un départ pour un autre monde. Si comme le considère la cinéaste, on ne s’approprie rien par l’image, le documentaire alors est un terme impropre – pour ses films comme, on le devine, pour le film que nous avons devant les yeux. Documentaire, dit-elle, c’est un terme de chercheur, d’archiviste ; le cinéaste lui cherche à élaborer une autre vie, à faire traverser le spectateur dans le monde des images. Donner son nom, introduire une partie de son corps dans le film (Dieutre, suivant une autre tradition française inaugurée par Cavalier, « s’y met tout entier »), faire palpiter la caméra de la présence, de l’existence du filmeur, ce serait assurer son existence dans l’autre monde du cinéma. Il ne faudrait pas néanmoins considérer cette tentation comme l’acte égoïste d’un être attaché à la survivance de son image en dehors de son temps, mais avant tout comme celui d’un amour pour les formes et leur devenir propre. Que peut être un documentaire qui prétend fuir le monde pour traverser vers l’ « autre-côté » ? Il faut croire qu’au contraire il ne s’agit que d’être présent et attentif, répondre, réagir avec les formes elles-mêmes : « Le cinéma, c’est répondre au monde. » Alors l’admiration reprend un autre thème, qui n’est plus l’ « étonnement », mais celui d’une autre variante étymologique : celui du miroir dont il s’agit moins d’admirer que d’en traverser la surface réfléchissante. « Tout le monde veut passer de l’autre côté du miroir » dira Dieutre, avançant de quelques années sur le dispositif qu’il mettra en œuvre dans son second Ea, celui-là même qui lui fera rebaptiser le premier : se mettre en scène, frontalement, à la place de l’actrice dont il pressent qu’elle peut être un guide, presque un médium, vers le cinéma de Jean Eustache.
Ea2 : Jean Eustache
Comme l’Ea précédent, ce court film en pellicule 16mm noir et blanc tente de se mettre dans les pas d’un cinéaste et de ses plans, en reprenant l’interrogation du passage et du miroir. Comme il essayait auparavant de reprendre certains cadres de Naomi Kawase en filmant sa propre ombre, Dieutre rejoue maintenant le monologue face caméra et le texte très écrit de Jean Eustache à la fin de La Maman et la Putain (1973). Le but ouvertement revendiqué de l’exercice est de saisir la quintessence d’un style, de l’essayer dans tous les sens : interroger une méthode (d’écriture et de direction d’acteur principalement), l’approcher, la pasticher, comprendre ce qu’elle peut apporter à sa propre pratique sans la répéter servilement.
« On n’admire véritablement […] qu’en devenant ce qu’on admire » avance Yves Citton dans son Éloge de l’admiration dieutrienne. Il ajoute : « Ce qui paraît a priori relever de la gymnastique actorielle tient en réalité de l’exercice spirituel (évoqué aussi dans le dialogue à distance avec Alain Cavalier) : en se mettant en devoir de répéter (repeat) les mêmes phrases passionnées, on répète (rehearse) un rôle fantasmatique. » C’est donc bien dans un interstice entre performance et lecture que se glisse l’admiration : tantôt projection identificatoire dans un personnage (et possiblement dans le rôle d’Eustache lui-même), tantôt distance réflexive avec un texte dont la matérialité sans cesse questionnée met en jeu l’adhésion fictionnelle au récit – dans cet Ea l’on apprend que le monologue de Françoise Lebrun est en partie lu durant sa performance pourtant si criante de « naturel ». Mais que gagnerait-on à s’exprimer dans le style d’un autre, si le style ne revient qu’à l’expression forcément singulière et impartageable d’un problème universel. Au contraire, Dieutre fait le pari inverse : que d’une même forme l’on parvienne à diverses significations. Car un sens profond de la notion de style paraît derrière cet essai des techniques d’un autre – il s’agit de croire, de vouloir croire que la vérité des pratiques découvertes par un cinéaste singulier puisse être autre chose que l’expression directe d’un « objet intérieur » et subjectif ; de croire que le style cinématographique puisse lui aussi être une méthode à partager, à explorer, à essayer, à réinventer. Cette croyance se joue dans cet Ea par un dispositif qui fait vaciller l’ordre physique du corps, qui cherche l’épuisement dans la pratique, le trop plein dans la redondance. À la pluralité des voix qui tentaient de traduire l’intraduisible dans Ea1 s’ajoute ici l’exigence un peu absurde mais pleine de grandeur d’une exactitude du « j’en ai rien à foutre », d’un art oratoire de l’ « aucune importance ». L’enseignement de Ea2, s’il en est un, c’est bien d’ « épuiser l’état dans lequel tu es » comme le dit Françoise Lebrun à Dieutre, de parvenir à une nouvelle forme qui serait, chez le cinéaste, le monde des œuvres. Mais la dissonance concertée avec l’œuvre originale ne s’arrête pas là. À quoi servent ces exercices ? Des remises en scène ? Des pastiches ? Françoise Lebrun annonce, catégorique, que « ce n’est pas une reconstitution », mais une actualisation, et qu’il s’agit simplement de « revivre des choses dans une autre histoire », celle de Dieutre. À cet effet, le texte a été modifié (les formes féminines sont transposées au masculin, et, plus significativement, on comprend bien que Dieutre fait référence à son expérience amoureuse personnelle), et dans le film de Dieutre, c’est à Françoise que « Vincent » s’adresse. Épuiser pour faire reparaître, dilapider pour retrouver, voici la leçon à laquelle cet exercice nous renvoie. L’admiration s’y précise comme « exercice gestuel de cinéma », elle y postule que l’on n’admire pas simplement, esthétiquement, comme un critique ni comme un jouisseur : mais seulement comme un essayeur doublé d’un essayiste.
Ea3 : Jean Cocteau
Ce nouvel exercice persévère dans l’élaboration d’un dispositif duel divisant le moment de l’admiration entre un moment de réflexion sur l’œuvre et un moment du jeu de l’œuvre. Cependant, au fur et à mesure que l’admiration se déplace, se densifie et se nourrit d’elle-même comme par un jeu d’écho, cette distinction s’avère de plus en plus brouillée, et la mise en œuvre du jeu s’étend peu à peu à toute la structure du film. Cet Ea propose ainsi un mélange entre une fiction classique, l’interprétation du monologue de Jean Cocteau La Voix humaine (1930), et un « doublage » de cette fiction par l’enregistrement en studio, au micro, de ce même texte. L’œuvre est ainsi doublement interrogée par le corps de l’acteur dans l’image de fiction – dans un parc, au téléphone, puis en voiture la nuit – et par la voix de celui-ci en studio, dont l’image nous livre une interprétation seconde, une nouvelle incarnation. Car c’est paradoxalement en se distinguant, en se distanciant de l’œuvre originale que l’admiration se propose d’œuvrer au « bon déroulement » de la re-présentation en même temps qu’à sa déstructuration. L’image cinématographique elle-même poursuit cette entreprise de cristallisation via des superpositions qui, laissant voir une image sur une autre avec un effet de décalage presque musical – proche du canon –, y rendent visible une latence profonde de la fiction. Il s’agit pour Dieutre de renouveler à ses conditions propres le pacte fictionnel avec le spectateur, de viser à la fois le décentrement de la perception classique d’une fable et l’exposition – économique, politique – des moyens de la reconstitution de celle-ci. Ici, le récit joué sur le mode phatique du contact – médié par une conversation téléphonique amoureuse qui rend la proximité aussi nécessaire qu’impossible – s’avère le dédoublement d’un autre drame qui se joue entre le film et le spectateur, et qui pourrait bien être le drame de toutes les œuvres d’arts, celui de l’atteinte.
À partir de l’anecdote convenue et des passages obligés de la topique amoureuse, le projet commun que se proposent Dieutre et Cocteau – ou plutôt Dieutre par Cocteau, ou peut-être encore Cocteau par Dieutre – serait une tentative pour accéder à un modèle de la communication amoureuse. Si chez Dieutre le rapport amoureux est d’abord tactile – selon le modèle caravagesque de la Leçon de ténèbres – et si son rapport à l’image est avant tout figural, on ne peut qu’apprécier le choix de cette forme intensément contrainte qui l’oblige à réinventer dans le langage les possibilités d’une étreinte. C’est tout d’abord le dispositif de redoublement que nous avons présenté qui permet au film sa fourche énonciative. À la pluralité des adresses – celle du personnage principal à son amant absent par le biais du téléphone, mais aussi celle de l’acteur au dispositif cinématographique lui-même – s’ajoute de multiples franchissements de niveaux énonciatifs. Par exemple, Dieutre cinéaste s’adresse à plusieurs reprises à son acteur pour le diriger, et termine le film par une lettre aux ayants-droits de l’œuvre de Cocteau. Cet effet de redoublement accomplit alors le double programme de la destruction du modèle théâtral classique et de la dramatisation de l’acte langagier. Car dans le dispositif du film, le dédoublement de la question médiatique, technique, permet de toucher au vif de la réflexion sur le dialogue amoureux proposée par Cocteau. Le défi princeps de la communication est présent dès le début du monologue, qui débute par la répétition presque grotesque des ratés du dialogue, des erreurs de numéros, et se poursuit par la répétition aussi comique que pathétique des : « Tu m’entends ? » désespérés. Les premiers « …comme si tu étais à côté » puis « maintenant c’est moi qui ne t’entends plus […] comme si tu étais très loin » participent à une comédie amoureuse du téléphone qui apparaît quelques années avant Cocteau chez Proust, dans Le Côté de Guermantes avec la grand-mère du Narrateur puis avec son amante une fois Albertine disparue, et qui déjà s’y transformait en une tragédie réglée par les « ombrageuses prêtresses de l’Invisible, les Demoiselles du téléphone. » La Voix humaine elle aussi bascule rapidement dans une tonalité plus sombre : « On croit être mort – on entend et on ne peut pas se faire entendre ». Le tragique du fil téléphonique – dont les déchirants « Allô, allô » sont le paradigme de ces appels phatiques qui redoublent et matérialisent le seul véritable enjeu de la conversation amoureuse : « Tu es là ? Tu vas bien ? » – est ainsi élevé à la puissance mythologique par le dramaturge pour qui le « coup de fil » et la « coupure » de celui-ci ne pouvait signifier qu’une meurtrissure physique et un dialogue avec l’au-delà. De ce premier rapport au dialogue amoureux, il ne faudra bien évidemment pas retrancher la question de l’admiration.
La seconde essence propre au dialogue à distance – outre les affres de la recréation douloureuse du sens de la tactilité – est celle du discours sur la vérité. Aux pathétiques demandes d’une preuve[88][88] Dieutre cite dans Jaurès (2012) cette maxime qu’il attribue à Cocteau : « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. » Elle serait en réalité de Pierre Reverdy, citée par Cocteau comme telle dans sa préface du Mystère de la chambre jaune. de présence qui éclatent à intervalle régulier au téléphone répondent les suppliques de justification réclamées à l’être aimé. Tu me mens ? Tu me crois ? « Je n’ai pas la voix de quelqu’un qui cache quelque chose », répond l’homme, qui dans l’œuvre de Cocteau était une femme : « Non, je ne joue pas la comédie. » Cette substitution repose à nouveaux frais la question de la transmission. Ici la question est envisagée par le rapport à l’acteur et au dialogue, en remettant en jeu le thème de la fidélité sous l’angle de l’adaptation d’un texte, l’absence (ici plutôt la présence) d’écart par rapport à l’original. Le film s’achève d’ailleurs par une lettre – nouveau processus médié, annonçant les lettres à Isabella Rossellini dans l’Ea4, celles de Cavalier dans l’Ea5 – écrite à l’attention des ayants-droits du poète, en expliquant la démarche de réactualisation que proposait le film. Le cinéaste n’obtiendra pas gain de cause et la diffusion du film est toujours compromise.
Après ces trois premiers exercices d’admiration, dont la forme initialement plutôt courte tend progressivement à s’allonger et à se complexifier, la méthode de Dieutre a désormais atteint une certaine maturité. La majorité de ses thèmes s’y sont développés : la complexe relation entre distance et proximité à travers les temps, l’équilibre entre traduction et travestissement des formes, l’engagement du corps filmant lui-même. Mais l’échec économique du dernier film contribue peut-être paradoxalement à l’une de ses plus grandes réussites, lui offrant une nouvelle profondeur et pour ainsi dire un tout nouveau champ de réflexion dont s’empareront les exercices suivants. Il permet à Dieutre (à la fois personnage et cinéaste) de signifier une nouvelle fois l’ouverture du projet de sa série tout en précisant ses intentions : « Vous n’imaginiez pas ce rôle tenu par un homme. » dit-il du personnage de La Voix humaine aux ayant-droits du dramaturge. « Ce film n’est pas contre vous, ni contre Cocteau. Ce n’est pas une torsion provocatrice ou une déconstruction queer », au contraire, c’est « égoïstement [que] j’ai cherché à comprendre ce qui m’avait tant troublé étant enfant » : « j’ai donné corps à un désir profond » qui transgressait les règles que Cocteau lui-même a émises, répondant à son invitation implicite « à tordre les sens », à ne « jamais les respecter ». « Ni une histoire d’homme, ni une histoire de femme, mais une histoire d’amour », ce film donne l’occasion au cinéaste de développer à une toute nouvelle latitude la question de l’adaptation, de la réactualisation ou de la réinterprétation, en versant au domaine juridique ce qui n’avait été jusqu’à présent compris que sous un rapport de fidélité aux formes et aux intentions.
Ea4: Roberto Rossellini (Voyage en post-histoire)
« J’ai fait ce film pour me réapproprier Viaggio in Italia : j’ai plutôt l’impression de régler une dette que de voler quelque chose » annonce Dieutre au début du Voyage en post-histoire sur les traces de Roberto Rossellini. Ainsi introduit-il une des questions principales du film : qu’est-ce que posséder un droit moral sur une œuvre ? Existe-t-il une chose telle que la domination d’un auteur sur des formes ? Après la conversation avec l’artiste, avec l’interprète et avec le texte de l’œuvre, Ea4 aborde maintenant la question stylistique au sens le plus abstrait et trouve dans l’homme de loi un de ses interlocuteurs les plus importants. Une fois encore, Dieutre fait siennes les caractéristiques de l’œuvre admirée tout en aménageant certaines de ses caractéristiques. Deux exemples : ce ne sont plus un homme et une femme, mais deux homosexuels qui viennent à Naples pour donner à la déréliction de leur couple la pétrification tragique des amants surpris par les cendres du Vésuve ; de même, la séquence finale de la procession traditionnelle de San Gennaro n’est pas tournée à nouveau (alors que le reste de l’exercice propose un remake quasi exhaustif du film de Rossellini) : c’est l’œuvre originale elle-même qui se trouve intégrée à l’histoire de l’Ea. Cependant, loin de décisions destinées à faciliter les conditions de la remise en scène du film, les torsions que Dieutre fait subir à la lettre de la fiction constituent bien les règles de la méthode d’admiration : cette recherche de la contrainte sensible dans tous les films « à règles du jeu » du cinéaste, vise à formuler l’écart le plus grand possible entre le matériau d’origine et sa reprise, afin d’en ménager des frictions productives. Ea4 est principalement l’exercice de ces frictions – entre l’œuvre et la reprise, entre le passé et le présent. Dans Ea4, c’est la question du droit de remake qui joue le rôle de dénominateur commun entre la question historique (la recontextualisation du présent pour une époque oublieuse de son contexte) et la question juridique (la reconstruction d’un espace commun des formes) ; elle se trouve une fois de plus, suivant la voix ouverte avec Cocteau, mise en tension par une histoire amoureuse.
Manifeste pour un « droit d’admiration »
Comme l’explique l’avocat dans l’une des séquences plus théoriques du film, le droit de remake est fondamentalement un droit de producteur. Il s’agit d’un droit d’exploitation – presque un brevet industriel – de « l’univers » du film original, dont la reproduction n’est pas différente de la copie en série d’un objet technique. Le droit de citation, seul droit de reprise accordé à l’artiste, est quant à lui limité par le respect de l’intégrité de l’œuvre originale : la citation ne doit pas léser l’œuvre première et ménager son intérêt futur pour un spectateur désireux de la découvrir ultérieurement. L’asymétrie de ce rapport au patrimoine culturel est ainsi à l’origine d’un double scandale. Le premier, économique, est celui de la confiscation des formes par une classe possédante, de l’application de la loi de la circulation et de la rétention capitalistes à des objets qui lui sont profondément étrangers. Le second, corollaire du premier, est sans doute encore plus pernicieux : en calcifiant de la sorte les formes pour empêcher leur partage, c’est leur profondeur historique, leur statut même de mise en forme artistique d’une époque, qui se trouve directement menacé. C’est à ce niveau que l’arme dieutrienne de l’adaptation, de l’admiration, est la plus politiquement affutée : « revivre la situation du film dans le contexte d’aujourd’hui » n’est plus du tout comparable aux remakes classiques qui donnent un coup de balai sur la poussière des années et ne resservent au public que de nouveaux visages plus à même de favoriser l’identification. Il s’agit au contraire non seulement de rappeler le droit pour un réalisateur d’avoir la mainmise sur l’intégralité de son œuvre (aux antipodes d’un système qui favoriserait au contraire la propriété artistique des producteurs), mais plus encore de concéder à n’importe quel réalisateur une « licence artistique » lui permettant de s’approprier l’œuvre de ceux qui l’ont précédé. Une telle réévaluation apparaîtrait comme un acte esthétique et politique essentiel, celui d’affirmer la possibilité d’une constellation artistique d’auteurs dont l’objet n’est plus l’œuvre comme « acte artistique achevé », mais comme un matériau nécessairement convertible, réactualisable, à l’origine d’une filiation échappant radicalement aux droits de toute « propriété intellectuelle ». Dans l’ « admiration », nous révèle peu à peu la série du cinéaste, c’est en fait tout un modèle économique qui se joue et qui délimite l’espace d’un territoire à défendre, celui de la libre admiration productive des artistes les uns pour les autres. L’acte même d’admiration devient ainsi la revendication d’un rapport immédiat à la vie des formes, un défi porté à toute capitalisation du fait culturel et artistique.
Culture et admiration : une élégie historique
Une fois ces bases posées, devient alors intelligible l’autre référence cinématographique du sous-titre de cet Ea : « voyage en post-histoire », du nom du concept de Dopostoria que Pier Paolo Pasolini avait proposé, dans un des Poèmes en forme de roses qu’il fait lire à Orson Welles dans La ricotta (« Je suis une force du Passé / Tout mon amour va à la tradition… »), comme caractérisation de la catastrophe anthropologique organisée par le néocapitalisme industriel. La post-histoire ou « Nouvelle Préhistoire » est cet horizon prophétisé par le poète d’un monde où les liaisons entre le passé et le contemporain sont brisées, où les formes, coupées de leur origine populaire et traditionnelle, ne sont plus que des « simulacres » et des signes mercantiles. Sa plongée dans la Naples des années 2010 devenue le triste fantôme de la Naples de 1954 filmée par un néoréalisme autoproclamé « voix du peuple Italien », Dieutre, qui rien de Naples en Naples n’aperçoit plus, l’appelle donc voyage en post-histoire. Dans le film de Rossellini, déjà, une conscience historique était à l’œuvre durant la contemplation des statues rescapées de Pompéi au musée archéologique. Elle y prenait la forme d’une déploration : « On croit comprendre mais c’est une illusion », car irrémédiablement « tout est perdu ». Un demi-siècle plus tard, l’expérience de la perte elle-même se trouve dégradée par rapport à l’expérience qu’était le musée pour Ingrid Bergman dans le Viaggio : Naples, dit Dieutre, « ne peut même plus être une révélation », elle ne peut être que le nouveau lieu d’un divorce redoublé : celui de l’histoire et de la perte de l’histoire. Ce n’est plus que la perte « qu’il faut articuler, célébrer », sur un mode élégiaque que la poésie amoureuse a depuis toujours fait sien. C’est sans doute la raison pour laquelle le cinéma de Dieutre privilégie, à la méthode historique, une méthode amoureuse, cette forme que mettait déjà en œuvre Mon voyage d’hiver (2003), qui mariait, en lançant Dieutre sur un chemin double, les amants et les lieux des grandes œuvres musicales allemande. Car l’amour passionnel des formes est sans doute la matrice créative de Dieutre cinéaste. Il explique peut-être le rapport lyrico-historique de son cinéma : ce principe selon lequel il faudrait chercher à retrouver (et à laisser partir) l’histoire comme une relation amoureuse, avec ses mêmes sauts, ses mêmes coupes brutales – comme dirait le personnage du monologue de Cocteau – et ses mêmes désirs effrénés qui mènent le personnage (et donc le cinéaste) d’un endroit à un autre.
Formes amoureuses, formes documentaires
Nous l’avons dit, outre les moments du jeu amoureux entre Vincent et Simon qui excèdent celui de leur rôle dans le remake rossellinien, plusieurs scènes intermédiaires, telle la rencontre avec le juriste, sont l’occasion d’une suspension temporaire de la fiction. Ces instants de distanciation qui exposent la construction formelle du film et les réflexions d’un work in progress n’ont pas seulement l’effet d’ajouter une valeur autobiographique à l’ensemble du film, en associant la réalisation de l’œuvre admiratrice à des « autobiographèmes » du réalisateur (un exemple parmi d’autres, une possible lecture psychanalytique des larmes d’Ingrid Bergman qui, dans le film de Rossellini, rappellent au cinéaste les pleurs de sa mère). Ils visent plutôt à poursuivre la remise en jeu de la fiction rossellinienne par une nouvelle strate fictionnelle qui se rapproche de l’autofiction, ou plutôt de son envers : lorsque la vie du couple Simon-Vincent (personnages interprétant les acteurs du remake) se retrouve remise en scène par l’entremise du couple Alex-Tom (personnages du Voyage en post-histoire), ce sont les effets réciproques de la fiction sur la vie qui sont visés. De même lorsqu’un film est admiré, le dévoilement de l’effet-retour de l’œuvre sur la réalité constitue l’autre moitié de l’effort d’admiration. Car un troisième type d’image vient, à la fin du film, marquer plus intimement encore les noces de la fiction amoureuse et du document de création : il s’agit des images du film de Rossellini, convoqué in praesentia dans le film de Dieutre lui-même. La séquence célèbre de la procession de la San Gennaro, cérémonie en l’honneur de la Vierge qui marque également la réconciliation des amants que tout le film avait séparé, se retrouve alors projetée sur le corps des acteurs déclamant torse nu le texte des personnages de la fiction du réalisateur italien. Outre l’importance narrative de cette scène finale, c’est également l’occasion pour Dieutre de retrouver les séquences documentaires qui faisaient selon lui tout l’intérêt du néo-réalisme et de la Nouvelle Vague. Il n’est en effet pas anodin, chez un Rossellini, que ce soit la réalité elle-même, représentée par la foule de visages célébrant le miracle rituel du saint, qui vienne sauver le couple de la fiction. Chez Dieutre, cependant, cette scène est entièrement réinterprétée selon le prisme contemporain et vient comme fictionner le documentaire de l’intérieur : ce sont d’abord les visages floutés des processionnaires passant devant la caméra de Rossellini, comme si finalement, la foule la plus « véritable » était encore aujourd’hui celle de la fiction de Rossellini. Là encore, il s’agit pour Dieutre de signifier un rapport disparu entre le cinéma et le peuple, puisque – comme il le note en expliquant ce choix ironique d’une anonymisation des figurants – il ne serait plus possible de tourner avec une telle liberté aujourd’hui. En outre, la procession de San Gennaro, dans toute sa brutalité cathartique, est remontée avec des images de l’agitation des supporters et des tifosi durant un match de foot, que le dialogue refait concorder avec l’esprit de la scène de Rossellini : « Ils sont fauchés, ils y croient. Au moins les enfants sont heureux. » Mais surtout, la lecture de ces dialogues par-dessus le film, en surimpression, apparaît comme le moment où l’admiration s’expose le plus comme processus de réincarnation travestie de la parole. En effet se dévoile lors de cette séquence un jeu de correspondance à multiples niveaux entre George Sanders et Ingrid Bergman (les acteurs originaux, Bergman représentant ici aussi la femme du réalisateur du Viaggio), Alexander et Katherine (personnages du film original), Alex et Tom (personnages du film adapté) et enfin Simon et Vincent (personnages du film en train de se faire) qu’il faudrait encore dissocier des personnes réelles Simon Versnel et Vincent Dieutre. Par ce vertige d’enchâssements qui permet à chacun d’incarner un dehors de soi fictionnel et d’y retrouver une profonde intimité de l’œuvre, Dieutre poursuit l’expérience de dépersonnalisation entamée dans l’Ea Eustache et continuée dans le dédoublement propre au (faux) monologue de Cocteau. L’admiration, alors ouvertement devenue pratique théâtrale, répond à la distance de l’histoire par la proximité du jeu, à la séparation des temps par les retrouvailles des corps, symbolisées par l’étreinte finale de Simon et Vincent et, à travers eux, de tous les personnages. Tendresse d’un film qui s’achève et dont le ravaudage fictionnel aura constitué, au moins le temps d’un film, la trame d’une histoire véritable.
Ea5 : Alain Cavalier (Frère Alain)
Cet exercice s’ouvre et se clôt, une fois n’est pas coutume, avec un matériau radicalement hétérogène à la caméra de Dieutre. Pour la première fois depuis le plan donné à Naomi Kawase qui filmait son admirateur dans le premier Ea, un dialogue contradictoire s’esquisse sous la forme ludique d’une remontrance. Peu avant le départ prévu, Cavalier revient sur sa promesse d’accompagner Dieutre à Florence, et le cinéaste admiratif aurait à ménager à lui seul la présence de son ainé dans le film, si Cavalier ne répondait in extremis en envoyant deux lettres de cinéma. Outre que cette forme sied particulièrement à un cinéaste friand de missives cinématographiques (depuis Ce répondeur ne prend pas de messages en 1978 jusqu’au Filmeur de 2005, en passant par la Lettre d’un cinéaste en 1982), ces deux lettres annoncent également la particularité du dialogue de cet Ea : celle d’une proximité évidente, et d’un ton de conversation que Dieutre maintiendra tout au long du film, mais aussi d’un éloignement tendant vers l’infini. Car dans le même temps, le film ne coupe pas avec ce qui aura constitué un des thèmes sous-jacents de tous les exercices d’admiration, et qui est peut-être l’horizon de la forme essayistique en général, à savoir l’observation curieuse en même temps que la tenue à distance de la mort. Qu’il s’agisse de l’herbier, le lieu où « les feuilles viennent finir leur vie », ou de la forme picturale d’un des nombreux autoportraits peints par Rembrandt tout au long de sa vie (« Quand je regarde cet autoportrait, je suis assez content » dit Cavalier), de nombreuses images de la lettre du vieux cinéaste mettent en scène le plaisir double de la collection (« Pour filmer je n’ai pas d’autres règles que d’être attiré » ajoute-t-il dans sa salle de bain devenue studio de prises de vue) et de la joyeuse conscience de la mort. Comme saisissant l’occasion d’une nouvelle définition de l’admiration, plus que jamais devenu un exercice de la distance.
Arte povera : politique de l’ascèse
De la conscience prochaine de la mort, le film conserve donc – malgré le ton joueur qui caractérise si bien ces deux cinéastes-frères – une aura de gravité qui oriente ce film sur le chemin d’une ascèse. En effet, Frère Alain est venu d’une intuition suivant le visionnage de La Rencontre (1995), qui figure à Dieutre comment « incarner le renoncement au cinéma traditionnel, à la fiction, […] au décorum pour arriver à l’essentiel ». Plus que les autres, cet Ea est l’occasion d’un hommage à une forme tenue et à un style radical, et se caractérise aussi par un dispositif – aussi bien respectueux que malicieux – de l’observance de la règle d’un maître par un disciple. Ainsi Dieutre se propose-t-il de suivre les pas d’Alain Cavalier tout comme Dolcino, le franciscain ascétique dans lequel se projette le cinéaste, observait les préceptes franciscains. Cet exercice donne alors à Dieutre le prétexte d’une justification du « cinéma à la première personne » dont Cavalier est en France l’une des figures les plus importantes : c’est le moment de rappeler que « se raconter, prendre son expérience comme sujet », relire le monde « à l’aune de ce que l’on a devant soi », n’a rien de l’égotisme ou de la fermeture.
« Repartir de l’individu, de soi, ce n’est pas faire l’impasse sur le collectif ; c’est au contraire le moyen d’inventer un autre langage politique, à la mesure d’une donne sociale radicalement nouvelle. Le Tiers-Cinéma entre en résistance économique en repensant le budget des films, et se fait aussi activiste politique en repensant les rapports du sujet à la société qui l’entoure. […] Subversion des genres, parole minoritaire, déconstruction du récit dominant, critique interne des rapports de production et des circuits de diffusion des films : le Tiers-État est le nouvel enjeu politique du champ cinématographique[99][99] Article « Politique » in Vincent Dieutre, « Abécédaire pour un Tiers Cinéma », ibid., p. 83.. »
L’exercice d’admiration se fait alors exercice spirituel et emprunte la voie non d’un minimalisme formaliste mais de l’exigence morale d’un vœu de pauvreté. L’intuition à l’origine de la scolie de Dieutre sur le cinéma de Cavalier repose sur le sens d’une convergence temporelle : l’idée d’une cyclicité de l’histoire, au moins d’une correspondance des actes du passé et de leur fonction dans le contemporain. Il y a une ascèse du cinéma comme il y a eu une ascèse de l’Église et de l’art qui en était alors la dépendance, dit en substance le cinéaste, et les deux peuvent se regarder conjointement, et peut-être se rencontrer, comme des actes politiques de refus, de dénudement. Ce prisme historique est alors utile à Dieutre pour appeler à un dénudement matériel du cinéma, de ses effets et de ses possibilités scénographiques. Ce « cinéma de chambre », cinema povera si caractéristique des films de Cavalier, ne débutait pas avec La Rencontre, mais s’initiait déjà patiemment depuis Ce répondeur, par un lent processus de dépouillement personnel, dans l’acception choquante et scatologique même de l’autoportrait et dans la revendication politique des conditions de travail du cinéaste réduites à leur strict nécessaire. Mais à cette forme pauvre du cinéma, il faudrait encore adjoindre la richesse intarissable de la générosité. Nouveau François d’Assise, « Fra Alino di Parigi », dont la passion pour les visages qu’il croise dans la rue ou dans le métro se révèle à chaque instant – et peut-être plus qu’ailleurs dans les vingt-quatre Portraits (1987-1991) de femmes au travail –, est également parent du Giotto des fresques de Santa Croce, l’un des premiers à individualiser chacun des visages de ses foules de croyants. Une générosité se dévoile peut-être aussi dans les actes de Dieutre-Dolcino : elle serait autant, comme l’étymologie le dévoile, l’acte d’accepter une filiation, moins de reconnaître dans le geste du donateur le trésor virtuel d’une culture passée que la promesse à venir de sa réactualisation. C’est par générosité sans doute que Dieutre alors accueille Cavalier dans son propre film et lui offre le lieu de sa propre médiation sur l’admiration.
Documents de l’horreur, fragments sur le sacré
Le cinéma d’Alain Cavalier ne s’abstient jamais de ces « cadeaux au spectateur » dont le cinéaste a le secret. Épousant la forme d’un partage, voire d’une certaine commensalité tant la table de la cuisine ou du salon tient souvent lieu de cadre et de fond pour la caméra, son cinéma de la présentation vise également à l’établissement d’une communauté affective dans le saisissement devant l’horreur. On connait chez Cavalier l’intérêt pour les choses vues, pour les choses possédées, les choses qui tiennent dans la main (de préférence une seule, l’autre tenant la caméra). En effet, il n’est pas un film sans qu’il ne nous soit présenté de petits objets (et leurs transformations : la combustion d’une allumette, l’effervescence d’une Aspirine), des fruits (la pastèque du Paradis, véritable matrice féminine), des animaux mêmes (une poule, ou bien un poisson, souvenirs religieux ou autobiographiques). Il apparaît alors comme une évidence pour Dieutre que ces corps transfigurés sont filmés comme des « reliques » ou des objets saints[1010][1010] Notons au passage que c’est peut-être l’un des intérêts les plus grands des Ea pour le spectateur que de proposer un commentaire sur l’œuvre originale qui demeure et persiste, qui, comme les meilleures critiques survivent en filigrane par-dessus les meilleures œuvres, en étendent la signification dans une dimension tout autre. Filmer « à la manière de » donne ainsi une nouvelle vue sur l’œuvre originale (sans la polluer, mais en la dilatant), une nouvelle vue qui peut être « pratique » comme le suédage du Viaggio in Italia par exemple, mais ouvre plus largement la voie vers une nouvelle forme de lecture, qui ne serait plus seulement une recherche de la vérité de l’original (au sens d’un dernier mot de l’origine) mais bien un espace de jeu et d’extension, d’interrelation plutôt que de fidélité.. Alors montrer le prix des choses, comme le prix du poisson acheté par Françoise pour le dîner, montrer ce que la vie (et le cinéma) coûte(nt), n’est plus seulement un simple documentaire sur la création du film, mais le moyen de restituer toute l’économie du cinéma dans l’économie de moyen de l’œuvre : les objets y deviennent lourds d’une pesanteur historique et politique, et en même temps légers d’une grâce cinématographique et presque spirituelle. On connaît aussi de Cavalier sa propension à filmer des tableaux (dans un film sur Georges de La Tour, mais aussi dans le musée de La Rencontre), ou encore des photographies d’événements historiques, comme des pièces à conviction : dans Ce répondeur, il s’agissait de montrer la photographie d’une « voiture qui a servi pour l’attentat » en Algérie. Plus généralement, tous ses films, dit-il, sont hantés par « la mort, le XXème siècle, les camps ». Le cinéma de Cavalier est un cinéma des objets sacrés (comme il le montre dans la lettre finale après le film de Dieutre) en tant qu’ils sont des objets d’histoire sacralisés par le cinéma. L’Ea se double alors d’une nouvelle réflexion sur les modalités historiques de l’admiration : qu’est-ce qu’une image sacrée pour notre temps ? Il ne s’agit plus d’une image religieusement sacrée mais temporellement sacrée (au double sens de profane et de contemporain) : c’est une image de notre histoire possédant une valeur de document. À la fin de sa lettre, Cavalier dit être le fils d’une Europe du XXème siècle qui avait « toutes les raisons de ne plus filmer ». Filmer, cependant, lui apparaîtra comme le moyen de « célébrer » la vie, de « rendre hommage à des documents de l’horreur » : « ce que l’image a produit de plus fort, qui dépasse toute nos fictions. » Et de prendre exemple sur le film amateur devenu la seule image connue de l’assassinat du président Kennedy à Dallas. Image de livre d’histoire s’il en est, entièrement médiatique… si ce n’était la pudeur, le recul horrifié, presque religieux, de son opérateur, qui a choisi de vendre tous les photogrammes à la télévision sauf celui « où la tête explose » : « Superstition de filmeur magnifique », éthique de cinéaste admirable. Ainsi l’admiration de Dieutre par les mots de Cavalier, l’admiration de Cavalier dans le film de Dieutre, retrouve et en même temps s’éloigne irrémédiablement de la pratique de Naomi Kawase, cinéma de la résurrection et de l’aménagement de la vie dans l’au-delà.
Tendue entre ces deux extrêmes, plus que la dispersion d’un éclectisme ou d’une incertitude, l’admiration de Dieutre cinéaste a l’élégance d’un panoramique. Car si un thème souterrain anime les Ea depuis la première question posée à Naomi Kawase et reparaît épisodiquement au gré des exercices, c’est bien la présence de la mort. De façon assez étonnante dans un tel cinéma « vitaliste », cinéma de l’energeia amoureuse, dans lequel la douleur, la souffrance et même la perte ne sont que d’autres formes données à la passion charnelle, perce ce qui pourrait passer pour un retour à l’essai comme discussion de la mort. Celle qu’il faut traverser chez Kawase, celle qu’il faut presque endurer dans l’urgence d’un monologue chez Eustache, ou à laquelle il faut succomber à la fin de celui de Cocteau ; la mort d’un couple, pourtant encore vivant, hanté par les amants excavés dans les cendres de Pompéi chez Rossellini ; la mort, enfin, des feuilles d’arbres qui viennent tapisser l’appartement d’Alain Cavalier comme les fresques d’une église pré-renaissante. Se dévoilerait alors dans l’admiration l’alternance d’une pulsion de vie fortement érotisée (marquée par le travestissement incessant de l’acteur-réalisateur) et nécessaire à toute remise en jeu, et d’une contemplation de la mort réflexive (une distance que la lettre, le texte, en même temps alliés et envers de l’acteur, ne cessent de questionner). Admirer, dans les exercices dieutriens, n’est sans doute qu’un autre mot pour désigner le désir d’une fiction, dans laquelle la référence n’est plus un repoussoir documentaire, une limite à la création, mais au contraire la force vive qui ancre le cinéaste dans l’histoire : car fictionner, dans les Ea, c’est essayer de rejoindre les œuvres, c’est fabriquer un objet qui, non pas corresponde à l’original, mais corresponde avec l’original du fond de sa distance. Son modèle, antispéculaire, n’est ni le portrait révérencieux, ni l’autobiographie déguisée, mais comme une forme théâtralisée de l’élégie, dont la descente terrible aux Enfers, dont le regard tragique sur Eurydice disparaissant, céderait le pas à l’invocation joyeuse de formes nouvelles à imiter.