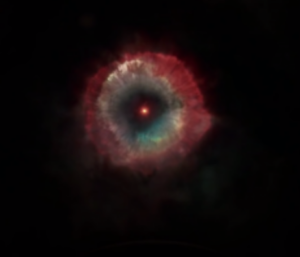Trap, M. Night Shyamalan
L'Impur

Pour qui est persuadé de son génie, M. Night Shyamalan est probablement le seul cinéaste capable d’évoquer ce que devait être le sentiment d’un cinéphile des années 50 découvrant le nouveau film d’Alfred Hitchcock, Howard Hawks ou Leo McCarey – l’excitation de voir la nouvelle leçon d’un maître, la crainte que la nouvelle œuvre ne soit pas à la hauteur, le trouble des attentes forcément déçues alors que le film vise toujours à côté. La comparaison entre Shyamalan et Hitchcock est d’ailleurs la plus évidente, tant ses films empruntent aux principes de mise en scène essentiels du cinéaste anglais – Shyamalan avait déclaré que Phénomènes était un remake des Oiseaux. On peut voir dans Trap un double remake, de La Corde (le titre anglais a lui aussi quatre lettres, dont deux en commun : Rope) et de Psychose.
Un remake du premier, pour la similarité dans la manière d’assumer la fermeture du huis-clos, ainsi que l’ironie dramatique d’une horreur exposée aux yeux de tous mais connue, pour un temps au moins, seulement du public. Pour la faiblesse du film, aussi. Rope est un Hitchcock pour jouer, au contenu moral et psychanalytique tellement appuyé qu’il s’évapore, au dispositif formel (un faux plan-séquence unique) fondamentalement superflu ; Trap est, aussi, un Shyamalan pour rire – on pourrait dire, sa première pure comédie (d’un humour, lui aussi, hitchcockien, c’est-à-dire cruel et morbide). Un remake du second pour l’étrangeté de son scénario, la cohabitation de deux personnages en un : le protagoniste et l’antagoniste, le héros et l’anti-héros, le bon et le mauvais, cohabitation qui hante le film jusqu’au regard-caméra final (qui n’a cependant rien de l’horreur de Psychose – il est ici comique, très comique).
C’est donc une comédie, une drôle de comédie : l’histoire d’un tueur en série, Cooper (Josh Hartnett, génial) qui, accompagnant sa fille (Ariel Donoghue) au concert de sa chanteuse préférée, Lady Raven (interprétée par la fille du cinéaste, Saleka Night Shyamalan), découvre que la police est au courant de sa présence, et doit trouver un moyen de quitter les lieux sans attirer l’attention. On aurait tort de prendre au pied de la lettre l’opposition métaphorique entre la vie de famille et le travail, tels que les dialogues (auxquels ni les personnages ni les acteur⸱ice⸱s ne semblent tout à fait croire), vers la fin du film, l’exposent : ce que Cooper réunit, dans ces plans frontaux qui déjouent sans cesse le système du champ-contrechamp, ce n’est ni plus ni moins que le bien et le mal, l’énergie vitale et la pulsion de mort.
Pour un cinéaste à peu près explicitement chrétien (ses films sont souvent le récit d’une foi perdue puis retrouvée, ou bien d’une rédemption – Signes étant le plus explicite), il y a là un vertige religieux difficile à comprendre, à maîtriser, encore plus à dépasser. Shyamalan ne prend donc aucun risque : il n’y met pas les pieds, et relègue, pour une fois, au second plan ses considérations cosmiques habituelles. Trap a la beauté, la vacuité et la possibilité de jouissance d’un exercice de style, ce que le réalisateur n’a, quoi qu’on en dise, jamais tenté jusqu’ici (les dispositifs peuvent être des prétextes – « une plage qui fait vieillir » –, les films joueront tout de même la carte du tragique sans une pointe d’ironie). Il s’agit probablement du premier film de Shyamalan où l’image est aussi léchée, brillante, clinquante presque, notamment dans le plan magnifique où la caméra accompagne Cooper alors qu’il tourne la tête pour regarder les milliers de lampes de téléphones allumées, comme une nuée de petites lucioles (le directeur de la photographie, Sayombhu Mukdeeprom, a d’abord travaillé avec Apichatpong Weerasethakul). Il y a aussi plus de place, dans un exercice de style, pour le simple plaisir de l’organisation et de la précision – géométrique.

La géométrie a toujours été présente chez Shyamalan, mais elle n’était jusqu’ici qu’accidentelle ou fonctionnelle – l’organisation hyper-raisonnée de l’espace était toujours la métaphore de l’hyper-organisation des récits, mais aussi du monde entier. C’est que pour Shyamalan, l’espace cinématographique correspond toujours à l’univers – tantôt un petit espace peut contenir l’infini (la plage de Old, où une vie entière se déroule en quelques heures), tantôt on trouve l’écho de l’infini dans le plus petit espace (l’immeuble de La Jeune Fille de l’Eau comme résumé de toute la civilisation humaine). C’est la synthèse étrange du cosmos shyamalanien : il est à la fois infini et clos – ce qui vaut pour une pièce vaut pour l’équilibre du monde, mais cet équilibre est déterminé, et même prédéterminé, avec une infinie précision. En cosmologie, on dit que l’univers est certes infini, mais isotrope, c’est-à-dire homogène, uniforme, partout et toujours.
Trap se conforme toujours à ce principe, mais pour la première fois l’espace n’est plus une métaphore ou un reflet, il n’est que lui-même, espace « réaliste » si on veut. Là où son film précédent, Knock at the Cabin, lui aussi un huis-clos, perçait à l’infini à travers son espace exigu pour résumer le cosmos à une petite cabane, Shyamalan fait de Trap une série de cercles concentriques. Chaque ouverture, chaque nouveau lieu, chaque porte ouverte ne sert qu’à renforcer l’enfermement ; la maison de famille, la limousine, sont autant de lieux et d’espaces où les personnages se retrouvent toujours enfermés. Comme le générique le souligne très bien, le film pourrait être résumé à des plans, des lignes tracées dans un espace abordé géométriquement, arithmétiquement. Cela place Shyamalan, pour la première fois, plutôt du côté de Lang que d’Hitchcock : le premier est plutôt logicien, le second plutôt philosophe ; le premier pense d’abord l’espace objectif, le second d’abord l’espace intérieur (on pense, bien sûr, à l’épisode de Cinéastes de notre temps où le cinéaste allemand discute avec Jean-Luc Godard et trace sur une feuille le plan d’une scène imaginaire, commentant la disposition des meubles et des portes).
Comédie cruelle, exercice de style, mise en scène arithmétique : le film n’est-il donc qu’une belle toile, jouissive mais sans leçon ? Sûrement pas : Shyamalan est le dernier cinéaste américain « mainstream » à croire encore que le cinéma peut avoir comme but l’édification morale (le dernier, oui – Spielberg a d’autres inquiétudes, Soderbergh fait de la politique). C’est, aussi et enfin, ce qui le rapproche de Hitchcock, de Lang et de ces vieux auteurs américains, pleins de génie et de morale à deux sous. Il y a bien un horizon moral dans Trap, une « victoire du bien » qui se dessine. Mais comment manifester cette inquiétude morale dans un film où le « héros » est aussi un meurtrier sanguinaire ?
En considérant d’abord, ce qui n’a rien d’étrange chez Shyamalan, que le monde est profondément moral, que tout y est bon, malgré ses défauts ; un personnage secondaire, The Thinker, interprété avec beaucoup d’autodérision par Kid Cudi, le montre bien, tantôt souriant, drôle, agréable avec la fille de Cooper, et en même temps infect avec ses équipes. « Nul n’est méchant volontairement », donc ? C’était l’étrange morale de Split et Glass, où même les tueurs avaient leurs raisons (souvent mauvaises), mais ce n’est pas celle de Trap. Cooper affirme que ce qui crée en lui le besoin de tuer, c’est de voir des êtres « whole », c’est-à-dire, littéralement, « entiers », terme que les sous-titres français ne traduisent pas si mal par la notion de « pureté ». Or la pureté ne peut être qu’un piège, une illusion (cela pourrait être le synopsis de Trap). Cooper semble respecter un impératif cosmique, à l’image des monstres inventés pour maintenir la cohésion sociale dans Le Village ; mais il se trompe en croyant voir de la pureté là où il n’y a que des êtres et des choses imparfaites. Le jeune homme enfermé dans la cave, Spencer, est sauvé car il a reconnu une statue brisée ; la profileuse et Rachel, la femme de Cooper, n’ont guère de peine à pénétrer sa face cachée ; il n’y a bien que l’innocence de sa fille que l’on pourrait qualifier de « pure », et cette innocence finira brisée, tachée (comme l’écrivait Pascal Bonitzer à propos d’Hitchcock – toujours lui – « le mal est une tâche »).
Quand Lady Raven se propose de « sauver » Cooper, de lui proposer une rédemption, il la refuse avec humour (noir, bien sûr). Certains personnages de Shyamalan refusent le salut (Elijah dans Incassable et Glass ; le critique dans La Jeune Fille de l’Eau), mais ce sont des personnages secondaires, dont la mort ou la mise hors d’état de nuire autorisent le triomphe du bien. Que serait, dans Trap, le triomphe du bien ? Le pauvre Spencer est sauvé grâce à la magie de TikTok, certes, mais Cooper n’est pas vaincu – il est le négatif, le miroir inversé de la carte du monde moral, une anomalie impure à laquelle on ne peut attribuer une place fixe, et donc il s’échappe toujours, invraisemblablement. On pourrait mesurer la réussite d’un film de Shyamalan aux souffles qui s’échappent du public lors des retournements de situation.
Goethe a un jour écrit une phrase qui obsédait Blanchot, précisément pour ce qu’elle impliquait dans le rapport entre l’art et la morale : « Il ne saurait être question de bien finir. » Phrase qui évoque le suicide de Werther, et qui pourrait presque être prononcée mot pour mot par Cooper vers la fin du film, lorsque, après avoir refusé la rédemption offerte, il annonce calmement, sobrement, son projet de se suicider (« And then I’ll kill myself »). Et pourtant, Cooper survit, et clôt le film par un sourire. C’était inévitable : Trap est une comédie (une comédie noire), Trap est hollywoodien (inspiré par les plus pervers des cinéastes hollywoodiens), Trap est un film moral (où le héros est un être abject). Et donc, Trap finit bien. Quoi que ça veuille dire.

Scénario : M. Night Shyamalan / Image : Sayombhu Mukdeeprom / Montage : Noëmi Preiswerk / Musique : Herdís Stefánsdóttir, Saleka Night Shyamalan
Durée : 1h45.
Sortie française le 7 août 2024.